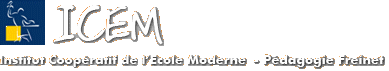Jean-Michel Mansillon.
Sur ce sujet, nous disposons de textes de référence importants –je pense bien sûr aux écrits de Célestin Freinet et de Paul le Bohec, mais aussi à de nombreux articles, à des brochures, aux écrits plus récents de Nicolas Go sur la question. Cependant, cela fait un moment que je suis amené à constater, à l’occasion de réunions de travail, que le concept de « méthode naturelle » [j’écrirai désormais « MN »], bien qu’au cœur de la Pédagogie Freinet, demeure vague et relativement confus, et qu’il s’ensuit d’une part que beaucoup hésitent à s’engager dans cette voie, et d’autre part que les pratiques se réclamant plus ou moins de la MN sont fort diverses (ce qui est cohérent avec la démarche) mais aussi qu’elles sont engagées par des conceptions différentes de la notion, comme si, parlant de MN, nous ne parlions pas vraiment de la même chose. Alors que celle-ci est un thème du prochain congrès, je me propose, dans cette réflexion, d’essayer de contribuer à éclaircir ce qui y est en jeu et de dépasser les équivoques qui l’enveloppent.
En première approche, si l’on s’en tient à un usage courant de la notion au sein du mouvement Freinet, et au contexte de son émergence (historiquement, quand Freinet introduit ce terme, mais aussi dans l’évolution de chacun), le terme de «MN» et son sens n’apparaissent pas comme problématiques. C’est qu’il se définit d’abord simplement en réaction contre quelque chose que l’on refuse ou condamne, à quoi l’on s’oppose, précisément contre ce que Freinet appelle la « scolastique », et cela sur la base de deux constats complémentaires :
-Constat des limites, insuffisances, échecs de l’enseignement traditionnel ou frontal, notamment dans le domaine des apprentissages. Précisément, pour rappel, et sans développer : les élèves s’ennuient (la scolastique ne connaît que des élèves) ; les apprentissages attendus sont laborieux, ils requièrent beaucoup de temps et ne sont souvent que superficiels ; le rapport aux savoirs ainsi « acquis » est plus asservissant que libérateur ; les pratiques scolaires courantes sont productrices d’échec et seule une minorité est en situation de réussite.
-Constat qu’il existe « naturellement », c’est-à-dire ici en situation non-scolaire, des apprentissages réussis, tels la marche, le langage, d’une manière générale les apprentissages de et par « la vie ».
C’est donc que nous avons en nous une immense capacité d’apprendre, y compris des compétences fort complexes (le langage par ex.) et que l’école, telle qu’elle fonctionne généralement, n’utilise pas ou peu cette capacité, qu’elle la perturbe, voire parfois qu’elle l’empêche.
Il est facile de voir que ce qui distingue fondamentalement ces deux situations constatées, c’est que là où l’apprentissage forcé impose un contenu décidé par ceux qui ne sont pas en situation d’apprentissage, selon une démarche elle-même uniformément appliquée à tous (le moment, le rythme, la manière), l’apprentissage « en situation » se construit au fil des besoins et des possibilités propres à chacun, dans un contexte relationnel vivant et chargé d’affectivité.
D’où, bien entendu, l’idée d’appliquer à l’école les conditions qui, dans les situations de la vie, permettent de construire au mieux les apprentissages dont nous avons besoin pour augmenter notre puissance d’être et d’agir.
Quelles sont ces conditions ? Les repérer devrait permettre de tenir les principes fondamentaux d’une « méthode naturelle » : l’enfant qui apprend à marcher ou à parler le fait dans un milieu où autrui marche et parle, et ressent cela comme une possibilité à conquérir, par laquelle il se sent grandir ; il avance dans cette conquête selon son propre rythme et sa propre démarche (on ne programme pas pour lui des étapes, une progression, un calendrier ; on ne lui impose pas une méthode, et il ne viendrait à l’idée de personne de vouloir que tous procèdent de même et que tous aboutissent au même moment) ; on ne considère pas ses tâtonnements comme des erreurs, des incapacités, des échecs : on contraire, on s’en réjouit, on l’encourage, le félicite ; tout en n’hésitant pas, à l’occasion, à l’aider, le corriger sur un point précis, à répondre à une demande.
C’est après avoir lui-même tâtonné dans sa classe, introduit de nouveaux outils, essayé de nouvelles démarches, que Freinet a tenté de théoriser, simplement, cette approche des apprentissages, à la fois novatrice et pleine de bon sens. Approche qui semble en effet, comme précisé au début, non problématique. La métaphore du jardinier est pertinente : ce n’est pas en tirant sur la plante qu’on l’aide à pousser, mais en lui apportant les conditions dans lesquelles elle pourra se développer.
Pourtant, si l’esprit de la démarche semble apparaître clairement et sans ambiguïté, la formulation de « MN» est source de possibles confusions, qui ne sont pas seulement d’ordre linguistique.
Je voudrais approfondir un peu la question à partir de deux écueils que l’on peut observer, l’un portant sur la dimension de « naturel », qui me semble concerner principalement l’image de la pédagogie Freinet, l’autre sur la notion de « méthode », qui concerne plutôt nos pratiques.
L’écueil à propos de la notion de « naturel ».
L’emploi fréquent de ce terme, chez Freinet et ses successeurs, suscite parfois de l’incompréhension, quand il est sorti de son contexte.
Soit parce qu’il est compris comme une référence à une nature mythique, bonne en soi et modèle pour toute action. Certes, certains écrits, lus en surface, peuvent donner un tel sentiment, et l’usage même du terme, compris de manière non critique, s’y prête. Mais c’est renvoyer la PF au domaine de l’idéologie, ce qui est un contresens, alors que le terme de « naturel » n’est d’abord, on vient de le voir, qu’opératoire.
Soit parce ce qu’il est renvoyé à la notion de spontanéité, ce qui relève de la même incompréhension, cette fois quant à ses conséquences pratiques.
Il s’agit ici de la croyance qu’en laissant les enfants à leur spontanéité tout se passera au mieux ; dans cette perspective, la réponse pratique au constat que l’enseignement frontal et forcé est inadapté, inefficace, sélectif, est le « laisser-faire », au niveau de l’expression, des activités, de l’organisation. Par notre interventionnisme intempestif, nous contraririons la nature ; il suffirait de les libérer des contraintes que nous leur imposons pour que les enfants puissent enfin s’exprimer librement, décider et réaliser les projets correspondant à leurs besoins, s’auto-organiser, et ainsi apprendre « naturellement ».
Nous savons bien que cela n’est pas la PF et que cela ne marche pas. Pourquoi, alors qu’on « laisse faire la nature » ? C’est que le naturel est complexe (la curiosité est naturelle mais la paresse aussi, la tendance à coopérer avec autrui n’est pas plus naturelle que celle de le dominer, celle à vouloir se sentir plus libre que celle à obéir…) ; c’est aussi que la « nature », c’est-à-dire le réel, n’est pas chargée de nos intentions, de nos buts, que nous nous plaisons parfois à lui attribuer…
C’est toujours « naturellement » que nous apprenons, profondément ou superficiellement, facilement ou difficilement, ou que nous sommes empêchés d’apprendre ; que ce soit en « méthode naturelle », en pédagogie frontale, selon le laisser-faire : comment pourrait-il en être autrement ? Naturellement, c’est-à-dire selon la nécessité naturelle, ou, si l’on préfère, les lois de la nature ; par ailleurs, si l’on entend par « naturel » ce qui ne relève pas de la culture ou de la société, comment parler de « méthode naturelle », alors même que ce concept renvoie à la relation aux autres, à l’expression, à l’expérience et à l’interaction avec le milieu ?
Le simple laisser-faire ne marche pas parce que justement, si certaines conditions ne sont pas présentes, « naturellement » l’enfant (tout comme l’adulte) reproduit ce qu’il sait déjà et maîtrise, évite de s’exposer et de se mettre en danger ; il continue à fonctionner, notamment dans ses rapports sociaux, selon des conduites déjà apprises. Ainsi, nous savons bien qu’il ne suffit pas de dire à un enfant qu’il peut écrire des « textes libres » pour qu’il s’engage au-delà des banalités ou de ce qu’il croit notre attente et nous avons expérimenté combien cette pratique devient facilement creuse ou routinière ; nous savons que « spontanément », la classe n’évolue ni vers l’auto-organisation (ou alors il faut prendre cette formulation en son sens littéral, ce que nous appelons « désordre » étant un état d’équilibre), ni vers la coopération, mais reproduit les hiérarchies et les conflits habituels ; nous savons enfin que dans ce contexte les possibilités d’apprentissages sont limitées (de quelques ordres qu’ils soient).
Croire donc que la MN se réduirait à supprimer nos contenus dogmatiques et modes d’intervention pour laisser les enfants livrés à leur supposée liberté (alors qu’on les livre à leurs conditionnements) est passer à côté du sens de cette démarche.
L’écueil à propos de la notion de méthode.
L’écueil du naturel était celui de la croyance en une nature « bonne » par elle-même, univoque, dotée de finalité et qu’il suffirait de laisser agir. Il exprime le plus souvent, à l’extérieur du mouvement l’ignorance des textes de la PF et surtout de ce qui se passe concrètement dans nos classes. Ce que j’appelle l’écueil de la méthode est d’un autre ordre. Je dirais qu’il s’agit en ce cas d’une sorte de réduction de l’idée de MN, en ce sens qu’on ne va pas au bout des idées fondatrices et de ce qu’elles impliquent, notamment celle du tâtonnement expérimental, réduction qui se manifeste par un retour plus ou moins masqué de la scolastique.
Les « techniques Freinet » sont autant de réponses pratiques aux insuffisances et échecs repérés de l’enseignement traditionnel. Ainsi, la pratique de l’expression libre vise à donner concrètement la parole aux enfants, à leur permettre d’être reconnus et respectés dans leur singularité au sein d’un groupe vivant ; l’individualisation du travail vise à permettre de prendre en compte les différences de rythmes de chacun ; l’introduction d’outils et matériaux permet la conception et la réalisation de productions diverses qui multiplient les possibilités par lesquelles les enfants peuvent trouver une voie propre ; les diverses occasions de communication contribuent à la mise en œuvre de conduites coopératives, et à d’autres modes d’accès aux savoirs… L’ensemble de ces pratiques, se complétant, servent de socle à la possibilité d’apprentissages liés au vécu, non scolaires, « naturels » au sens considéré au début.
Il s’agit bien de déscolariser l’apprentissage, c’est-à-dire qu’au lieu de le fonder sur des progressions et des processus pensés et décidés a priori, eux-mêmes organisés en fonction d’une logique portant sur les savoirs constitués, et donc uniformément imposés à tous (ce qui est cohérent, puisque l’on agit selon l’ordre des savoirs), on le fonde sur la réalité des processus d’acquisition, qui ne dépendent pas des savoirs, mais de la complexité du vivant, telle qu’elle se manifeste dans l’activité d’un sujet singulier, doté d’une histoire singulière.
Ce qui me semble essentiel, dans ce renversement, c’est bien ce changement de logique : l’expérience dans et par laquelle on apprend vraiment, ce n’est pas celle qui est organisée de l’extérieur en vue de cela, mais celle que l’on s’approprie en la reconnaissant nôtre, en résonance avec notre état présent (affectif, cognitif…).
Ce que j’appelle l’ « écueil de la méthode », c’est le risque de transformer des techniques (qui ne sont que des moyens) en une méthode, en fait de s’accoutumer à certaines pratiques en en oubliant le sens ; autrement dit, c’est la difficulté à nous défaire des anciennes représentations de notre rôle, à savoir d’être celui qui décide, organise, maîtrise : la manière traditionnelle de travailler ne convient pas : appliquons-en une autre, organisons autrement la classe… Ce n’est pas par hasard que nous insistons tant, au mouvement Freinet, sur « la place du maître ». Il est question de « méthode » naturelle ; mais en quel sens comprendre « méthode » ? La formulation couramment employée de « MN de lecture, de mathématique… » exprime déjà l’écueil, comme s’il s’agissait de remplacer une méthode par une autre.
Je peux, en effet, organiser ma classe autrement : je peux aménager des « ateliers », disposer autrement le mobilier, en vue de diversifier les activités et prendre en compte les besoins physiques et les possibilités concrètes ; je peux remplacer les manuels par du matériel individualisé, et ainsi adapter les progressions aux rythmes individuels ; je peux abandonner mes belles leçons savamment préparées et les remplacer par des séquences de travail à partir de l’expression ou des recherches des enfants, en vue de donner du sens aux activités ; je peux introduire un plan de travail, proposer des moments de communication, instituer des réunions coopératives ou des conseils. Tout cela se rejoignant dans la perspective d’une MN, effectivement dotée de la cohérence d’une méthode.
Ce faisant, je suis effectivement passé d’une méthode passive (les enfants reçoivent, obéissent, subissent) à une méthode active (chaque enfant est partie prenante de ses apprentissages, les exercices et activités sont plus proches de ses possibilités et de ses besoins). Ce n’est pas rien et je me suis ainsi rapproché de conditions non scolaires d’apprentissage, permettant ainsi davantage de motivation, d’engagement personnel des enfants, et donc des apprentissages plus profonds avec moins de laissés-pour-compte. Bernard Collot parlerait d’une pédagogie du deuxième type.
On peut cependant remarquer que dans ce contexte, la programmation, les exigences quant aux acquisitions scolaires, l’emploi de temps, les démarches, viennent de l’enseignant. Plus ou moins. Certes celui-ci, qui « propose » l’expression libre, des exercices individualisés…vise bien un apprentissage lié à la vie et au réel, et pour cela constructeur ; mais qui n’a pas vécu , après un moment d’enthousiasme, une évolution progressive de sa classe vers un retour à l’esprit de la scolastique : des textes écrits par routine, partiellement vidés de leur profondeur expressive, et réduits à être supports d’apprentissages ; du « travail individualisé » programmé sous la pression des adultes ou de l’habitude, et réalisé « pour apprendre » (et non pour passer un cap nécessaire à un projet personnel) ; le temps qui manque pour des activités créatrices et non-scolaires, parce que le plan de travail (en fait, celui des attentes de l’enseignant) n’est pas terminé … ?
Même si cette dérive n’existe pas, ou devenue consciente, est rectifiée, il faut encore remarquer que cette démarche nouvelle, non « traditionnelle », introduite par l’enseignant est applicable à tous (nous sommes toujours dans le plus ou moins) ; celui-ci a bien compris l’importance que les activités-support-d’apprentissage aient du sens, mais quant à ce qu’il propose au niveau de l’apprentissage (qu’il le propose ne signifie pas que les enfants apprennent ainsi, mais cela s’applique à toute « méthode ») , en s’appuyant sur une expression individualisée, on demeure souvent dans l’uniformité d’une démarche (la leçon magistrale étant remplacée par des séquences collectives qu’il faut bien appeler d’enrichissement ou d’exploitation, séquences de français, mathématiques, sciences… ) censée déboucher sur les nécessaires acquisitions.
Peut-on alors parler de « méthode naturelle », s’il ne s’agit que d’une méthode ?
Méthode naturelle ?
Nous sommes partis d’une compréhension simple mais négative de la MN : une démarche au plus proche de l’enfant réel, réunissant les conditions les plus favorables à des apprentissages qui le construisent en l’émancipant, qui se définit d’abord par opposition à la scolastique.
Toutefois, qu’il s’agisse de comprendre ce qui est en jeu, ou de le mettre en œuvre pratiquement (les deux sont indissociables), nous avons vu qu’il y a des difficultés, qu’il s’agit maintenant d’essayer de dépasser.
Une fois le terme de MN introduit, quand C.Freinet ou P. le Bohec présentent ce qu’ils conçoivent ainsi et qu’ils ont expérimenté, ils décrivent comment Baloulette ou Rémi se sont appropriés naturellement (par des voies non scolaires) le langage écrit, ou comment les enfants de la classe de Paul se sont construits et appropriés un langage mathématique. Ils décrivent (des processus d’apprentissage), et c’est en cela que l’on peut parler de « méthode naturelle ».
Il ne saurait y avoir de « méthode naturelle » au sens courant de ces termes qui se contredisent aussi bien au niveau linguistique (une méthode vise précisément à ne pas se soumettre à ce qui serait « naturel ») qu’au niveau pédagogique (une méthode s’applique et s’impose à tous). Par contre, une fois éliminées les illusions ou difficultés liées à la polysémie du terme « naturel » (tout est naturel si l’on considère que nous sommes des êtres naturels et obéissons à la nécessité naturelle, rien n’est naturel, et surtout pas l’éducation, si l’on considère que le naturel en nous est mêlé de social), si l’on ne peut parler de MN comme méthode généralisée en classe, ne peut-on parler de MN expérimentée et vécue par chaque enfant singulier ? « Méthode » signifie ici la démarche selon laquelle nous apprenons. Elle ne sera pas « naturelle » absolument parlant, mais elle le sera plus ou moins selon que les processus mis en œuvre seront plus ou moins simples, « simple » pris ici non pas au sens de contraire de complexe (tout apprentissage est complexe) mais au sens de contraire de compliqué (compliqué par des perturbations extérieures intempestives : pressions ou attentes diverses, non respect des rythmes ou modes de fonctionnement propres, dévalorisation…). La notion de MN a un sens en tant qu’il s’agit de la «méthode » de l’enfant, et non de la volonté et de l’organisation de l’adulte.
Ce qui n’est pas dire, on l’a vu, que le rôle ou la place de l’enseignant est nul. C’est dire que celui-ci a changé, c’est prendre au sérieux des notions qui nous sont familières comme le « tâtonnement expérimental » ou « être à l’écoute de l’enfant », et en tirer toutes les conséquences pratiques.
Quand l’enfant apprend, dans et par l’expérience vivante (apprentissages non-scolaires), c’est la totalité de son être qui est engagée (ses besoins, désirs, affects de tous niveaux, son histoire incarnée dans une mémoire consciente et inconsciente), et cela de manière globale, c’est-à-dire que chaque élément de cette totalité est en interaction avec les autres. Quant au contenu de l’expérience, il ne s’agit pas d’une expérience réduite, limitée, plus ou moins pré-organisée en vue d’objectifs d’apprentissages, mais au contraire d’une expérience ouverte, riche d’une infinité de possibles, dans laquelle l’enfant pourra prélever ce qui, ici et maintenant, va contribuer à sa construction. C’est cela, fondamentalement, que Freinet appelle le « tâtonnement expérimental ». Certes c’est en fin de compte ce que nous faisons dans toute expérience, y compris la plus pauvre ou la plus aliénante ; mais permettre la plus grande richesse et la plus grande diversité de l’expérience à laquelle les enfants vont être confrontés n’est-ce pas infiniment plus respectueux de ce que Le Bohec appelle une « ligne optimale de développement » singulière, porteur d’un rapport aux savoirs (cognitifs, pratiques, sociaux) émancipateur plutôt qu’asservissant, tout simplement aussi plus efficace ?
Ainsi l’enseignant qui s’engage dans la voie de la MN n’est plus celui qui pré-voit, organise, attend des résultats pré-définis, mais, fondamentalement, celui qui vise à un élargissement des domaines d’expérience (situations de relations sociales riches –expressions, communications, échanges, co-opérations, co-organisations…-, activités utilitaires, créatives,…), qui, en cela, permet aux enfants de trouver leurs propres voies et voix, et parfois les « brèches » (encore un terme cher à Freinet) qui débloquent : bref il faut qu’il soit d’abord celui qui n’empêche pas -ce que souvent, et bien malgré nous, nous faisons, en tant que nos représentations de notre rôle nous inclinent à croire que c’est par nous qu’ils apprennent, et à agir en conséquence. Pourtant, paradoxalement, ce n’est pas en ne faisant rien que nous pouvons assumer cette attitude : mais en étant présent, et par là rassurants ; en donnant confiance, en encourageant, en accompagnant ; en apportant l’aide sollicitée, quand c’est le moment ; en dédramatisant quand il faut ; étant attentifs et à l’écoute, en aidant aux prises de conscience (de capacités, de désirs, de projets…) ; en favorisant, enfin, l’émergence d’un groupe vivant, accueillant, enrichissant.
C’est donc la possibilité pour les enfants d’apprendre en fonction de ce qu’ils sont (au présent, mais dans leur devenir) et de se construire en apprenant, de trouver dans la vie de la classe les points d’appui les plus adéquats, qui justifie l’emploi de l’expression « MN».
Pratiquement, l’apprentissage peut se considérer à deux niveaux, celui de l’activité précise qui va lui servir de support, et celui de son rapport à l’ensemble des activités. D’un niveau à l’autre, le sens de la notion de MN se déplace nécessairement quelque peu.
Si l’on s’en tient à notre définition de départ de la MN (apprentissage non scolastique ou rendu scolastique, dans et par l’expérience vécue), d’évidence, un enfant qui apprend, au sein de son milieu familial, à marcher ou parler le fait « naturellement » ; inversement celui à qui on impose un savoir ou savoir –faire quelconque, selon une démarche elle-même imposée, n’apprend pas ainsi. De même, on doit pouvoir qualifier de « naturelle » la démarche selon laquelle un enfant singulier s’approprie par exemple, l’écriture et la lecture, dans le cadre familial ou scolaire, quand cet apprentissage se développe pas à pas, au fil des rencontres, des activités (écrits variés lus ou interrogés, seul comme on le peut, avec d’autres, ou par les autres ; textes écrits, seul ou aidé ; travail personnel à un clavier ou une imprimerie…), au fil des échanges, des encouragements, et qu’on voit l’expression écrite s’enrichir peu à peu, s’approprier peu à peu les conventions jusqu’à les maîtriser ; sans que cet apprentissage, implicite quant aux mécanismes intérieurs qui le construisent, explicite quant à ses résultats progressifs, ait nécessité des leçons et des exercices, ni une programmation. Il en est de même s’il s’agit de s’approprier des capacités motrices, des structures logico-mathématiques, etc…
Mais les situations ne sont pas toujours aussi simples : qu’en est-il quand une « méthode » de lecture, ou de mathématique, consiste à faire travailler collectivement les enfants sur leur propre expression ou leur propre recherche, a posteriori ? Il semble encore possible de parler de MN en tant le support venant des enfants est censé avoir du sens pour eux, et en tant que la séance n’a pas pour but une acquisition précise et commune à tous mais simplement de les aider à avancer dans leurs propres acquisitions. Mais ça ne l’est plus vraiment en tant qu’une démarche unique est proposée à tous et que généralement le caractère collectif de ces moments s’impose à tous. Et j’ai déjà évoqué le risque de dérive : que ce qui au départ est prise en compte de l’expression et, d’une certaine manière, respect du rythme de chacun, évolue vers un exercice routinier et scolarisé.
C’est ici que le deuxième niveau, celui de la vie de la classe dans son ensemble, ou celui qui considère les activités dans leur contexte, est à considérer.
En soi, et d’évidence, un enfant à qui on apprend à lire avec le b-a /ba, ou à qui on apprend de façon traditionnelle les techniques opératoires n’apprend pas en MN. Mais celui qui tombe par hasard sur un manuel d’apprentissage de lecture (ou qui le trouve dans la bibliothèque, ou qui le demande), et qui s’y plonge des journées entières, comme il passerait des heures à l’imprimerie, ou à écrire des textes ; ou celui qui pendant un temps ne fait plus que des exercices auto-correctifs de techniques opératoires ? On dira sans doute que ces « choix » s’inscrivent dans une démarche personnelle, sans que cela transforme pour autant la forme de l’apprentissage. Est-ce bien sûr ? Savons-nous ce qui se passe exactement dans la tête de Baloulette et de Rémi, ou de tout enfant, lorsqu’ils apprennent « naturellement » à lire ? Ce qui se passe dans la tête de n’importe quel enfant qui apprend à parler, à nager … ? Quels processus, quelles associations, quels circuits de neurones sont activés et de quelle manière ils le sont ? Malgré les avancées en imagerie médicale qui permettent de connaître, parfois avec précision, les régions du cerveau activées, on est loin de pouvoir interpréter en termes psychologiques l’activité observée : on ne sait pas comment Baloulette et Rémi ont appris à lire. Freinet et Le Bohec n’ont pu que décrire le chemin personnel qu’on leur a laissé suivre.
En fait, il y a la méthode de l’enseignant (collective par définition, même si elle contient une part d’individualisation), ou le rejet de celle-ci, la démarche de chaque enfant (singulière), et les processus physico-chimiques de l’activité neuronale, support des apprentissages. Ces processus sont autant inconscients (pour le sujet) qu’inconnus (pour l’instant et pour tout observateur).
C’est la considération de ces différents niveaux qui donne à la MN tout son sens : une méthode en général prétend, au moins implicitement, se fonder sur des processus connus, elle va même jusqu’à prétendre produire ces processus ; alors que la « MN » ne vise pas à agir au niveau des processus mais simplement à faciliter ou rendre possibles des apprentissages dont l’observation et désormais les connaissances montrent qu’ils suivent des chemins singuliers.
C’est pour cela qu’une pratique singulière (de lecture, de math, d’arts plastiques ou de ce qu’on voudra) ne peut suffire seule ni à définir, ni à appliquer, ce que nous appelons « MN ». En elle-même, elle peut contribuer à un apprentissage bien fondé (au sens déjà vu de fondé sur les possibilités, besoins, et en situation) ; comme elle peut insensiblement revenir au scolastique (ne plus faire sens par rapport au vécu singulier mais seulement par rapport à un apprentissage « à faire »).
Si elle relève de la MN ce ne peut être qu’en tant qu’elle est une possibilité pour chaque enfant de vivre une expérience qu’il a reconnu sienne, et, la vivant, d’apprendre. Une possibilité parmi d’autres. Et fondamentalement, n’est-ce pas cela que nous serions en droit de nommer « MN» ? A savoir que la classe soit un milieu suffisamment vivant, riche, respectueux, pour que chaque enfant ait l’occasion de rencontrer les situations lui permettant d’apprendre au mieux ce avec quoi il se construira de manière autonome.
S’il s’agit par exemple d’apprendre à lire, pour l’un ce sera en passant par des moments collectifs de recherche sur des textes ; pour l’autre ce sera seul, en s’appuyant sur sa propre écriture, ses propres lectures, l’observation… ; pour un autre ce sera dans la confrontation avec une imprimerie, un clavier, un livre, un manuel ; pour un autre dans une relation avec un pair ou avec l’enseignant (peu importe alors la « méthode », c’est la relation et le désir qui comptent ici)… Les chemins sont innombrables et souvent imprévisibles et invisibles ; comme ils peuvent être multiples. Il en va de même pour tous les domaines. En MN, notre souci principal ne peut être que celui de laisser ouverts les chemins ; et c’est en cette ouverture là, qui est d’une certaine manière effacement de notre part, qu’il peut y avoir MN.
Je rajoute ce que chacun voit bien : si pour tous ce qui est en jeu c’est le sens de l’apprentissage, c’est-à-dire le rapport établi avec celui-ci, la place qu’il va prendre, pour certains, ceux que l’école désigne comme étant en difficulté, ce qui est en jeu, c’est d’abord la possibilité même de réussir un apprentissage.
Une dernière remarque qui découle de ce que nous venons d’analyser, c’est que la MN ne pouvant être assimilée à une méthode au sens courant du terme, et des pratiques isolées étant insuffisantes pour la définir, il devient difficile de dire en quoi précisément et à partir de quand on « travaille en MN », de même qu’il est difficile de dire qu’une classe est une « classe Freinet ». En effet, à la limite, je peux ne proposer et n’organiser que des activités reliées à l’expression des enfants, ou individualiser le travail, et cependant le faire de façon telle qu’on ne peut sérieusement parler de MN (nous avons vu pourquoi) ; à l’inverse, je peux à l’occasion conserver des leçons, aborder avec un enfant ou un groupe un apprentissage technique de manière très traditionnelle, et le faire dans l’esprit de la MN. C’est que le critère de compréhension de ce que nous faisons n’est plus dans la « méthode » à proprement parler, mais dans le sens et la place de l’activité, sens pour l’enfant, et place que nous lui accordons. L’activité est elle de fait une possibilité parmi d’autres pour que tel enfant particulier puisse apprendre en avançant dans son expérience ? Est-il en situation de la vivre comme sienne ? Ou est-elle en fin de compte une contrainte clairement affichée ou masquée qui a plus ou moins cessé de faire sens ?
Ainsi, au niveau d’une activité précise, c’est la démarche que suit l’enfant (ou plus exactement ce qui en est observable) qui pourra définir sa dimension « naturelle ». Au niveau de l’ensemble des activités (la vie de la classe), c’est leur sens et leur place, plus que leur nature, qui permettront de dire, non pas que l’on « travaille en MN », ce qui serait bien présomptueux, mais que l’on travaille dans cette perspective.
Il importait de bien comprendre ce que nous entendons par MN. Nous avons essayé de comprendre pourquoi on constate des incompréhensions et parfois des divergences sur ce que signifie cette notion. En fait, la MN, dont nous avons vu qu’elle est davantage une démarche d’apprentissage propre à chaque enfant, démarche que nous nous efforçons de rendre possible, qu’une méthode appliquée par l’enseignant, est la conséquence pratique du tâtonnement expérimental, considéré comme ensemble des processus selon lesquels nous apprenons, quand nous allons au bout de ce qu’il implique, et que nous essayons d’être conséquents.
J.Michel Mansillon, GD 06, Frem-Paca.