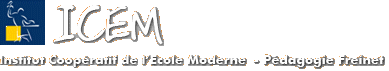Par Muriel Quoniam le 11/09/09 - 09:34
Signification politique de la Pédagogie Freinet aujourd'hui
Exposé introductif : Raphaël Doridant
Le titre de l’atelier aurait pu être : « Ce n’est pas avec des hommes à genoux qu’on mettra la démocratie debout » (Freinet). Mais, bien que long, le titre choisi m’a paru préférable, plus clair, en particulier parce que je voudrais insister sur le aujourd’hui. En effet, je souhaite montrer comment la société s’est modifiée, pour mieux comprendre à quoi la pédagogie Freinet est confrontée actuellement. Deux éléments sont à considérer : d’une part, l’évolution de la structure des organisations (entreprises, établissements scolaires…), l’évolution des modes d’exercice du pouvoir hiérarchique dans les organisations, devenus beaucoup plus fins qu’il y a cinquante ans et qui touchent les gens beaucoup plus profondément dans leur subjectivité ; d’autre part, l’évolution des mentalités. Ces deux éléments sont intrinsèquement liés, l’un conditionnant l’autre et réciproquement.
J’essaierai d’exposer en quoi la pédagogie Freinet rompt avec les pratiques sociales qui ont cours dans la France contemporaine tant en ce qui concerne le rapport au pouvoir, le rapport au savoir, le rapport au travail, le rapport à soi, le rapport à autrui, et pour finir je tenterai de montrer ce que nous apprend la pédagogie Freinet quant à la possibilité d’une transformation sociale aujourd’hui.
1) Le rapport au pouvoir
Dans les classes Freinet, le pouvoir s’exerce de manière directe et partagée. Il y a un partage égal du pouvoir. Le conseil, ou la réunion de coopérative, est à la fois le parlement qui légifère, le tribunal qui juge et le gouvernement qui propose et met en œuvre les projets. Tout cela rappelle beaucoup la démocratie directe. Les trois pouvoirs sont présents dans la classe, mais avec une participation directe des enfants, pas par l’intermédiaire de représentants ou de délégués.
L’autre élément qui rappelle la démocratie directe, c’est la rotation aux fonctions d’autorité puisque les présidences sont assurées à tour de rôle, soit par l’élève de jour, soit, dans les classes « pédagogie institutionnelle » comme la mienne, par les enfants titulaires de la ceinture de comportement appropriée. Personne ne peut s’installer de manière longue dans une fonction d’autorité au sein de la classe. On commande et on obéit chacun à son tour, et c’est la définition du bon citoyen selon Aristote : « […] il semble que […] l’excellence d’un bon citoyen soit d’être capable de bien commander et de bien obéir » (Les politiques, III, 4, 1277 a 27). Aristote ajoutait : « Le principe de base de la constitution démocratique c’est la liberté (c’est, en effet, ce qu’on a coutume de dire, parce que c’est seulement dans une telle constitution que <les citoyens> ont la liberté en partage ; c’est à cela, en effet, que tend, dit-on, toute démocratie). Et l’une <des formes> de la liberté, c’est d’être tour à tour gouverné et gouvernant » ( Les politiques, VI, 2, 1317 a 40). Quelques lignes plus loin, le philosophe explique qu’à défaut de voir satisfaite la revendication de n’être gouverné par personne, s’exprime celle « <de l’être> à tour de rôle. Et cela va dans le sens de la liberté fondée sur l’égalité » (Les politiques, VI, 2, 1317 b 15)[1].
La démocratie athénienne était fondée sur la participation égale, directe, de tous les citoyens au pouvoir de légiférer, de juger et de gouverner. Il me semble que c’est ce qui s’apprend dans les classes Freinet. Ce n’est pas du tout notre cas comme citoyens adultes. Rarement sommes-nous tirés au sort pour être jurés d’assises. Nous n’avons pas du tout cette habitude. A Athènes, les jurys étaient très nombreux : 201 citoyens, 501 citoyens ou davantage. On écoutait les parties. Il n’y avait pas de délibéré. On votait sur la culpabilité ou l’innocence. Puis, si la culpabilité était reconnue, l’accusation et la défense proposaient une peine et le jury votait la peine. Les citoyens athéniens étaient tirés au sort pour participer aux jurys. En ce qui concerne l’exercice des charges publiques, le tirage au sort était généralement utilisé, y compris pour des responsabilités élevées : par exemple, le magistrat qui recevait les ambassadeurs et gardait les clés du trésor de la cité (l’épistate des prytanes) était tiré au sort pour 24 heures. Pendant une journée, il était président de la République, mais pas dans le sens actuel, surtout aujourd’hui en France, où M. Sarkozy prend des décisions comme il veut, se lève le matin et décide que le samedi ne sera plus un jour de classe, tout ça avec un Parlement aux ordres. Aux Etats-Unis, on constate que M. Obama a du mal à faire passer sa réforme de l’assurance maladie auprès du Congrès. Là-bas, il y a une séparation des pouvoirs qui est bien plus effective qu'en France. Chez nous, le pouvoir est à l’Elysée. Et ça, les Athéniens auraient détesté. Ils craignaient par-dessus tout la tyrannie, parce qu’ils en avaient souffert et s’étaient révoltés contre.
Cette tradition de l’exercice direct et égal du pouvoir a été reprise à différents moments dans l’Histoire : pendant la Révolution américaine avec les town meetings, pendant la Révolution française avec les sections, les clubs et les sociétés populaires, la Commune de Paris, les Soviets de 1917 avant la prise du pouvoir par les bolcheviques, le Révolution espagnole (1936-1938), la Révolution hongroise (1956)…
Un pays en Europe conserve des traces importantes de démocratie directe : la Suisse, où ont lieu des référendums d’initiative populaire qu’on appelle votations. Des citoyens prennent l’initiative de rédiger le texte devant être soumis au peuple. Ils recueillent les signatures nécessaires (le nombre varie selon qu’il s’agit d’une votation communale, cantonale ou fédérale). Si le nombre de signatures nécessaire est réuni, les autorités sont obligées de soumettre le texte au peuple. Ces votations ne permettent pas seulement de proposer de nouvelles lois mais aussi des actes de gouvernement. C’est ainsi que les Suisses se prononceront en 2010 sur un texte initié par des citoyens et visant à empêcher l’achat par la Confédération de nouveaux avions de combat. C’est inimaginable en France, où règne le secret défense. Le gouvernement décide pour nous, et puis terminé. Même si l’on veut en savoir davantage, on nous oppose le secret défense : les archives sont fermées, et le gouvernement actuel veut étendre la secret défense à des lieux, par exemple des entreprises liées à la Défense, où les juges d’instruction ne seraient plus autorisés à pénétrer sans l’accord de la commission de levée du secret défense.
La pédagogie Freinet, fondée sur la participation égale et directe au pouvoir, forme à une citoyenneté aux antipodes de la citoyenneté extrêmement étriquée que nous connaissons en France en tant qu’adultes. Elle conduit aussi à un rapport différent au savoir.
2) Le rapport au savoir
Il y a un lien, dans la société contemporaine, entre rapport au pouvoir et rapport au savoir : nos gouvernants exercent un pouvoir aussi grand parce qu’ils prétendent détenir un savoir. Ils utilisent un langage très ésotérique, qui est celui de l’économie, auquel on ne comprend rien. Et puis, comme ils ont les grands médias avec eux, ils martèlent les mêmes idées qui finissent par nous assommer, par nous laisser groggy. Dans la pédagogie Freinet, tout est mis en œuvre pour que personne ne soit placé en surplomb, détenteur du Savoir. Pensons au tâtonnement expérimental, au marché de connaissances, aux échanges réciproques de savoirs, au tutorat, aux recherches mathématiques… Ce qui est créé dans la classe, c’est une communauté de recherche où personne n’est placé en surplomb. Chacun sent bien que tous sont en recherche et que le savoir se construit. C’est à l’opposé de la représentation de l’expert-qui-sait, qui est toujours soit un économiste, soit un scientifique.
Ce culte de l’expert repose sur l’idée que le savoir existe quelque part, comme dans un grand livre dont on feuilletterait les pages. La science, ou les sciences, finiront bien un jour par avoir fini de feuilleter le livre, même si on a l’impression que ce livre rallonge sans cesse. C’est vraiment une vision naïve du processus de connaissance.
Ce processus est en effet tout autre. Il y a d’une part l’objet à connaître, quel qu’il soit ; d’autre part le sujet connaissant ; et entre les deux se produit une interaction : les théorisations du sujet connaissant rencontrent plus ou moins l’objet, et permettent d’en rendre compte de manière plus ou moins satisfaisante. Croire qu’il suffit de feuilleter le grand livre du monde, c’est considérer l’objet comme transparent. D’où des formulations telles que : « le grand livre de la nature », ou encore : « le réel est rationnel ».
Reconnaître l’opacité de l’objet à connaître et le rôle de création théorique du sujet connaissant (qui n’est pas un simple « lecteur » du monde), c’est concevoir la vérité d’une manière différente de celle qui a cours généralement. La vérité n’est plus conçue comme une accumulation de résultats, avec en arrière-plan l’idée qu’à force d’accumuler les connaissances vraies, on finira bien par tout savoir. Elle est conçue comme une activité de pensée, ce qui modifie aussi notre rapport à nous-mêmes, selon Cornelius Castoriadis :
« Soi n’est plus investi comme possesseur de la vérité, mais comme source, et capacité incessamment renouvelée, de création. Ou, ce qui revient au même : l’investissement se porte sur l’activité de pensée elle-même comme apte à produire des résultats vrais, mais au-delà de tout résultat particulier donné. Et cela va de pair avec une autre idée de la vérité, aussi bien comme idée philosophique que comme objet de passion. Le vrai n’est plus objet à posséder […]. Le vrai devient création, toujours ouverte et toujours capable de revenir sur elle-même, de formes du pensable et de contenus de pensée pouvant se rencontrer avec ce qui est. L’attachement à ce vrai est la passion de la connaissance, ou la pensée comme Éros. »
Un bref commentaire de cette citation essentielle à mes yeux. Pour Castoriadis, il s’agit de nous appréhender nous-mêmes comme source de création (de théories, de moyens de comprendre le monde). C’est cette activité de pensée qui est valorisée, davantage que le résultat vrai ou la croyance tenue pour vraie que nous avons produits. La démarche de recherche du vrai n’est donc pas l’accumulation de connaissances, mais l’engagement dans une activité de pensée visant le vrai. Bien sûr, nous obtenons des résultats vrais, mais nous avons aussi et surtout cette capacité de les remettre en question, parce que nous avons investi davantage notre capacité de création et de pensée. Cette capacité nous amène à imaginer non seulement des théories permettant de rendre plus ou moins compte du monde, mais aussi de nouveaux objets de connaissance, de nouvelles « formes du pensable ». Freud découvre/crée[5] l’inconscient, nouvel objet à connaître, nouvelle forme du pensable. Les mathématiciens découvrent/créent de nouveaux objets mathématiques. Pythagore revenant aujourd’hui serait complètement dérouté par les objets mathématiques non intuitifs ou contre-intuitifs dont les mathématiciens contemporains font leur miel. Il y a donc création de formes du pensable, et aussi de contenus de pensée. Freud dit : « Il y a un inconscient », nouvelle forme du pensable, puis il s’efforce de « décrire » son fonctionnement en élaborant des théorisations successives, des contenus de pensée. De la même manière, à partir des axiomes non euclidiens se construit toute une géométrie. Il importe d’ajouter que le sujet connaissant ne peut pas créer n’importe quoi car ses théories doivent se rencontrer de manière satisfaisante (bien que toujours imparfaite) avec ce qui est.
La pédagogie Freinet me paraît être le soubassement d’une conception de la vérité telle que la définit Castoriadis, comme « création, toujours ouverte et toujours capable de revenir sur elle-même, de formes du pensable et de contenus de pensée pouvant se rencontrer avec ce qui est ». En effet, le tâtonnement expérimental, les recherches individuelles présentées à la classe rendent l’enfant sensible au fait que le savoir se construit au sein d’une communauté de recherche.
Cela exige un effort affectif important, d’accepter de comprendre que ce qu’on a cru vrai ne l’était pas, et de s’en détacher. C’est un travail intérieur. Il y a des gens qui n’y arrivent pas. Ils sont prisonniers d’un dogmatisme (religieux, mais aussi politique, scientiste…). Et même ceux qui ont une certaine labilité intérieure peuvent se trouver collés à certains objets tenus pour vrais, et éprouver une grande douleur à s’en détacher.
Un rapport au savoir tel qu’il apparaît dans la pédagogie Freinet ne permet pas au savoir de justifier le pouvoir hiérarchique, qui serait pouvoir de ceux qui savent. Cette conception est fondée sur l’idée qu’il y a du vrai quelque part, et que ceux qui lisent le vrai doivent commander. Un pouvoir fondé sur le savoir, c’est le mythe de la caverne chez Platon[6]. Ceux qui sortent de la caverne voient l’essence des choses, voient le vrai, puis ils retournent dans la caverne pour dire aux autres ce qu’il faut faire. Platon est un anti-démocrate, pour qui les philosophes-rois doivent gouverner la cité parce qu’ils ont reçu une éducation spéciale. Leurs idées relèvent de la science et pas de l’opinion.
3) Le rapport au travail
Aujourd’hui, la souffrance au travail est immense, à tous les échelons de la hiérarchie sociale. Patrick Coupechoux, dans son livre La déprime des opprimés[7], donne des exemples d’informaticiens complètement brisés, d’ingénieurs qui ne conçoivent plus rien, mais qui appliquent des procédures, comme le disait Florence Giust-Desprairies. Même à ces niveaux-là d’intelligence et de qualification, il y a un appauvrissement énorme du travail. La créativité n’y a plus sa place. On prive les gens de la possibilité d’exercer leurs capacités créatives. C’est un premier contraste flagrant avec la pédagogie Freinet, où la créativité est sans cesse encouragée.
Une autre dimension dont les gens sont privés dans le monde du travail aujourd’hui, c’est le droit de faire un travail qui a du sens. Freinet parlait du « vrai travail », qui donne sens aux efforts de l’enfant : des productions socialisées (la correspondance, le journal qu’on vend, un spectacle…). Combien de personnes en France actuellement, - parmi celles qui travaillent, parce qu’il y a toutes celles qui sont dans la précarité ou au chômage -, combien de personnes sont fières de ce qu’elles produisent ? A mon avis, une minorité. Beaucoup de gens savent qu’ils produisent des choses insignifiantes. Ils voient bien que la production à laquelle ils contribuent est source de problèmes sociaux, écologiques, liés à ce mode de production. Mais ils sont coincés : il faut bien faire bouillir la marmite. Il y a une souffrance terrible due au manque de sens, et pire encore, au fait que beaucoup de gens sont contraints dans leur travail de fabriquer des biens ou de proposer des services, tout en ayant conscience que ce faisant ils contribuent à détériorer encore davantage la situation sociale et écologique.
Pire encore, les méthodes de management sont devenues extrêmement perverses. Non pas au sens où il y aurait d’un côté de méchants pervers et de l’autre leurs victimes, mais au sens d’un fonctionnement pervers des organisations. Dans ce contexte de fonctionnement pervers, il arrive que des personnes manifestent des conduites perverses en cherchant une emprise sur autrui, parce qu’elles ont effectivement des traits pervers importants dans leur personnalité. Mais d’autres personnes, cadres ou responsables hiérarchiques, se comportent de manière perverse parce qu’ils sont eux-mêmes soumis à des exigences paradoxales, ou impossibles à satisfaire, qu’ils reportent sur leurs subordonnés.
Reprenons des exemples donnés par Patrick Coupechoux. Dans une entreprise, chaque matin lors de la réunion de direction, le dirigeant humilie à tour de rôle un des cadres présents, lui reprochant de ne pas avoir tenu ses objectifs. Des chargés de clientèle dans les banques allument leur ordinateur le matin et trouvent un message leur indiquant leurs objectifs de la journée : vendre tant de prêts à la consommation, tant de Sicav Unetelle, etc. L’informatisation, qui est formidable par certains aspects, permet aussi une surveillance généralisée des salariés. Tous les emplois de service y sont soumis maintenant. C’est bien connu dans le cas du démarchage téléphonique, où le temps à consacrer à chaque appel est prévu, avec exigence de rendre des comptes à sa hiérarchie si on le dépasse. En Belgique, une grande entreprise de transport routier a calculé la consommation moyenne des camions, que le chauffeur ne doit pas dépasser. Mais comme les camions sont souvent surchargés, comme ils peuvent être pris dans des bouchons, etc., il est fréquent que cette consommation prévue soit dépassée. Et ce sont les chauffeurs qui complètent le réservoir de leur poche, de crainte d’être sanctionnés, voire licenciés ![8] Voilà comment on fait travailler les gens aujourd’hui pour faire suer les milliards.
J’ouvre une parenthèse à ce propos. Actuellement, le profit remonte depuis la base de la pyramide sociale, les entreprises sous-traitantes, qui sont littéralement pressurées (et leurs salariés avec). Le directeur commercial d’une entreprise de sous-traitance automobile disait à la radio : « Je vends un produit à 100. L’année d’après, le constructeur me demande de le lui vendre à 97, sinon il ne renouvelle pas le contrat. Et puis l’année d’après, ce sera 94… » Le profit remonte ainsi vers les très grandes entreprises, celles qui sont cotées en bourse. Les entreprises du CAC 40 (les 40 plus grandes entreprises françaises) ont fait 100 milliards d’euros de bénéfices en 2008. On prévoit qu’elles feront 95 milliards de bénéfices en 2009, dont 40 % environ reversés aux actionnaires. Elles rachètent aussi leurs actions : 19 milliards de rachats d’actions en 2008. Une action, c’est un morceau de papier (on appelle ça du papier-valeur). Les actions rachetées par ces grandes entreprises ont été détruites ! Comme Gainsbourg brûlant son billet de 500 francs. Pourquoi ont-elles été détruites ? Parce qu’en diminuant le nombre d’actions, en les rendant plus rares, on fait grimper leur cours, et les actionnaires applaudissent... 19 milliards d’euros, c’est le déficit de la Sécurité sociale. Nous payons tous 1 euro à chaque fois que nous allons chez le médecin, 50 centimes par boîte de médicaments, l’âge de départ en retraite pour bénéficier d’une pension complète n’en finit pas de reculer… C’est tout ça qui est contenu dans ces 19 milliards de déficit de la Sécu. Eh bien, les entreprises du CAC 40 les ont brûlés, ces 19 milliards, pour que les actionnaires s’en mettent encore plus dans les poches au moment où ils vendent les actions qu’ils détiennent. Voilà où en est ce capitalisme sans projet. Voilà les décisions prises par les classes dirigeantes de notre société, à un moment où les défis sociaux et écologiques n’ont jamais été aussi aigus : faim dans le monde (un milliard d’êtres humains concernés, auxquels il faut ajouter deux milliards de malnourris), inégalités Nord-Sud, réchauffement climatique, pollutions diverses…Et chez nous, chômage, précarité, problèmes de logement… Je ferme la parenthèse.
Mettre les travailleurs sous surveillance, donc, pour mieux les exploiter, en les évaluant individuellement. Cette évaluation individualisée des performances met les salariés en concurrence généralisée, sur fond de chômage de masse où chacun voit dans l’autre un rival potentiel le jour où arrive la charrette de licenciement[9]. La conséquence de cette mise en concurrence des salariés, c’est la disparition de la solidarité et des collectifs de travail. Il y a un demi-siècle, il y avait déjà des patrons durs et des agents de maîtrise, mais en face il y avait
une certaine opacité du groupe de travailleurs, qui s’auto-organisait en partie, pour coopérer et parvenir à faire la production. Cette coopération informelle est indispensable, parce que si les travailleurs suivent les procédures prescrites, la production diminue de moitié. Le capitalisme ne fonctionne qu’avec le zèle des salariés, à qui il dénie pourtant toute intelligence du procès de travail, qui est leur imposé d’en haut par ceux qui savent. Cette coopération nécessaire qui avait lieu par le passé est en train de s’étioler, du fait de l’évaluation individualisée sur fond de crainte du chômage. Patrick Coupechoux donne l’exemple d’un atelier de construction automobile où on vient travailler sans pratiquement s’adresser la parole… Les directions d’entreprise détruisent délibérément les occasions de convivialité entre les salariés : elles ferment les restaurants d’entreprise, elles diminuent les pauses casse-croûte. C’est véritablement un fonctionnement pervers des organisations qui s’est mis en place. Ce serait intéressant de voir par quels biais ce type de fonctionnement est en train de gagner l’Education nationale, comme il a déjà fortement affecté les hôpitaux par exemple. Et aussi d’étudier les moyens d’y résister.
Inutile d’insister sur le fait que la pédagogie Freinet, elle, valorise au plus haut point les pratiques coopératives. Elle représente un contrepoint quasi absolu avec le monde actuel du travail, qui connaît, nous l’avons vu, une atrophie très importante de la créativité, du sens et de la coopération.
4) Le rapport à soi
La pédagogie Freinet induit un rapport à soi qui permet d’éprouver l’accroissement de sa puissance de vie, selon l’expression de Nicolas Go. Ainsi, l’évaluation en pédagogie Freinet n’est pas une évaluation qui abaisse ou qui détruit, comme l’est souvent l’évaluation individualisée des performances dans le monde professionnel. C’est une évaluation qui marque les progrès accomplis. Elle ne souligne pas les lacunes, mais les réussites. Evaluer les gens en les rabaissant est indispensable à la perpétuation de la société hiérarchique de domination dans laquelle nous vivons. Leur faire ressentir qu’ils accroissent leur puissance représente un danger majeur pour les pouvoirs établis. C’est donc un rapport à soi joyeux fondé sur l’estime de soi qu’expérimentent les enfants dans les classes Freinet.
D’autre part, ils y tiennent des rôles multiples, comme le montre ce texte de Fernand Oury :
« Dans la classe de niveau en calcul [qui regroupe les élèves préparant la même ceinture], il est l’égal des autres, lève la main pour parler et obéit au maître. Lors de la séance de lecture dirigée par Jo (qui est marron), il est encore subordonné [il s’agit d’un choix de textes dont le président est Jo]. Il ne l’est plus lorsque son texte est élu. S’il écoute les suggestions de ses camarades ou du maître, relatives à son texte, c’est lui qui décide de la forme à donner. Rien ne peut être imprimé qui ne corresponde à sa pensée. Dans l’équipe de travail, Marcel, ouvrier imprimeur, obéit sans discuter à Yvan, son chef d’équipe. En tant que responsable du lavabo, investi de la puissance du groupe, il fera tout à l’heure éponger l’eau que Jo ou Yvan auront pu renverser. De même, responsable des recettes, il ira réclamer l’argent dû par Mohamed ou par le maître. Il travaille au jardin avec Mohamed, mais c’est Mohamed qui est responsable : Marcel obéit. Il dirigera avec autorité tout à l’heure un jeu dramatique qu’il a inventé : les acteurs volontaires qu’il a « embauchés » obéiront au metteur en scène. Demain, au Conseil, Marcel parlera à son tour et obéira au président de séance. »
Il y a ainsi un travail incessant d’ajustement aux autres, une labilité permanente qui rend plus difficile de s’installer dans un aspect de sa personnalité, dans une dimension de son identité. C’est une chance que n’a pas M. Sarkozy, par exemple, qui est coincé dans un fonctionnement psychique donné.
5) Le rapport à autrui
Je partirai de cette citation de Guy Debord, pour qui nous vivons dans la société du spectacle, qu’il définissait de cette manière en 1967 : « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images »[11]. C’est un texte de Castoriadis qui m’a fait comprendre mieux ce que voulait dire Debord, texte où Castoriadis oppose le spectacle à la fête.
« La fête, […] création immémoriale de l’humanité, tend à disparaître des sociétés modernes comme phénomène social ; elle n’y apparaît plus que comme spectacle, agglomération matérielle d’individus qui ne communiquent plus positivement entre eux, et ne coexistent que par leurs relations juxtaposées, anonymes et passives, à un pôle qui est seul actif et dont la fonction est de faire exister la fête pour tous les assistants. Le spectacle, performance d’un individu ou d’un groupe devant le public impersonnel et transitoire, devient ainsi le modèle de la socialisation contemporaine, dans laquelle chacun est passif relativement à la communauté et ne perçoit plus autrui comme sujet possible d’échange, de communication et de coopération, mais comme corps inerte limitant ses propres mouvements. »
Imaginons une salle de cinéma avec une personne assise devant nous qui, très grande ou pas assez enfoncée dans son fauteuil, nous empêche de voir correctement l’écran… Ou encore songeons à notre expérience d’automobiliste, sans cesse gêné par les autres véhicules.
Au contraire du rapport social spectaculaire, la pédagogie Freinet amène l’enfant à éprouver autrui comme condition de son plaisir, et non comme obstacle à celui-ci. Elle le conduit à voir en autrui ce « sujet possible d’échange, de communication et de coopération » dont parle Castoriadis. Ce 49ème congrès de l’ICEM est un bon exemple : nous nous connaissons peu, mais il y règne une ambiance, une connivence, un souci de l’autre, une philia, aurait dit Aristote, c’est-à-dire « le lien que nouent l’affection et la valorisation réciproque »[13], même si nous n’avons pas de relations amicales personnelles.
6) La possibilité d’une transformation sociale
La pédagogie Freinet nous donne à voir des enfants qui changent à son contact. La plupart du temps, ils arrivent dans nos classes marqués par ce que Freinet nommait le scolastisme, qui fait mourir l’enfant « à la pensée, au sentiment, au cœur et à l’idéal sans lequel aucun être humain ne saurait se survivre dignement »[14] : l’enfant a fini par accepter les exercices trop souvent dépourvus de sens, l’évaluation permanente, l’interdiction de communiquer avec ses voisins… Et c’est ce même enfant qui, placé dans un autre milieu éducatif, reprend vie et se transforme, au bout de quelques mois. Il s’ouvre aux autres, son rapport à l’enseignant se modifie, il se remet au travail, emballé par la correspondance, le texte libre, la recherche mathématique. Il se sent valorisé parce qu’il peut à un moment « prendre la tête du peloton », comme disait Freinet. C’est le même enfant, mais il a changé.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’individu est toujours placé dans un contexte qui sollicite des aspects différents de sa personnalité, et fait s’exprimer des dimensions de soi dont il pouvait ne pas être conscient. Le contexte tire de nous des conduites différentes.
Fanny Morier : Ça me fait penser aux expériences de Milgram, sur nos réactions d’obéissance, quand on nous met à notre insu dans la situation d’exercer un pouvoir sur autrui.
Raphaël Doridant : Ce sont ces expériences où un scientifique dit au cobaye : « Vous devez enseigner des choses à cette personne, et si elle répond de manière erronée, vous lui enverrez de petites décharges électriques pour l’aider à se concentrer ». L’ « élève » est en fait un comédien, qui va manifester des signes de souffrance de plus en plus intense. Cela n’empêche pas que certains cobayes aillent jusqu’aux décharges électriques maximales… La question que je me pose à propos de cette expérience, c’est comment, après l’expérience, Milgram et son équipe ont fait avec la culpabilité et le malaise des gens qui se sont vus administrer les décharges maximales. Est-ce qu’ils avaient prévu ce qui s’est passé ? Comment ont-ils pris en charge la souffrance éthique qu’ont pu ressentir les cobayes ? Parce que dans le cas des entreprises et de leur fonctionnement pervers, pour revenir à la question du travail, on trouve des cadres qui adhèrent à ce qui se passe parce qu’ils ont effectivement des traits pervers, mais on en trouve beaucoup d’autres qui adhèrent parce qu’ils sont coincés dans un train de vie fondé sur le salaire que leur verse l’entreprise, et qu’ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Il y a une souffrance éthique de ces personnes qu’on oblige à traiter leurs subordonnés d’une manière que leurs valeurs morales réprouvent.
Le contexte Freinet tire autre chose des enfants que le contexte scolaire ordinaire. Et dans la société, c’est la même chose. L’espoir d’une transformation sociale, c’est qu’elle est possible avec nos contemporains. Bien sûr, il y a des aspects profonds de la personnalité qui demandent un travail sur soi pour être remodelés. Mais il y a aussi une part de soi qui peut se modifier en fonction du contexte. Je prendrai deux exemples. Tout d’abord, le travail du psychiatre et psychanalyste anglais Wilfred Bion avec les tire-au-flanc de l’armée anglaise, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nommé à la tête d’un service de rééducation pour soldats inaptes au combat pour des raisons psychologiques, Bion décide de proposer une structure différente aux 400 hommes concernés.
« Voici donc en bref le règlement qu’il promulgue en un meeting inaugural de tous les hommes : il va être formé un certain nombre de groupes qui se définiront chacun par un objet d’occupation, mais ils seront entièrement remis à l’initiative des hommes, c’est-à-dire que chacun non seulement s’y agrégera à son gré, mais pourra en promouvoir un nouveau selon son idée, avec cette seule limitation que l’objet en soit lui-même nouveau, autrement dit ne fasse pas double emploi avec celui d’un autre groupe. Etant entendu qu’il reste loisible à chacun, à tout instant, de retrouver le repos de la chambrée ad hoc, sans qu’il en résulte d’autre obligation pour lui que de le déclarer à la surveillante-chef. L’examen de la marche des choses ainsi établies fera l’objet d’un rassemblement général qui aura lieu tous les jours à midi moins dix et durera une demi-heure. […] bientôt, les hommes se prenant au jeu, un atelier de charpenterie, un cours préparatoire pour agents de liaison, un cours de pratique cartographique, un atelier d’entretien de voitures se constituent, et même un groupe se consacre à la tâche de tenir à jour un diagramme clair des activités en cours et de la participation de chacun, - réciproquement le médecin, prenant les hommes à l’œuvre comme eux-mêmes l’ont pris au mot, a vite l’occasion de leur dénoncer dans leurs propres actes cette inefficacité, dont il leur entend sans cesse faire grief au fonctionnement de l’armée, - et soudain la cristallisation s’opère d’une autocritique dans le groupe, marquée entre autres par l’apparition d’une corvée bénévole, qui, d’un jour à l’autre, change l’aspect des salles, désormais balayées et nettes, par les premiers appels à l’autorité, la protestation collective contre les tire-au-flanc, profiteurs de l’effort des autres, et quelle ne fut pas l’indignation du groupe lésé […] lorsque les ciseaux à cuir eurent disparu ! Mais à chaque fois qu’on fait appel à son intervention, Bion avec la ferme patience du psychanalyste renvoie la balle aux intéressés : pas de punition, pas de remplacement des ciseaux. Les tire-au-flanc sont un problème proposé à leur réflexion, non moins que la sauvegarde des ciseaux de travail ; faute de pouvoir les résoudre, les plus actifs continueront à travailler pour les autres et l’achat de nouveaux ciseaux se fera aux frais de tous. […]
En quelques semaines, le service dit de rééducation était devenu le siège d’un nouvel esprit que les officiers reconnaissaient chez les hommes lors des manifestations collectives, d’ordre musical par exemple, où ils entraient avec eux dans un rapport plus familier : esprit de corps propre au service, qui s’imposait aux nouveaux venus, à mesure du départ de ceux qu’il avait marqué de son bienfait. »
Le deuxième exemple concerne ce qui s’est passé chez Lip, à partir d’avril 1973, après l’occupation de cette usine de montres de Besançon par les salariés qui refusaient le licenciement d’une partie de l’effectif[16]. Ils ont occupé l’usine pour établir un rapport de force. Puis ils ont décidé de faire repartir la production. Ils recherchaient un patron qui garde tous les employés.
Chez Lip, les ouvriers vont prendre peu à peu des responsabilités dont ils ne se savaient pas capables. Le témoignage de Sylviane, 23 ans, employée de bureau, sur la transformation intérieure que ce mouvement a provoqué en elle et chez les Lip vaut la peine d’être cité :
« Ce qui est bien aussi, c’est que des gens vachement anonymes aient pris des initiatives. Il y a un horloger qui a remis en route le restaurant de la boîte. Ça, c’est sensationnel. Un jour, on a dit : « Bon, eh bien voilà, au mois de juillet, plus de restaurant. L’équipe de Jacques Borel est en vacances, il faut absolument manger puisqu’on fait une permanence. » Il s’est désigné volontaire. Il a commencé par faire des casse-croûtes, des sandwiches. Après, on est arrivé à l’assiette anglaise, puis ensuite on a fait des repas chauds. On mange aussi bien qu’avant, sinon mieux. C’est incroyable, il va commander sa viande, son pain, ses trucs comme s’il avait fait ça toute sa vie. […]
Il y a des tas de gens comme ça qui se sont découverts, tout au début, ne serait-ce que par les affiches. On a affiché dans toute l’usine, sur les vitres, proprement, on dessinait nos pensées, on dessinait des trucs vachement marrants. Là, on a découvert des talents inconnus, insoupçonnés, des gars qui travaillaient sur des machines, des gars vachement anonymes. Ils étaient là ; ils mettaient leurs petites affiches, avec des petits slogans, des petites phrases simples. Les gens se découvrent peu à peu des dons qu’ils ont et qui n’étaient pas mis en valeur du temps où ils travaillaient. […]
Chez Lip, il y avait des tas de gens qu’on connaissait, mais à qui on ne disait pas bonjour parce qu’on ne s’était jamais bien parlé ensemble. Maintenant, on connaît tout le monde. On se parle comme si on se connaissait depuis des années. D’ailleurs, on se connaît depuis des années, mais on ne s’était jamais parlé. […] On tutoie presque tout le monde. Tandis qu’avant, quand on était dans un bureau, c’était « Monsieur ». […] Maintenant, on se rapproche. L’amitié vient toute seule. Enfin, on devient camarades. C’est important de connaître tout le monde, de discuter. […]
Demain, quand on rentrera tous ensemble, on rentrera la tête haute, fiers d’avoir gagné ; moi, je rentrerai fière. Je travaillerai comme avant. Faut pas s’affoler, on aura toujours un chef sur le dos. Ça peut pas changer du jour au lendemain. Mais je crois qu’on aura notre mot à dire. Je crois que c’est vachement important, parce qu’on a prouvé quand même qui on était ; je crois que l’on ne sera pas des « anonymes » comme avant. »
Ne pas être des anonymes, ne pas être des exemplaires de travailleurs remplaçables, sur fond d’un chômage massif et organisé par les classes dirigeantes sous couvert des « lois de l’économie ». Des travailleurs qui s’entendent dire : « Si tu n’es pas content, tu peux t’en aller, il y en a dix qui attendent ta place ». Les dirigeants peuvent ainsi nous traiter comme des exemplaires et pas comme des êtres uniques.
Quelques mots pour conclure.[19] Aristote a écrit que, parmi tous les moyens d’affermir un régime politique, une « constitution » selon le mot qu’il emploie, le plus efficace est de « donner une éducation conforme aux <différentes> constitutions. Car aucune des lois les plus utiles ne sera du moindre profit, même si elle est ratifiée par l’ensemble du corps politique, si <les citoyens> ne sont pas dotés de dispositions, c’est-à-dire éduqués dans la perspective de la constitution, <dans une perspective> démocratique si les lois sont démocratiques, oligarchique si elles sont oligarchiques ». Aristote ajoute qu’ « avoir reçu une éducation conforme à la constitution […]est ce grâce à quoi [les oligarques] pourront gouverner oligarchiquement et [les partisans de la démocratie] vivre en démocratie »[20].Force est de constater que, globalement, l’école française est parfaitement cohérente avec la société française – il aurait été surprenant qu’il en soit autrement. L’enfant y apprend dès le plus jeune âge à concevoir comme allant de soi, comme « naturelles », les réalités qu’il rencontrera une fois devenu adulte : un pouvoir très peu partagé, un savoir tombé du ciel et accessible à de rares élus, un travail très souvent dénué de sens et ne permettant guère d’exercer sa créativité, une coopération découragée, une fragilisation permanente de l’estime de soi, un enfermement dans l’élément scolaire de son identité (qu’il soit « bon » ou « mauvais » élève) au détriment des autres aspects de sa personnalité, une relation à autrui rendue difficile et pouvant déboucher sur l’indifférence, voire la malveillance.
Je ne veux pas tracer un portrait en noir et blanc, avec d’un côté la bonne pédagogie Freinet, et de l’autre la mauvaise société, servie par la mauvaise école. Non, je pense sincèrement que le moment historique dans lequel nous sommes plongés est marqué, de plus en plus, par les traits que j’ai exposés. Cela ne rend que plus nécessaire de porter haut les couleurs de la pédagogie Freinet afin, dans nos classes comme dans la société, de contribuer à « créer les institutions qui, intériorisées par les individus, facilitent le plus possible leur accession à leur autonomie individuelle et leur possibilité de participation effective à tout pouvoir explicite existant dans la société »[21], ou, pour le dire à la manière de Freinet, afin de contribuer à l’accroissement réciproque de nos puissances de vie.
Discussion
Georges Tugène : l’idée d’une communauté de recherche sans personne en surplomb m’étonne un peu. Il y a quand même un maître qui se trouve en surplomb, non ? Je voudrais des précisions.
Raphaël Doridant : les enseignants qui se considèrent comme en surplomb et fondent leur autorité sur leur savoir peuvent se sentir complètement déstabilisés si leur savoir est remis en cause par un élève. Ils ont alors l’impression de tomber de leur piédestal. C’est très différent quand la classe est organisée en communauté de recherche. C’est important, par exemple, que les élèves voient l’enseignant chercher le sens d’un mot dans le dictionnaire. Ils constatent à ce moment-là que le maître ne sait pas tout et qu’il s’inscrit lui aussi dans une démarche de recherche du vrai et pas dans une accumulation.
Olivier Francôme : Gramsci, intellectuel communiste italien (mort en 1937) disait que le savoir devait être produit par ceux qui l’utilisent. Si on laisse à une classe, politique, sociale, la possession du savoir, alors elle dominera les autres. Chaque groupe doit posséder, utiliser et gérer ses propres savoirs. Dans la classe Freinet, cela signifie que les enfants doivent s’approprier les savoirs qu’on leur demande d’acquérir. Les savoirs ne doivent pas provenir d’une autre « classe » (celle des enseignants), mais c’est aux enfants de les découvrir et de les utiliser. L’idée des collectifs de recherche, des chercheurs collectifs, de l’entreprise apprenante vient de là : on essaie de mettre les gens dans une situation leur permettant de découvrir les modalités d’accès au savoir plutôt que leur donner directement les clés du savoir. C’est plus efficace. Prenons l’exemple de l’apprentissage de la langue française. C’est un apprentissage complexe, du fait de l’histoire de cette langue. Pourquoi y a-t-il des pluriels en « x » par exemple ? Parce qu’un scribe était payé plus cher quand il écrivait un « x » que quand il écrivait un « s »… C’est intéressant de le savoir, cela produit du plaisir d’apprendre, plutôt que de croire que c’est lié à des règles qu’il faudrait seulement connaître par cœur. Dans ma classe, les enfants fabriquaient des outils de mémorisation qui leur permettaient ensuite de retrouver des éléments de savoir. On faisait disparaître le dictionnaire et les enfants constituaient leur propre dictionnaire. Ils apprenaient à fabriquer des outils qui leur donnaient la possibilité de résoudre leurs difficultés. Ces outils étaient souvent plus efficaces. Le classement alphabétique a été choisi pour le dictionnaire, mais au détriment d’autres classements pas forcément moins pertinents. Le premier dictionnaire de l’ICEM est d’ailleurs fondé sur un classement par sons : « amphithéâtre » et « enfant » sont à la même page parce que ce n’est que si l’on connaît déjà la différence orthographique qu’on peut les chercher au bon endroit dans un dictionnaire ordinaire.
Participant : l’idée d’un savoir communautaire me paraît évidente. Mon beau-fils est chercheur, en thèse. Il est seul dans sa recherche. En classe, les enfants sont une vingtaine, alors forcément ils vont chercher ensemble, à condition que soient instaurés des moments de communication, des moments de partage de connaissances, des moments de réflexion. Chacun peut mener une recherche qui va s’enrichir par l’apport de quelques autres, mais qui peut être aussi complètement infirmée par les autres.
Raphaël Doridant : pour prendre un autre exemple : dans le cadre d’une recherche mathématique, un enfant veut savoir comment des figures grandissent. Il essaie de tracer des cercles qui grandissent. Il découvrira ensuite que c’est une homothétie. Il va d’abord faire des tentatives, qu’il présente à la classe lors de moments prévus à cet effet. Les autres enfants vont lui faire des suggestions, des critiques. Puis le groupe se remet au travail individuel. Le lendemain, si l’enfant a suffisamment avancé, il s’inscrit à une nouvelle présentation et explique à quelle étape il est parvenu. La part du maître, c’est d’aider l’enfant à repérer et à comprendre qu’une homothétie a un centre et un rapport. Parfois, l’enseignant se demande où va la recherche de l’enfant. Et il y a là une véritable communauté de recherche, parce que l’enseignant aussi est mis au travail : il doit comprendre quelles sont les démarches singulières de chacun et approfondir ses connaissances quand l’enfant aboutit à des questions pointues.
Dina Borel : on peut donc dire que le rapport au savoir n’est plus passif (on nous a transmis des connaissances que nous avons répétées, ou bien on nous a appris une règle de grammaire que nous n’avons pas eu l’occasion d’utiliser parce qu’on ne nous a pas proposé d’écrire quelque chose). Pour moi, le rapport au savoir dans la classe Freinet est un rapport actif et interactif. Il y a cette réflexivité qui est à la base de la communauté de recherche. Il ne s’agit pas d’une transmission passive de la connaissance et du savoir. Il s’agit d’une construction. Je ne dirais pas découverte, pour ma part. L’enfant construit, dans la mesure du bagage qu’il a déjà, puis il y a une déstabilisation de ce bagage, et l’enfant construit à nouveau, et ainsi de suite. C’est comme ça qu’il avance. Cela veut dire aussi que le savoir est une construction collective et un moyen par lequel l’enfant se transforme. C’est la dimension politique de tout ça : dans la classe Freinet, l’enfant n’apprend pas pour reproduire, il ne grandit pas sans avoir réfléchi, sans avoir pensé.
Raphaël Doridant : la dimension politique de ce rapport au savoir, c’est l’habitude prise très jeune par les futurs citoyens d’exiger qu’on leur démontre ce qu’on avance, d’exprimer des questions, des objections à ce qui est dit. Une attitude qui contraste avec celle qui consiste à écouter religieusement les « experts ».
Participante : ce qui m’attriste, c’est que les élèves des classes Freinet se transforment aussi quand ils retrouvent une classe ordinaire. Une fois adultes, ils se fondent dans la masse et applaudissent les « experts », comme les autres. Il y a des choses sans doute qui ont été intériorisées, mais je ne sais pas si cela peut être réinvesti automatiquement parce que ça demande un engagement politique pour sortir de la masse.
Raphaël Doridant : le contexte Freinet fait fleurir des éléments qui étaient présents chez l’enfant. Une fois sorti de ce contexte, ces aspects s’étiolent. Est-ce qu’ils vont resurgir si l’enfant est à nouveau plongé dans un contexte qui leur favorable ? C’est comme une plante mal en point qu’on remet au soleil. Tant que le contexte social sera ce qu’il est, il sera impossible de dire si ces enfants qui ont fait un chemin à l’intérieur d’eux-mêmes grâce à la pédagogie Freinet pourront retrouver ce qui a surgi en eux une première fois. En même temps, Michel Jeanningros citait le grand nombre d’anciens Lip qui ont aujourd’hui des responsabilités politiques municipales. Il racontait que pendant le premier conflit Lip, il avait fallu trouver 120 personnes (sur 830) pour aller populariser la lutte dans toute la France. Les premiers qui sont partis sillonner le pays ont été les délégués syndicaux, puis des membres du comité d’action. Mais leur nombre était encore insuffisant, alors ce d’autres Lip, moins engagés avant la lutte, peu ou pas habitués à prendre la parole en public, qui sont partis et qui se sont révélés en se découvrant capables de tenir des auditoires en haleine. La question, c’est comment on modifie le contexte social. Mais si, quand le contexte change, des tire-au-flanc de l’armée ou des travailleurs en lutte expriment d’autres facettes d’eux-mêmes, qu’ils ignoraient le plus souvent, c’est que la possibilité d’une transformation sociale profonde existe.
Participant : je crois que c’est une conclusion trop optimiste. Bien sûr, il y a une opposition terrible entre ce qui se passe dans nos classes et ce qui se passe dans la société. Mais croire que le petit coin de soleil qui brille dans nos classes, le petit coin de liberté, pourrait libérer la société, je n’y crois pas. C’est la bonne manière pour nous de survivre en tant qu’enseignants, de ne pas nous trahir nous-mêmes. C’est aussi une bonne chose pour les enfants qui sont là. Mais tant qu’on ne renversera pas le système économique, nous ne pourrons rien faire d’autre que de la survie. Et c’est important de survivre, c’est important que les gens qui pensent comme nous continuent à exister, sinon notre pensée va disparaître. Ce n’est pas possible que les barbares prennent le dessus tout de même ! Mais je ne crois pas que le petit rayon de soleil suffira à faire évoluer la société. C’est par d’autres voies qu’il faudrait la changer. En attendant, c’est important de continuer, pour nous-mêmes et aussi pour les quelques bénéficiaires. Car il ne faut pas se leurrer, ce ne sont que quelques bénéficiaires.
Participant : je vais mettre une petite note d’optimisme. J’ai assisté à une conférence de Ricardo Petrella, qui est italien mais qui vit principalement en Belgique. Il a fait énormément de recherches sur l’eau, d’un point de vue politique en particulier. Sa conférence portait sur l’école et l’apprentissage. Certains participants faisaient la même remarque que celle qui vient d’être faite. Petrella a répondu qu’il était tout à fait d’accord, ajoutant : « Pour le moment, nous sommes dans une période très noire, mais dans 20 ans ce sera peut-être gris, et dans 40 ans, ce sera tout à fait différent. Parce que nous vivons dans des cycles. Il faut espérer que le cycle que l’on vit pour le moment ne durera pas trop longtemps, et que nos enfants et nos petits-enfants connaîtront autre chose. » Voilà. Je ne sais rien dire d’autre. Mais j’ai cet espoir.
Raphaël Doridant : l’Histoire, c’est le domaine de la surprise. Quand Louis XVI convoque les Etats Généraux, il ne sait pas qu’ils déboucheront sur la Révolution française.
Participant : de même en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Personne ne s’y attendait.
Raphaël Doridant : ou Mai 1968. Quelques semaines auparavant, un éditorialiste du Monde écrivait : « La France s’ennuie ». C’est ça, l’Histoire. Alors que pouvons-nous faire ? La pédagogie Freinet, c’est un minuscule ruisselet souterrain, et puis à un moment donné, ça devient une source qui jaillit, et cette source peut donner naissance à un fleuve… Mais j’apprécie beaucoup ce qui a été dit sur le fait que c’est d’abord pour soi que l’on pratique la pédagogie Freinet, pour survivre dans ce monde, et aussi pour en faire bénéficier quelques enfants. Il s’agit de sauvegarder une petite part où l’on peut ne pas renoncer à ce que l’on croit.
[1] Aristote, Les politiques, Flammarion ,collection GF, traduction de Pierre Pellegrin.
[2] Sur la démocratie athénienne et son actualité contemporaine : Cornelius Castoriadis, La cité et les lois, Seuil, 2008.
[3] Sur tous ces points, je ne connais pas d’ouvrage de synthèse. On peut lire le dernier chapitre « La tradition révolutionnaire » du livre de Hannah Arendt, Essai sur la révolution, Gallimard, collection Tel.
[4] Cornelius Castoriadis, « Passion et connaissance », in Fait et à faire, Seuil, 1996, p. 140.
[5] Cette formule, due à Castoriadis, permet de rappeler que, dans la rencontre entre ce qui est et nos théories, il est la plupart du temps impossible de distinguer ce qui vient de l’objet (ce qui est « découvert ») et ce qui vient du sujet connaissant (ce qui est « créé »).
[6] Platon, La République, livre VII, 517-521.
[7] Seuil, 2009.
[8] Merci à Antonin qui m’a rapporté ce fait.
[9] Cf. Christophe Dejours, Souffrance en France, Seuil, 1998. L’édition de poche (Points Seuil) de 2009 comprend une préface et une postface lumineuses.
[10] Fernand Oury et Aïda Vasquez, De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, Maspéro, 1971 (réédition Matrice-Cépi, 2000, p. 412-413)
[11] Guy Debord, La société du spectacle, Gallimard, collection Folio, thèse n° 4 (première édition : 1967).
[12] Cornelius Castoriadis, « Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne », in Capitalisme moderne et révolution, tome 2, éditions 10/18, 1979, p. 168-169 (souligné par Castoriadis).
[13] Cornelius Castoriadis, « Transformation sociale et création culturelle », in Le contenu du socialisme, éditions 10/18, 1979, p. 439.
[14] Célestin Freinet, La santé mentale de l’enfant, Maspéro, 1978, p. 32.
[15] Jacques Lacan, « La psychiatrie anglaise et la guerre », article paru en 1947 dans L’Evolution psychiatrique, repris in Autres Ecrits, Le Seuil, 2001, pp. 109-111)
[16] Sur le premier conflit Lip, voir le beau film de Christian Rouaud, Les Lip, l’imagination au pouvoir, Les films du paradoxe, 2007.
[17] Souligné par moi (R.D.)
[18] Charles Piaget et les Lip, Lip, Stock, 1973, pp. 92-97.
[19] Cette conclusion n’a pas été énoncée lors de l’atelier. Il s’agit d’un ajout pour la version écrite.
[20] Aristote, Politique, V, 9, 1310-a, traduction de Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, collection GF, 1990, p. 383-384.
[21] Cornelius Castoriadis, « Pouvoir, politique, autonomie », Le monde morcelé, op. cit., p. 138.