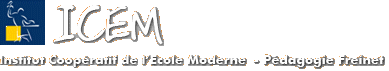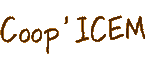Mai 2001
Peut-on adapter les principes, les bases du Compagnonage à la formation des enseignants ?
Partick Robo, après avoir présenté la pédagogie du Compagnonage, envisage sa transposition en matière de formation. A l’heure où se décide la réforme des IUFM, il semble que certaines des idées qu’il développe pourraient être mises en application rapidement.
Si, comme j'ai pu le lire et l'écrire par ailleurs, l'accompagnement en matière de formation est un terme (pour certains un principe, une conception…) de plus en plus usité - ce qui m'a conduit à développer le concept de"formation accompagnante" -, il est une notion qui émaille aujourd'hui de manière récurrente les discours dans le milieu de l'Education nationale, c'est celle de Compagnonnage.
Nous en trouvons trace par exemple, et entre autres, chez :
André de Peretti 1 dans son Rapport au Ministre de l'Education nationale de la commission sur la formation des personnels de l'Education nationale où il est question de compagnonnage comme démarche de formation.
Michel Develay 2 traitant de "la formation (qui) vise à aller au-delà de la prise en compte de l'individu pour s'intéresser aux personnes, dans leurs dimensions culturelles, mentales, affectives et dans leurs rôles sociaux. Il s'agit donc de penser la formation comme individualisée, dans le sens d'une auto-formation assistée mais de surcroît en faisant exister des temps non seulement d'assistance - avec ce que ce vocable possède de technique - mais des temps d'accompagnement - de "compagnon", qui partage son pain avec." Cette formation personnalisée conduisant à substituer "au formateur technicien, un formateur accompagnateur".
Philippe Meirieu 3pour qui "Seuls un véritable accompagnement scolaire, un compagnonnage pédagogique, inscrits dans une nouvelle professionnalité enseignante, peuvent redonner une chance à l'école de la République."
Evelyne Charlier 4 qui présente "Le compagnonnage, une expérience de formation continuée", dans un ouvrage lié à la "formation des maîtres", expérience dans laquelle une "équipe pluridisciplinaire de professeurs de l'enseignement secondaire et de chercheurs en éducation se réunissent périodiquement pour partager des expériences professionnelles et les théoriser afin d'enrichir les pratiques des uns et des autres".
Roger-Pierre Giorgi 5 évoquant le contrat qui lie l'Apprenti et le Compagnon, contrat fondateur de ce qui va devenir un acte de formation entre "l’ancien" et le "débutant" dans un système de formation inspiré du Compagnonnage lequel est tendu entre deux pôles contradictoires : sa permanence, sa conservation et son adaptation.
Jack Lang, Ministre de l'Education nationale qui, dans sa conférence de presse du 20 juin 2000, parle de l'importance décisive du "compagnonnage, dès l’école maternelle, avec les livres et les albums".
Ce terme de compagnonnage, employé de manière polysémique, mérite peut-être clarification et certainement réflexion. Qu'en est-il en effet des principes du Compagnonnage et de leur éventuelle transposition en matière de formation ?
Principes et bases
du Compagnonnage
Le Compagnonnage est une "association d'artisans et d'ouvriers offrant un enseignement et une assistance"6 qui a développé au fil des siècles des principes encore en vigueur chez les Compagnons contemporains. De ces principes liés à des valeurs que je dirais humanistes 7, de cette démarche je retiendrais ici ce qui a, ou peut avoir, un lien avec la Formation, l'Education.
La pédagogie du Compagnonnage
Comme le souligne Bernard de Castéra 8, la pédagogie du Compagnonnage est globale car prenant en compte toute la personnalité humaine. "Les étapes par lesquelles l'ouvrier est appelé à se perfectionner ne sont pas seulement techniques. Ce sont des étapes d'humanité. C'est à dire qu'elles sanctionnent des "états", et non pas une qualification purement technique. La technique n'est d'ailleurs pas dévaluée : comment le serait-elle quand elle est mise au service de l'homme ?".
L'auteur décrit quatre niveaux liés chacun à des attitudes, ainsi :
- Le Compagnon-aspirant : persévérance et goût du perfectionnement ;
- Le Compagnon : discipline et possession de soi ;
- Le Compagnon-fini 9: plénitude de la conscience et sollicitude envers les jeunes ;
- Maître d'œuvre : souci d'une pérennité des valeurs ouvrières et prise de conscience d'une vocation sociale.
Il est à noter que "l'enseignement chez les compagnons repose sur deux piliers : l'acquisition sur le tas d'une expérience immédiatement professionnelle et d'autre part ce qu'il est de coutume d'appeler le "trait", ce tracé de construction tout à fait original qui a pour particularité d'être à la fois une géométrie descriptive et la recherche d'une harmonie adaptée à la mesure de l'homme. L'art du trait et tout simplement l'art de dessiner tout ce que l'ouvrier a besoin de représenter graphiquement pour mener à bien son travail. Ce qu'il a besoin de se représenter et non pas le dessin idéal qui aurait en lui-même sa valeur propre et serait déjà, par lui-même une réussite."10
A noter également le modèle d'enseignement : "Le Compagnon n'enseigne pas ex cathedra, il "accompagne" - une forme de pédagogie qui exige une intelligence vivante et engendre des intelligences vivantes. Il s'agit d'un partage fraternel qui, dans certains cas, prend la forme d'une transmission de maître à disciple, si l'un a la maturité du maître, et l'autre la réceptivité du disciple. Et c'est le secret de l'efficacité du Compagnonnage."11
Quant à la certification, elle est ouverture et non clôture. En effet, comme le précise Bernard de Castéra, "souvent le diplôme signe l'arrêt de mort de la curiosité intellectuelle et de la recherche : au lieu d'être perçu comme un encouragement à apprendre, il est reçu comme le couronnement d'un savoir, comme une récompense, comme la finalité même de la recherche. Etre reçu Compagnon, au contraire, c'est s'engager dans un nouveau processus de perfectionnement."12
L'Apprenti
C'est celui qui est en situation d'apprentissage dans des écoles spécialisées et/ou chez un "Maître", et qui souhaite devenir un jour Compagnon. Cet apprentissage peut durer de deux à quatre ans et sera à la fois technique, pratique et culturel (culture professionnelle, culture sociale). Aujourd'hui l'apprenti devra détenir un C.A.P. et, si possible, déjà posséder une expérience du travail avant de prétendre à devenir Compagnon-aspirant. Il terminera son apprentissage par un stage de trois mois minimum chez des Compagnons avant de participer à une "cérémonie d'adoption" au cours de laquelle il présentera un travail (une maquette) et répondra à des questions afin de "mériter" ou non d'être accepté, reçu dans la communauté des Compagnons. Et comme l'écrivait Emile-le-Normand, Compagnon serrurier du Devoir, "cela n'a rien d'un examen de passage comme ceux qu'on peut subir dans les écoles. D'ailleurs, les Compagnons n'ont mis aucune note. Non, c'est la mesure de l'homme qu'ils ont cherchée. Certes, le travail présenté doit être de bonne qualité, conforme aux règles de l'art, présenté convenablement, mais il doit surtout témoigner d'un état d'esprit, d'un goût de l'effort et d'une disponibilité envers les autres. L'aspirant doit penser qu'il ne recherche pas la maîtrise du métier pour lui tout seul mais pour partager et transmettre ses connaissances comme le font ses aînés à son endroit."13
Ce sont donc des Compagnons du même métier qui apprécient la valeur professionnelle et humaine du candidat puis décident ou non de l'accepter dans l'assemblée compagnonnique.
Le Compagnon-aspirant
A l'issue de l'apprentissage, l'apprenti reconnu apte devient Compagnon-aspirant, statut qui va lui permettre de compléter et perfectionner sa formation initiale auprès de divers Compagnons en exerçant (s'exerçant) le métier dans différents lieux et ce en effectuant le "Tour de France". Ce "voyage" formateur, sorte de parcours individualisé, s'effectuera en même temps que d'autres Compagnons-aspirants ayant acquis plus ou moins d'expérience en fonction de leur itinéraire personnel.
A noter que pendant ce périple, les Compagnons-aspirants sont hébergés dans des établissemnts où ils trouveront le gîte et le couvert mais aussi des cours (du soir) leur permettant de compléter leur formation.
Ce qui laisse à penser que le Compagnon-aspirant se forme auprès d'experts (les Compagnons qui l'accueillent) et avec des pairs (les Compagnons-aspirants), donc la conjugaison d'une auto-formation, d'une formation et d'une co-formation.
Le Tour de France
Avec un statut d'ouvrier salarié, le Compagnon-aspirant à qui l'on donnera un surnom entamera un grand voyage, une aventure riche d'expériences et quelque part émancipatrice à travers le pays.
"Le cadre de la formation compagnonnique a pour nom le Tour de France. L'itinérant qui le parcourt est semblable à une abeille qui butine de fleur en fleur (les villes) pour apprécier et faire siens les sucs les plus fins (techniques et tours de main) afin, plus tard, de réaliser son miel (le chef d'œuvre)."14
Ce Tour de France, le "trimard", peut durer six ou sept années et présente plusieurs objectifs :
- "l'acquisition définitive d'un état, d'une “vacation” : il s'agit d'apprendre l'infinie variété des tours de main régionaux et de connaître la science des façons traditionnelles. Ecole de formation technique et morale, le tour de France inculque le goût du travail bien fait, préparant à la réalisation du chef-d'œuvre par lequel l'aspirant prouvera ses connaissances et ses capacités techniques."15
- "aller voir sur place comment chaque technique peut se justifier en fonction des particularités locales qui peuvent être, dans les constructions par exemple le terrain, le climat, les habitudes de vie locale quant à l'agencement des pièces, le style esthétique du pays, etc."16
- perfectionner son métier sans oublier qu' "un métier c'est beaucoup plus qu'une simple technique ; c'est un certain type de relation aux hommes, de présence à la société."17
- Avoir une meilleure connaissance des hommes. "C'est alors qu'apparaît une autre dimension du voyage : le dépassement du métier par une ouverture à la cité."18
Nous trouvons là une démarche de formation assimilable à un parcours personnalisé dans la multiplicité des approches et l'hétérogénéité des personnes et des savoirs.
Le Chef d'œuvre
"C'est la quintessence qui résulte de la possession totale d'un art ou d'une science ou des deux choses réunies dans un métier"19 ; c'est en quelque sorte la synthèse de ce qu'un Compagnon-aspirant a pu apprendre grâce à la formation compagnonnique et une épreuve lui permettant de prétendre au statut de Compagnon.
Et si "la prouesse technique fait partie du Chef d'œuvre, elle n'en est pas le tout. On doit pouvoir aussi y déceler des qualités humaines. Et quel qu'il soit, le Chef d'œuvre lui-même ne donne pas droit à être reçu Compagnon."20
Il est à noter que cette réalisation n'est pas simplement la reproduction ni l'application de savoirs acquis mais bien évidemment une création personnelle à partir d'acquis divers et "synthétisés" puis dépassés, transcendés.
Dans cette démarche de formation nous pouvons dire qu'on pont est jeté entre la tradition à l'innovation.
Le Compagnon
C'est donc au bout de quelques années que le Compagnon-Aspirant présente une réalisation personnelle et "une fois la critique du chef d'œuvre terminée, et après avoir écouté les réponses du candidat aux question posées par les Compagnons, l'assemblée procède enfin à la cérémonie de réception qui transforme l'aspirant en Compagnon (…) celui dont la connaissance est ouverte au métier."21
Le compagnon (reçu) cherchera alors à se perfectionner dans l'accomplissement de son métier en même temps qu'il transmettra ses savoirs par l'enseignement qu'il dispensera à des apprentis et/ou des Compagnons-aspirants qu'il accueillera ou embauchera.
Il est, pourrait-on dire, devenu "expert" dont la démarche relève à la fois de la praxis et du partage, voire du don qui avec l'esprit de fraternité et l'amour du métier constituent les trois éléments essentiels du Compagnonnage.
Le Compagnon-fini
La "finition", autre étape bien des années plus tard permettra au Compagnon de devenir Compagnon-fini, celui "dont la connaissance est ouverte à l'homme"22 et "pas celui dont il n'y aurait plus rien à attendre parce qu'il aurait tout donné. Il est celui qui, parvenu à sa pleine maturité du métier, peut donner toute sa mesure, qui est fécondité dans la Cité. Au surplus, cette mesure est celle de l'esprit communautaire dans le travail, ce qui ouvre à la notion d'élite. La véritable finalité du métier, c'est le service moral de l'homme."23
Le Compagnon-fini "sait bien que le Compagnonnage ne possède pas à lui seul toute les connaissances qui font une civilisation - laquelle est toujours l'œuvre d'une communauté. Le Compagnonnage n'a pas son but en lui-même. Il trouve sa finalité ultime dans la réalisation d'une Cité, avec les autres hommes qui ont une formation et une tradition différentes et complémentaires."24
Nous pourrions dire de lui qu'il a accédé à un niveau de maîtrise qui permet de lui reconnaître un statut de "maître" lié a la "sagesse".
L'Outil
Nous ne pouvons terminer cette approche du Compagnonnage sans évoquer l'outil. En effet, "dans ce rapport sacré de l'homme aux choses qu'il façonne, si un objet doit être privilégié, c'est bien l'outil. Prolongement de la main, il est l'expression par excellence de l'intelligence pratique. Acolyte du geste ouvrier, il exprime la servitude et la grandeur du métier. Par sa forme et son volume si précisément liés à sa fonction, l'outil est aussi l'éducateur du geste."25
C'est ainsi que souvent le Compagnon façonnera ou fera façonner à sa demande les outils dont il a besoin pour exercer son métier, outils qu'il fera évoluer si nécessaire en fonction de l'évolution du métier ou de son niveau d'expertise.
Quelle(s) transposition(s) en matière de formation ?
La question que nous pouvons nous poser est bien celle de savoir si les principes, les bases du Compagnonnage peuvent être au service de la Formation d'adultes, de la Formation d'enseignants…
Une première façon d'y répondre peut consister à tenter d'établir des parallèles ou de trouver des similitudes entre Compagnonnage et Formation d'enseignants.
La pédagogie de la Formation
Depuis les Instructions officielles de 1972 définissant la Formation continue des enseignants en passant par la Loi d'Orientation du 10 juillet 1989 jusqu'aux évolutions récentes du système de formation dans l'Education nationale et au projet actuel de transformation de la formation des enseignants… nous pouvons avancer que la pédagogie de la formation d'enseignants, l'andragogie, est envisagée, comme dans le Compagnonnage, sur une approche globale de la personne (en formation et à former/éduquer) et qu'elle ne se veut pas simplement technique.
Les étapes
En ce qui concerne les étapes-niveaux des différents statuts de l'enseignant en formation, nous pourrions penser à :
- L'Etudiant "P.E.1" en formation à l'IUFM ou ailleurs qui serait par comparaison un "Apprenti". Le concours (C.R.P.E.) étant l'épreuve qui permet de devenir Compagnon-aspirant et le dossier professionnel étant la maquette présentée comme première pièce réalisée.
- Le Professeur des Ecoles Stagiaires "P.E.2" en formation à l'IUFM pouvant être assimilé au Compagnon-aspirant. (Mais peut-on dire que le mémoire professionnel réalisé en P.E.2 ou une séance d'enseignement présentés à des formateurs puissent être considérés comme un "chef d'œuvre" ?) ;
- Le Professeur des Ecoles sorti de l'IUFM tout comme l'enseignant en poste depuis plusieurs années seraient considérés comme des "Compagnons" ;
- L'enseignant devenu maître-formateur pourrait, quant à lui, être assimilé au "Compagnon-fini".
Le "Trait"
Si nous évoquons le "trait", nous pouvons penser aux fiches (ou autres outils) de préparation qui permettent de bâtir, envisager un temps et des contenus d'enseignement ou de formation, à la fois "géométrie" descriptive et recherche d'harmonie adaptée à la mesure des élèves ou des stagiaires.
Le modèle d'enseignement
Le modèle d'enseignement ou de formation que sous-tendent la Loi d'Orientation de 1989 et les recherches en Sciences de l'Education incitent à un enseignement ou une formation qui ne soient pas systématiquement ex cathedra mais plutôt de type "accompagnant" et à une pédagogie ou andragogie qui exige une intelligence vivante et engendre des intelligences vivantes.
Le Tour de France
Le Tour de France pourrait faire penser aux quelques stages de la formation initiale, qu'ils soient de "pratique accompagnée" ou "en responsabilité" et aux rares stages en formation continue qui permettent d'aller travailler, se former dans la classe d'un pair dans son école ou dans d'autres écoles du département…
L'Outil
Pour ce qui est des outils le parallèle est aisé à réaliser en pensant à ceux dont se dote le formateur, l'enseignant, outils qu'il a réalisés à la lumière de son expérience, de sa pratique professionnelles.
Le Chef d'œuvre
Quant au chef d'œuvre, pourrions-nous penser peut-être au mémoire professionnel ou à la création d'un outil ou document pédagogique ou à un mémoire universitaire en liaison avec le métier, ou à la présentation d'une recherche ou d'une démarche pédagogique innovante…
Une deuxième façon de répondre à la question relative à la transposition des principes et bases du Compagnonnage à la Formation des enseignants est d'envisager des évolutions de cette dernière qui s'inspirerait de la formation compagnonnique.Utopie ? Essayons.
L'Apprenti
Actuellement le temps d'apprentissage est d'une année avant le C.R.P.E.
Il pourrait être de deux ans en prévoyant une épreuve d'admission en première année et un concours à l'issue de la deuxième année délivrant un certificat d'aptitude à l'enseignement. Le contenu et l'ingénierie de cette préparation-formation au métier d'enseignant seraient à penser de sorte qu'ils ne confinent pas au "bachotage" en vue d'une épreuve mais plutôt qu'ils préparent, initient avec efficience à la prise de fonction suite à la certification de fin de deuxième année.
Les étudiants seraient l'équivalent des "apprentis" durant ces deux années.
Le Compagnon-aspirant
Dans le système actuel, l'enseignant admis comme Professeur des Ecoles serait considéré, dès la sortie de l'IUFM, comme Compagnon-aspirant et pourrait être nommé sur un poste en doublette par alternance avec un autre P.E. lui aussi récemment sorti de l'IUFM. Ainsi ils "se remplaceraient" mutuellement sur la même classe (équivalent de deux mi-temps) et pendant que l'un aurait la responsabilité de la classe, l'autre serait "en stages" dans des classes de "pairs" (Compagnons-aspirants) ou d'ex-pairs / experts (Compagnons ou Compagnons-finis). Resterait à étudier les modalités les plus judicieuses et performantes pour cette formation en alternance. Ce temps "hors temps de présence devant les élèves" serait également mis à disposition pour conduire un travail de recherche ou de production… qui mènerait vers le "chef d'œuvre".
Le Compagnon
Dans notre hypothèse ce serait l'enseignant qui aurait produit "son" chef d'œuvre et l'aurait présenté à des pairs et experts qui en auraient admis la pertinence et la validité. Ainsi reconnu il serait alors en mesure d'accueillir des étudiants-apprentis dans sa classe en tant que "Maître d'Accueil Temporaire" ou des "Compagnons" (pairs) dans le cadre d'une co-formation ou d'une mutualisation de pratiques, voire d'une recherche.
Le Compagnon-fini
C'est l'enseignant-compagnon qui serait reconnu, selon des modalités à préciser, pour sa compétence professionnelle en matière de formation ou de recherche. Il acquérait alors le titre et/ou le statut de "Maître-formateur" ou d' "Enseignant-chercheur". Compagnon-fini il serait alors en mesure de former des Apprentis mais aussi des Compagnons-aspirants et des Compagnons… ce qui ne lui interdirait pas de poursuivre des recherches ou de produire des documents.
J'en resterai là, dans ce temps de questionnement et d'hypothèses, certains que ces transformations du système de formation ne sont pas prêtes (mûres) pour être envisagées. Mais il n'est pas exclu de poursuivre, comme je le fais par ailleurs, une réflexion sur des modalités de formation inspirées du Compagnonnage,modalités qui favorisent à la fois transmission et mutualisation, assimilation (de savoirs) et créativité, technicité et humanisme, perfectionnement et accompagnement… Ainsi des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, des groupes contractualisés de recherche-action, des tutorats, des stages par réciprocité dans des classes de pairs, une année de "remplacements-formation" permettant d'effectuer un "Tour… du département" (sorte de "TRBD-FC" pour remplacer des enseignants partant en formation et pour se former soi-même), etc. Et pourquoi ne pas penser aussi à des "dispositifs d'accompagnonnage" au service d'une formation continuée ?
Patrick Robo
Groupe Départemental 34
1De PERETTI, A. (1982). Rapport au Ministre de l'Education nationale de la commission sur la formation des personnels de I'Education nationale, La Documentation française, Paris.
2 DEVELAY M., Peut-on former les enseignants ?, ESF, Paris, 1994.
3 MEIRIEU P., Lettres à quelques amis politiques sur la République et l'état de son école, Paris, Ed. Plon, 1998.
4 CHARLIER, E., Le compagnonnage, une expérience de formation continuée, in Gather Thurier, M & Perrenoud, P.(Éds.), Savoir évaluer pour mieux enseigner. Quelle formation des maîtres? Service de la recherche sociologique, Cahier n°26, Genève, pp. 69-73, 1988.
5 Intervention lors du stage du Plan National de Formation "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec un public difficile" à MEZE (34) du 27 au 31 mars 2000.
6 Encyclopédia Universalis
7 qui placent la personne humaine et ses valeurs au-dessus de toute autre valeur (Petit Larousse).
8 CASTERA de B., Le Compagnonnage, Paris, PUF Que sais-je, 1996, p. 88.
9 Pour certains, il s'agira du "Maître".
10 CASTERA de B., ibid, p. 78.
11 CASTERA de B., ibid, p. 96.
12 CASTERA de B., ibid, p. 95.
13 LANGLOIS dit Emile-Le-Normand, Compagnon du devoir, Paris, Flammarion, 1983, p. 97.
14 ICHER F., Les compagnons ou l'amour de la belle ouvrage, Gallimard Découverte, Paris, 1995, p. 65.
15 Encyclopédie Hachette Multimédia.
16 CASTERA de B., op. cit., p.36.
17 CASTERA de B., ibid, p.65.
18 CASTERA de B., ibid, p.65.
19 LANGLOIS, ibid, p. 194.
20 CASTERA de B., op. cit., p. 102.
21 ICHER F., op. cit., p. 75.
22 ICHER F., ibid, p. 75.
23 CASTERA de B., ibid, p. 103.
24 CASTERA de B., ibid, p. 106.
25 CASTERA de B., ibid, p. 119.
26 ROBO P., L'analyse de pratiques professionnelles - un dispositif de formation accompagnante - article à paraître dans la Revue "VIE PEDAGOGIQUE" du Ministère de l'Education du Québec. (http://www.meq.gouv.qc.ca/vie_ped/)
Auteur :