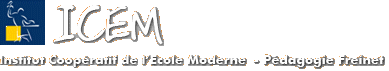Juin 2001
« ...m’man, je retournerai pas à l’école parce que à l’école on m’apprend des choses que je sais pas. »
M. Duras La pluie d’été.
Je suis de ceux qui ont eu l’occasion de bénéficier des bienfaits de l’école républicaine. Res publica : la « chose publique », entité culturelle par excellence, signe l’existence d’une aire publique et d’une aire privée dans les sociétés humaines. Et l’école républicaine, premier choc avec l’ère publique, m’a sauvée de l’enfermement familial et des idées reçues. Par chance cet environnement n’était pas toxique et chez une bonne partie d’entre mes proches l’école était en honneur. On disait qu’elle permettait « d’apprendre », qu’elle permettait l’accès aux « études », ce dont avaient été privés mes ascendants du fait de leur appartenance sociale. Ceux dont la parole comptait pour moi compensaient ce manque par la lecture afin de glaner des connaissances pouvant nourrir leur esprit critique vis à vis des idées reçues. L’expérience leur avait appris que celles-ci étaient souvent erronées. « Apprends pour être quelque chose » disait mon oncle. L’école est ainsi venue fonctionner comme un « tiers symbolique » entre mon milieu d’origine et l’inconnu...J’ai eu la chance d’y rencontrer quelques figures qui ont su soutenir mon désir. Les autres me rendait muette et stupide.
A l’école il y avait des gens qu’on appelait des instituteurs. Ce beau titre a disparu au profit d’un autre, celui de « professeur des écoles ». Je le regrette car les titres d’instituteur et d’institutrice venaient rappeler, pour qui a des oreilles pour entendre, que les instituteurs avaient pour fonction d’instituer des héritiers (culturellement parlant).
Sorti de l’aire protectrice (ou menaçante) de l’institution familiale (ou de ce qui en tient lieu) l’enfant découvre à l’école des discours différents que les discours familiaux et familiers, auxquels s’ajoutent ceux de la télévision et de tous les « médias » auxquels ils sont livrés, lesquels ne sont pas sans laisser des traces dans sa façon d’être face au savoir et à l’ignorance. Confronté au travail qu’exigent les acquisitions de connaissances, aux outils qui vont permettre ces acquisitions (écriture, lecture, calcul etc...) ainsi qu’aux règles de l’institution, l’enfant peut manifester du refus comme il peut acquiescer à l’effort et travailler. Il peut ou ne peut pas renoncer aux théories imaginaires dont il est habité pour s’enrichir des découvertes qu’il pourra faire sous la houlette de ceux qui lui en offrent les moyens. En échange d’une initiation au sens des choses et une connaissance plus exacte de leurs causes il lui faudra renoncer à l’ignorance et aux faux savoirs. Mais comment fera-t-il si l’école ne lui « parle » pas, si ceux qu’il y rencontre ne l’accueillent pas, s’il reste sourd à leurs discours ? S’il ne peut que refuser l’influence de ce « tiers » ?
Premier lieu de l’expérience de la « chose publique » et de la vie sociale, l’école est un lieu où tous les petits humains se frottent à d’autres humains de leur classe d’âge en vue de trouver leur place sociale. Chacun découvre d’autres discours, d’autres langages, d’autres moeurs que ceux auxquels l’ont initié sa vie privée. Porté par le désir de ses géniteurs mais aussi guidé par son propre désir, l’enfant va aimer ou non ce lieu et ses objets, il va « payer » ce qu’il aura envie d’acquérir. Mais comment payer quelque chose dont on n’a pas envie ?
Les êtres humains dont les conduites ne sont pas programmées par l’instinct comme les animaux sont pris dans un double héritage : biologique certes, mais aussi symbolique. Les questions des tout-petits sur le sens, sur les causes et sur les fins (leurs pourquoi et leurs pour quoi) en témoignent. Leur rapport au monde est médiatisé par le langage qui fonde leur aptitude à imaginariser. Comment vont-il substituer aux fictions purement imaginaires des fictions théoriques ? Comment leur vocabulaire va-t-il s’enrichir de celui offert par l’école si les mots entendus sont pour eux vides de sens et s’ils n’aiment pas la langue ? Le langage ne relève pas d’un apprentissage mais il est le fruit d’une transmission où se noue le jeu des désirs réciproques des protagonistes qui sont les acteurs de la scène, au premier chef les parents, présents ou absents. Les interlocuteurs que les enfants vont rencontrer sur la scène publique sont différents des parents. Que représentent-ils pour l’enfant ? Les « supposés savoir » de l’école leur parlent avec des mots souvent inconnus...Et puis il y a les petits « copains » et leurs façons de dire et de faire. Et il y a les règles imposées par l’école. Certains sont prêts à les accepter, d’autres pas. Certains sont curieux, d’autres pas. Certains répondent aux injonctions des professeurs, d’autres pas. Certains sont attentifs, d’autres pas. Certains disent oui, d’autres pas... La « dette symbolique » est diversement entendue par les uns et les autres car chacun est d’abord la proie des images dont il est habité.
C’est Freud qui nous a appris que les images et les représentations dont le psychisme du sujet est constitué, sont les fruits de nos premières perceptions et des effets de parole qui, depuis notre naissance (et même avant) soumettent notre entendement aux discours de notre entourage. Si les images se situent sur le versant de la fantaisie, sans lien à la réalité, les représentations, elles, sont médiatisée par un signe, un signifiant qui relève du registre du symbolique. Elles renvoient de ce fait à une « autre scène », de l’ordre de la réalité, même si cette réalité est modifiée par les affects qui en ont infléchis la perception. Habités d’images (constructions fantasmatiques) et de représentations (qui présupposent d’une réalité) nous sommes les héritiers d’une transmission symbolique, lourde d’avatars, qui nous institue dans la culture. Dans quelle culture ? Celle de notre milieu d’origine pour commencer. Celle qu’il faudra relativiser et quelquefois quitter.
Du côté de l’anthropologie structurale la culture est définie comme un ensemble de systèmes symboliques. Les systèmes symboliques sont des systèmes de représentations. Ils permettent de représenter ce qui exsiste et ce qui est absent. Chacun vient à l’école avec un bagage préalable, habité ou non de l’amour du symbolique, en proie aux obstacles de ses images préconçues, prêt à entendre ou non des discours qui évoquent l’absence, la séparation, l’abstraction. Toute connaissance et toute parole sépare : elle sépare les mots et les choses ainsi que les choses entre elles.
Dans le texte de la Genèse il est écrit que Dieu créa le monde. On peut prendre ce texte à la lettre. On peut aussi entendre que ce texte nous signifie que c’est par la nomination qu’une Parole différencie les parties qui constituent l’univers. Le signifiant sépare. Articuler le mot « lumière » et « ténèbres » sépare le jour et la nuit. Quand Dieu, cet Autre d’où vient la Parole et qui représente la puissance, établit une séparation entre les eaux, il appelle « cieux » l’étendue du dessus. Puis il rassemble les eaux du dessous qu’il nomme « mer » et les différencie du sec qu’il nomme « terre ». Il procède de même pour les autres objets de la « création » qui se mettent à exister par le fait qu’ils sont nommés. C’est le mot qui représente la chose. Mais la « chose » peut être de l’ordre du réel comme elle peut être une image forgée par notre capacité à fantasmer. C’est pourquoi il ne suffit pas qu’il y ait de l’énoncé pour qu’il y ait du sens, car la transmission de celui-ci bute sur des obstacles imaginaires dans lesquels le sujet est pris. L’accès au savoir implique le deuil des faux savoirs ainsi que nous l’a appris Bachelard.
L’anthropologie structurale et la psychanalyse, de même que certains linguistes ont mis en lumière l’importance du langage et des paroles dans le « destin » d’humanisation des membres de l’espèce humaine. Lévi-Strauss argumente l’universalité de l’interdit de l’Oedipe, du fait d’un « ordre symbolique » dans lequel tout ce qui est humain est pris.
Les théories de la communication ont tendance à considérer le langage comme un code et réduisent le sujet à un émetteur ou à un récepteur. Elles visent à « faire passer un message ». Subtilement totalitaires elles font violence au récepteur pour qu’il accepte le message de l’émetteur. Cette acceptation n’est souvent qu’une répétition. L’aliénation est de la partie. Aussi n’est ce pas étonnant que ces théories rencontrent un tel écho. Elles s’inscrivent dans la logique de tous les pouvoirs.
D’autres théories sont disponibles qui soulignent le primat du langage, l’importance de la parole du sujet et les graves dommages, psychiques et sociaux, qui résultent de l’ignorance, du mensonge et de la tromperie qui sont des formes de rupture du pacte symbolique. Pour Benvéniste : « Le langage représente la forme la plus haute d’une faculté qui est inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser ». Dans cette perspective théorique le langage est au fondement même de toute culture. Il permet de représenter le réel et médiatise notre rapport au monde, notre rapport à autrui et notre rapport à nous-mêmes. Ce rapport n’est jamais naturel, il est culturel. Nous parlons parce qu’on nous parle. Mais parlons-nous de la même chose ? Des obstacles à l’échange de sens se situent dans l’entendement des deux interlocuteurs, chacun étant un sujet pris dans une histoire et des références culturelles différentes.
Pour ma part je rapprocherais le texte de la Genèse, dès lors qu’on le lit comme une métaphore, de ce qui se passe pour « l’infans » (celui qui ne parle pas) quand des signifiants (qui précèdent le sens) viennent éclairer les ténèbres de l’ignorance. Ces signifiants qui ne sont pas encore des paroles sont articulés par un autre être humain. Freud désigne cette figure dont émanent les premiers signifiants, par le terme de « Nebenmensch ». Celui-ci est un « autre objet », perçu par le sujet qui le perçoit comme un sujet « semblable » à lui, c’est à dire « un être humain ». Ainsi se dessine la genèse du lien objectal par le fait que « c’est un objet du même ordre qui a apporté au sujet sa première satisfaction (et aussi son premier déplaisir) et qui fut pour lui la première puissance ». Car cet « objet » supposé bienveillant ou malveillant, est puissant. Freud souligne que « l’éveil de la connaissance est donc dû à la perception d’autrui ». Faisant la différence entre tous les autres qui sont comme nous (à notre image, pris dans l’immobilité de l’image) et cet Autre là qui se situe dans la lignée de la première puissance, Lacan va le désigner par le terme de « grand Autre ». Il précise qu’il parle d’un lieu qui est celui du « trésor des signifiants ». Il est à la place d’un « tiers ».
Nous noterons l’importance de cet Autre (matrice de tous ceux qui viendront se situer, pour tout sujet, dans une série où se réactualise cette figure des origines) et ne manquerons pas de souligner le poids particulier de sa parole comme parole d’un Autre. C’est ainsi que pour ma part j’argumenterais le différence entre l’autorité et le pouvoir. Si celui ci est fonction d’une place, d’un statut dans l’ordre de la réalité hiérarchique, l’autorité elle, repose sur le fait que, dans sa réalité psychique, le sujet met à une place d’« Auctor » (celui qui est à l’origine, celui qui fait croître) cette figure de l’Autre. Cette figure peut être enrobée de fantasmes, menaçante et toute-puissante, sur le versant imaginaire. Elle peut aussi être perçue comme un repère symbolique fiable, dont la parole est juste et non trompeuse. Quoi qu’il en soit elle inscrit le locuteur dans la lignée de ceux dont la parole a un pouvoir d’influence.
Cet Autre peut être investi de confiance comme il peut susciter de la méfiance. L’ignorance nous fait succomber quelquefois à un attachement sur fond de séduction, voire de fascination. L’envie de ne pas savoir nous invite à l’aliénation à tous les puissants « supposés savoir » dès lors que leur parole nous berce. Celle de certains hommes publics vient subjuguer les masses par le seul fait de l’énonciation qui ne fait que conforter l’ignorance et les préjugés qui nous habitent. L’expérience médiatisée par une réflexion critique et par le fruit de nos acquisitions symboliques, c’est à dire par l’étude, nous permet de repérer si la parole de l’Autre est trompeuse, si elle respecte ou non le pacte symbolique du lien entre le mot et la chose.
Rappelons que le contraire de symbolique c’est diabolique. Ce qui nous renvoie à la double fonction de la parole qui sert à « cacher ses pensées » comme le disait Talleyrand, qui peut être au service de la tricherie et de la tromperie, afin de séduire et de dévoyer pour mieux soumettre, comme elle peut ouvrir la voie d’associations imprévues, de nouvelles élaborations où l’esprit découvre de nouvelles saveurs. Quoi qu’il en soit, si la confiance est ébranlée par des paroles trompeuses le sujet, lui-même ébranlé, devient la proie de la méfiance.
Confiance et méfiance sont des effets de transfert. Dire cela implique l’hypothèse de l’inconscient. Dans cette perspective théorique nous entendrons que ce qui s’est inscrit dans notre insu à l’origine se réactualise. Le lien transférentiel se noue, par un retour du refoulé, vis à vis de ceux qui sont supposés savoir ou pouvoir. Il peut être positif ou négatif, sur le versant de l’amour ou de la haine. C’est l’amour de transfert qui incite le sujet à l’amour du « savoir supposé » de l’Autre et à l’investissement de son désir dans l’étude et dans la connaissance, sur fond d’identification et d’attachement. C’est l’amour de transfert qui permettra au désir de savoir d’être plus fort que le désir de ne pas savoir. Et si le désir est à l’œuvre le sujet paiera le prix qu’il faut pour acquérir les objets de son désir. Les enseignants sont transférentiellement investis. S’adressent à eux l’amour ou la haine de l’autorité dont le sujet est habité en référence à cet Autre des origines.
« Enrichissez-vous » lançait Guizot, ministre de Napoléon III. Je transposerai volontiers cette injonction dans le domaine de l’enrichissement symbolique. Quel que soit notre milieu d’origine l’école est le lieu où le sujet peut acquérir les outils de cet enrichissement. Malheur à ceux qui n’y ont pas été préparés par l’action éducative familiale et par le fait d’échanges de paroles avec leurs « répondants », et dont l’exigence éthique est restée en friche. Si le devoir d’enrichissement symbolique (qui ne croît pas à coup d’injonctions) n’est que lettre morte quand l’enfant arrive à l’école, l’enfant ne peut que s’y ennuyer. Nous n’oublierons pas que l’étymologie d’ennui, « inodiare, in odio esse » signifie être un objet de haine. La haine peut-elle donc être à l’œuvre sur la scène où se joue l’initiation au savoir ? Certes oui ! Elle peut viser les objets symboliques comme ses représentants. Elle peut viser le sujet lui-même comme elle peut viser ses pairs. La haine du savoir et le poids des blessures et des carences symboliques inscrivent quelquefois au cœur du sujet la passion de l’ignorance. Si aucune domestication pulsionnelle n’a été ébauchée au préalable ne restent alors que la jouissance des satisfactions pulsionnelles immédiates et la jouissance des scénarios imaginaires qui confortent l’ignorance. Car dès lors que les mots manquent ce qui reste ce sont les passages à l’acte.
Nous sommes bien obligés de reconnaître que le nombre des handicapés symboliques est très élevé dans nos sociétés contemporaines et que c’est ce nombre qui pose problème. Notre propos ne vise pas à en analyser ici les causes ni le sens, sauf à souligner que nous y voyons le signe d’un malaise social particulièrement fort. Certes, le « malaise dans la culture » n’est pas en lui-même un phénomène actuel. Il s’assortit toutefois, dans nos sociétés industriellement avancées, de menaces particulièrement dommageables pour le sujet : menace d’aliénation, de marginalisation grandissante, voire d’exclusion...avec leur cortège de conséquences traumatiques sur le plan matériel comme sur le plan symbolique.
Comment l’école, frappée de plein fouet par le « malaise » actuel, peut elle offrir les conditions d’un investissement symbolique, c’est à dire culturel, seul moyen de sublimer la violence et de réduire l’ignorance ? Sans doute faudrait-il des méthodes et des techniques spécifiques pour que l’organisation de la classe favorise la « réparation » de ce qui a été gravement blessé, et puisse permettre une « reprise » des trous qui handicapent l’enfant. Des méthodes incluant la dimension éducative au souci pédagogique et une organisation instituant d’autres rapports aux uns et aux autres ainsi qu’au savoir, permettent quelquefois à l’enfant de remanier des défauts de structuration et de découvrir des raisons de tenter sa chance dans la vie. Toute une réflexion se déploie à ce propos. Le problème dépasse, de mon point de vue, celui de la réflexion qui se fait autour de la didactique. C’est toute la philosophie de l’institution pédagogique et éducative qui mériterait d’être revue. Ainsi que la question des finalités de l’enseignement : acquisitions de connaissances ou initiation culturelle ? être « bon » élève ou prendre sa place dans la grande caravane humaine… chacun selon ses talents ?
Les tenants de la Pédagogie Institutionnelle mènent depuis plusieurs années tout un travail de fond afin d’articuler avec cohérence les moyens, les méthodes et les techniques utilisées, à des principes et des valeurs qui en orientent les finalités. Celles-ci visent à promouvoir non seulement de « bons élèves » (en fonction des aptitudes de chacun) mais surtout des citoyens à part entière, des êtres responsables et solidaires, non pas forcément « savants » mais surtout capable de parler en leur nom de ne cesser de rechercher ce qui est juste. Quelquefois leurs efforts sont couronnés de succès. La lecture de leurs « monographies » sont édifiantes de ce point de vue. Attentifs à chaque élève en tant que sujet ils établissent une cohérence entre sa « liberté » et la nécessité des règles pour contenir le totalitarisme du désir. L’institution de séquences ayant des objets différents (les acquisitions de savoir, les échanges de parole concernant les événements de la classe, la participation aux prises de décisions en commun etc...) dans le cours de la journée, visent à alterner les temps de travail pédagogique et les temps de travail éducatif. Cette alternance permet des échanges de parole entre tous, l’émergence de différences de point de vue, des débats favorisant la participation à la vie de la classe, l’acquisition de connaissances mais aussi la formation des uns et des autres en tant que membres d’une collectivité. Une telle organisation, qui paraît complexe au premier abord, est instituante et les enfants s’y retrouvent fort bien. Le modèle sous-jacent d’un tel travail est axé sur la référence incessante à du « tiers » tentant de réduire les méfaits d’une didactique « frontale » où le pouvoir du maître est total. Quelquefois des élèves dits difficiles se mettent à pouvoir « parler ». Des dialogues peuvent s’établir et, ce qui est encore mieux, du sens peut s’échanger.
Nous pensons au « Quoi de Neuf ? », ce temps d’expression libre des enfants qui se tient au début de la journée de classe pour leur permettre de dire quelque chose de ce qui les a frappés, de ce qui les a intéressés, de ce qui les a touchés dans les événements de la vie quotidienne. Nous pensons aussi aux « Conseils de classe » où ils sont invités à prendre une part active à l’élaboration des décisions qui concernent la vie de la classe, la marche des travaux en cours, les félicitations qui s’imposent, et ce qu’il y a lieu de dire à ceux dont les conduites ont posé problème etc... Dans les deux situations l’enseignant joue un autre rôle que celui de maître. C’est avec reconnaissance et respect que nous rendons hommage à celui qui a institué ces méthodes, Célestin Freinet qui aimait les enfants et les valeurs de la démocratie.
Dans un monde où l’efficacité et l’obligation de résultats figurent au haut de l’échelle des valeurs, la justice vis à vis des handicapés symboliques n’est pas le souci premier, sauf à leur demander de devenir conforme à une norme comportementaliste orthodoxe. Ceux qui rencontrent des enseignants qui n’ont pas renoncé à instituer les enfants dans le respect de la différence, ont tout simplement de la chance. Fernand Oury, un des pionniers de la Pédagogie Institutionnelle disait que l’éthique véhiculée par la Pédagogie Institutionnelle était « la moindre des choses » que l’on devait aux enfants. En fait cette « moindre des choses » implique d’autres théories du savoir et de la connaissance, se réfère à une autre logique de l’initiation et à un autre système de valeurs que les valeurs dominantes de l’efficacité et du rendement. Dans la petite « république » qu’est la classe, la prise en compte du sujet et de sa parole, la solidarité et la justice sont au plus haut niveau de l’échelle des valeurs. Les débats, les affrontements et les conflits ne sont pas évités. Le dépassement dialectique des contradictions s’avère souvent possible et tous font l’expérience que la parole ou le silence, la symbolisation ou le refoulement, ne produisent pas les mêmes effets.
Heureux donc les enfants dont l’héritage symbolique a permis une institution culturelle et dont les repères intériorisés et le désir permettront de répondre à leur tour (dans l’aire privée comme dans l’aire publique) d’une transmission où la recherche de ce qui est « juste » l’emporte sur « l’excellence » et l’efficacité marchande. Soulignons vigoureusement que l’héritage symbolique n’est pas lié au milieu socioprofessionnel ni à l’héritage matériel. Il y a des indigents symboliques dans tous les milieux car trop souvent l’école favorise la promotion des têtes savantes, plus que celle des esprits riches et généreux.
Quelquefois, devant l’envahissement de nos institutions par les valeurs dominantes je me dis : « qu’est donc devenue l’école ? » En proie au « management » et aux techniques de gestion qui étouffent le sujet (si elles ne l’ignorent pas tout à fait) par leur rationalité univoque dans la plus pure tradition du fonctionnalisme américain, elles véhiculent un élitisme massif et sournois qui renforce la fracture sociale ainsi que celle du pouvoir et de l’argent. De plus les « fourches caudines » où se doivent de passer les « meilleurs » produit dans son ensemble plus de techniciens supérieurs et de spécialistes que d’êtres conscients, courageux et responsables, des hommes et des femmes de caractère. Enfin, l’organisation générale du système, vient signifier subtilement qu’il vaut mieux être conforme et soumis que du coté de ceux qui résistent. Car cela risque de coûter trop cher. Rares sont ceux qui peuvent résister, quels que soit les effets de l’éducation qu’ils ont reçu dans leur milieu d’origine.
Quelquefois des « miracles » se produisent grâce à l’amour du symbolique et grâce à l’amour de l’enfant de certains instituteurs et professeurs de tous grades et de tous niveaux. Ce sont eux les vrais initiateurs. Leurs façons de faire et leurs compétences, portées par leur désir, font alors de l’école un lieu de la deuxième chance où certains enfants peuvent découvrir la libération par la connaissance. S’ils réussissent aux examens tant mieux. Mais plus que des objectifs de réussite c’est le « souffle » des « maîtres » qui oriente des finalités qui sont référées à l’enrichissement de l’esprit. Et il reste toujours des « maîtres » même si ce n’est qu’une minorité.
L’acte pédagogique, posé en référence à des finalités où la connaissance et l’éthique sont en jeu, est porteur de visées qui dépassent et de loin les objectifs des « projets » dits pédagogique. Ces visées échappent à la mesure et à des définitions en termes de résultats, car il y a différentes façons d’être pleinement humain. Peut-être sont-elles portées par la part de rêve de ceux qui n’ont pas renoncé à « résister » aux valeurs des sociétés marchandes et qui restent des artisans ès-culture, considérant que l’essentiel est de parvenir à ouvrir l’esprit de l’élève à la saveur du savoir et aux richesses symboliques qui aident à vivre et à mourir, dans l’espace privé comme dans l’espace public. Utopie ? Peut-être...Mais l’utopie soutient nos idéaux et permet de lutter pour le meilleur contre le pire.
Charlotte HERFRAY
Nous remercions très vivement Monsieur Alain Jaillet, professeur en Sciences de l’Education à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, d’avoir bien voulu autoriser la diffusion du présent article, écrit initialement pour Education et Sémiotique (Presses Universitaires de Strasbourg 2000) en hommage au professeur Michel Tardy qui a crée à Strasbourg, avec Olivier Reboul, la section des Sciences de l’Education.
Auteur :