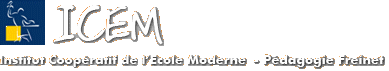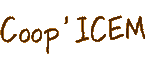|
La production
Les séances d’arts plastiques sont des moments très calmes. Je l’impose, et les enfants se rendent compte très vite que la concentration est nécessaire ici comme ailleurs. On met un fond musical, avec des CD apportés de chez moi.
Comme pendant le travail personnel, celles et ceux qui ont besoin d’aide s’inscrivent au tableau et je me déplace d’un atelier à l’autre.
Quand un enfant arrive dans un atelier, il a une intention. Il a élaboré un projet sur son cahier de graphisme. C’est l’occasion d’une première discussion, souvent très nécessaire, surtout au début : il faut souvent simplifier, élaguer, recentrer, avant d’aller au coin peinture !
|

Audrey, « Mon chat ».
|
Audrey
«Mon chat» (gouache, format 50 x 70):
Cette peinture a beaucoup plu, mais elle nous a beaucoup appris, notamment lors de son commentaire par les correspondants Elle pose la question des différents moyens d’obtenir un contraste. Par rapport au fond, le chat ne se détache que faiblement, des couleurs très douces ayant été utilisées pour le fond et le pelage, avec la même technique et une valeur identique. D’où ces nouvelles pistes: ne pas employer la même technique pour le fond et le sujet principal; penser autant «valeurs» que «couleurs»…
|

Jordan, Cascade.
|

Florian, Volcan.
|
La question de mes interventions n’est pas simple ! Je me suis peu à peu libéré d’une sorte d’«adoration de la spontanéité de l’enfant» en espérant avoir trouvé une bonne mesure d’interventionnisme. Ce que je ne me permets jamais, c’est d’intervenir directement sur la feuille. En revanche, je donne souvent des conseils et des exemples sur une autre petite feuille, pour illustrer une technique que je veux proposer, au moment où le besoin s’en fait sentir. Interventions, propositions, démonstrations, exemples, suivi d’essais, de tâtonnements, tout cela ne tombe pas à plat, parce que ce n’est jamais vide de sens. Tous ces apprentissages techniques sont une réponse ponctuelle à un besoin d’expression authentique. |
| Quand tu es seule...
Quand tu es seule, tu te demandes :
« Pourquoi je suis toute seule ? »
Je le voulais... ou il le fallait...
Je crie : « Pourquoi je suis toute seule ? »
Je suis toute seule
parce que je me suis endormie...
Ou peut-être qu'il est trop tôt...
Ou peut-être qu'il est trop tard,
et que les autres sont déjà partis !
Moi, je n'aime pas la solitude ;
j'aime bien voir des gens autour de moi,
qui me parlent, qui jouent avec moi...
Léa |

Aicha, Abstrait.
|
| |
|

Julie, Fruits.
|

Marie-Charlotte, Fleur
|
Le retour au groupe et les facteurs de progrès
Un « retour au groupe » systématique prend place en fin de séance, qui permet la discussion, l’interrogation, la confrontation de nouvelles propositions sur les réalisations achevées ou en cours… Il est en même temps le lieu de l’élaboration coopérative de listes de questions pour analyser les productions, dont il sera question ci-après.
Il intervient selon plusieurs modalités :
- Une fois par quinzaine environ, je mets en place l’épiscope afin que nous regardions tous ensemble les derniers graphismes des enfants qui souhaitent les présenter.
- A la fin de chaque séance, nous consacrons une vingtaine de minutes à discuter des réalisations en cours des enfants demandeurs de suggestions pour continuer, ou des réalisations achevées (dans ce cas, on termine par un vote: «Est-ce qu’on accroche?»).
- Pendant les présentations de l’après-midi également, il existe la possibilité de soumettre au groupe un dessin ou une peinture (une place parmi les cinq disponibles, les autres étant consacrées aux textes et aux comptes-rendus de lecture).
|
En début d’année, les discussions se faisaient à bâtons rompus, le «maître de la parole (moi-même)» régulant les interventions. Mais peu à peu, un «encadrement» a été mis au point, sous forme d’un questionnaire élaboré coopérativement, d’abord pour analyser au mieux les graphismes, puis il s’est trouvé généralisé. Mon objectif était alors d’orienter les discussions vers l’aspect formel, d’amener une réflexion sur des moyens techniques car les enfants ont tendance au départ à n’échanger que sur le sens.
Finalement, à la fin du premier trimestre, la classe était parvenue à se poser un ensemble de questions vraiment déterminantes et à disposer de savoirs permettant un réel «passage à la qualité». Les mois qui ont suivi ont été marqués par des mises en œuvre de plus en plus abouties. Les échanges avec les correspondants ont également été riches de critiques, de suggestions, de nouveaux facteurs de progrès… |

Léa, Lapin.
|
|

Léa, Vase.
|
La «réponse»:
Comme pour les textes libres, je demande aux enfants d’apporter des « réponses »* à leurs réalisations en arts plastiques.
L’enfant, une fois sa production achevée, fait des rapprochements sur des projets, des techniques, des choix plastiques, sur la poiétique (la façon de faire), la poétique (ce que l’œuvre provoque sur le spectateur)… avec un ou plusieurs autres enfants de la classe et/ou avec des artistes dont on dispose de reproductions.
Ces propositions de rencontres laissent des traces… ou pas ! C’est bien ainsi : elles ne sont effectivement que des propositions…
Cela revient à s’ouvrir à l’horizon de l’autre et à conforter, dans un élargissement permanent, des champs d’expression. |
Exemples tirés du questionnaire de départ sur les graphismes :
- le graphisme a-t-il été soigné?
- la surface a-t-elle été bien organisée? bien remplie ?
- est-ce figuratif ou abstrait?
- si c’est figuratif, est-ce qu’on comprend bien ce qui est représenté?
- y a-t-il des contrastes de valeur?
- y a-t-il des contrastes de techniques (remplissages des formes, du fond)? (question ajoutée après une discussion avec les correspondants à propos de «Mon chat» peinture d’Audrey)
Exemples de savoirs «provisoires» formulés pendant l’année:
- la couleur de l’ombre, c’est le bleu pour foncer, il faut ajouter la couleur locale en plus foncée et du bleu ; pour éclaircir, il faut utiliser du blanc et/ou du jaune ...
- pour obtenir un contraste par rapport au fond, il faut foncer le fond là où le sujet principal est clair, et éclaircir le fond là où le sujet principal est foncé ...
- tout près, c’est grand avec des couleurs vives contrastées; plus loin, c’est petit, avec des couleurs plus douces; dans un paysage, plus c’est loin, plus c’est bleu ...
|

Benoît, Lézard.
|
 |
Le regard éveillé : établir des liens
Lors du voyage de fin d’année au Centre historique Minier de Lewarde, nous attendions l’heure du rendez-vous avec notre guide, nous nous promenions dans le petit bois du village. Après quelques minutes de marche, nous arrivons à l’orée du bois, avec une vue splendide sur des champs resplendissant sous le soleil… spontanément, toute la classe s’arrête, captivée. Grand silence. Quelques remarques à mi-voix:
"C’est la peinture d’Audrey!
- et aussi le tableau de Van Gogh avec le champ de blé et l’alouette,
- si c’étaient des fleurs de moutarde, ce serait le texte de Malory,
- moi, ça me fait penser à la musique de Maurice Ravel, quand on a fait la danse sur Le jardin féerique."
Emotion intense, minutes inoubliables! Un sentiment de profonde connivence entre toutes et tous. Dans quatre jours, nous allons devoir nous quitter, et ce sera difficile! Une «pédagogie des liens»…
|
*Site Classe : http://jeanmarc.guerrien.free.fr
 |
 |
|
Sommaire
Projet de classe
Créations 119
|
Début de l'article |
|