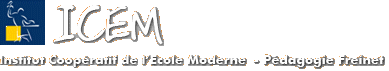|
La peau des murs
Avec Ernest Pignon Ernest
|

J’ai collé environ soixante-dix à quatre-vingt
exemplaires de cette sérigraphie, exclusivement
dans les rues pavées d’énormes dalles de
lave noire. Je tenais beaucoup à cette confrontation
entre la fragilité de la main ouverte et affaissée,
la fragilité du papier et la force à la fois plastique
et symbolique de ces dalles noires extraites
du volcan (je l’avais préparée par mon dessin
que j’ai refait onze fois).
Je crois vraiment que cette confrontation
contribue plus à la force suggestive de
cette image que le dessin lui-même.
|
« L’art commence par des empreintes corporelles sur les murs des grottes.
Quand Pignon Ernest intègre son image sur les murs des villes, il crée réellement un lien charnel avec les lieux.
L’image est le médium où se révèle l’interférence du corps à l’espace, de l’être au monde. » Marie Odile Briot
Par son utilisation de la sérigraphie, Pignon Ernest fabrique traces et empreintes. En outre, le déplacement de l’atelier dans l’espace urbain induit l’obligation d’une frontière entre l’espace réel et l’espace fictif. Et par son travail en noir et blanc Pignon Ernest affirme qu’il évoque le fictif, mais il maintient l’effet de réalité par l’utilisation de l’échelle humaine.
Question : en quoi consiste votre travail ?
E.P.E.: Le fait que je bâtisse toutes mes images à partir de personnages grandeur nature, ou suggérant la grandeur nature, prépare une rencontre, un face à face qui tend à l’identification.
Je mets dans mon dessin beaucoup d’éléments qui vont dans ce sens, vers l’effet de réel. Tout ce travail plastique et graphique qui doit éviter que l’image ait l’air exposée, parachutée, y contribue énormément. C’est un travail qui a pour objet de fondre physiquement l’image dans le lieu.
Je fais du mur une partie de mon œuvre, en le prenant à la fois comme matériau plastique (texture-couleur-matière-comment la lumière arrive dessus), comme un peintre et un sculpteur, et en prenant également en compte les choses qui ne se voient pas, l’histoire du mur. Je résumerai ainsi mon travail : c’est un bout de réalité dans laquelle se glisse un élément de fiction que sont mes images.
Et mes images visent à interroger les murs. Quelqu’un m’a dit un jour à Naples « les images ont l’air de suinter du mur. C’est bien ça, comme si je faisais apparaître des choses, qui, potentiellement sont là.
|
Question : ainsi vous voyez un mur qui va vous inspirer des images ?
E.P.E : Le plus souvent, les idées viennent de ce qui ne se voit pas. Je travaille beaucoup sur les lieux. Par exemple, pour mon travail à Naples, j’ai lu plus de cent livres, de la Bible au dernier roman publié dans cette ville. Je marche également, je marche beaucoup, et à un moment, les choses se croisent : ce que je sais du lieu et ce que j’en vois. A un moment, il y a conjonction entre les choses et tout s'éclaire.
Question : Vous vous servez de la matière du mur, de sa forme, de ses angles, du sol parfois ?
EPE : oui, je travaille tout ça. Ce sont des éléments plastiques comme pour le peintre qui utilise des couleurs. Mais, moi, je n’en mets pas, j’utilise les couleurs du mur, je mets en relation.
Quand je pose l’image sur un mur, je suis comme un peintre qui compose un tableau. Quelquefois, j’enlève mon image pour la déplacer de dix centimètres. Il y a une organisation plastique par rapport à un graffiti, à une pierre du mur. Quand j’ai fait le dessin, je sais où je vais le placer, mais tout de même je vérifie. Donc, je recule, puis je marche vers le lieu où j’ai mis l’image pour voir le « comment » de la rencontre.
Question : Vous utilisez un papier particulier pour vos dessins ?
EPE : Les sérigraphies sont toutes réalisées sur un papier très pauvre. Ce sont des chutes de rotatives du Monde, la fin des rouleaux. Ce papier présente plein d’inconvénients pour le dessin car il peluche tout de suite. J’ai donc trouvé des techniques très spécifiques pour dessiner. Mais l’intérêt de ce papier c’est qu’il est mou. Je peux donc le faire rentrer dans la moindre anfractuosité du mur. Mon dessin se nourrit alors de toute la matière du mur.
Je choisis parfois certains types d’enduits parce qu’ils vont gangrener le dessin. Je choisis aussi parfois une fissure qui va traverser un corps et le rendre plus dramatique. Je fais rentrer le papier dans la fente du mur, il en prend la matière et s’enrichit beaucoup.
Il faut que j’accumule à la fois tout ce que je peux savoir du sujet, que je l’assimile et que je le mette à l’épreuve des contraintes plastiques, celles du dessin et de l’insertion dans le lieu. Je dis contraintes, mais ça peut évidemment être envisagé comme un stimulant. Surmonter des contraintes ou des contradictions superposées et complexes peut amener à trouver des solutions plastiques ou graphiques originales, singulières.
Je fais beaucoup d’images uniques par rapport à un lieu spécifique. Mais Naples, par exemple, est une ville très luxuriante, folle, avec un bruit et un décor visuel incroyables. Là, j’ai multiplié certaines images et j’ai créé des parcours. C’est le cas de celle qui porte un corps sur son dos. Cette façon de porter le corps est très fréquente dans les peintures qui rendent compte des grandes pestes. En même temps, dans toutes ces rues où j’ai collé cette image, il y avait des seringues, et l’épidémie, aujourd’hui, c’est le sida et la drogue. Je souhaitais donc qu’il y ait tout ça : les corps, le linge, la sensualité, la main pendant sur le pavé. Cette image est nourrie de toutes les peintures napolitaines que j’ai travaillées, le Caravage, Mattia Pretti aussi.
Dans la ville, dans les rues, les gens passent tous les jours, et il y a une espèce de banalisation des lieux, même les plus extraordinaires ; et tout à coup mes images font voir à nouveau les lieux, leur redonnent une force suggestive. C’est un travail poétique et plastique.
Mort de la Vierge, inspirée de Caravage. Dessin collé à Spaccanapoli, Naples, 1990. Pierre noire.
J'ai eu quelques difficultés avec le raccourci du bras gauche de la vierge et la main qui ne fonctionnait pas
dans cette rue étroite où l'image n'est jamais absorbée de face.
Question : Est-ce que c’est facile de faire accepter partout des collages ? Les Napolitains sont peut-être moins propriétaires de leurs murs. Avez-vous déjà été agressé ?
EPE : En France, j’ai déjà été arrêté cinquante fois au moins, mais à Naples, ce qui se passe, c’est que beaucoup de dessins sont adoptés par des gens du quartier.
Là bas, j’ai beaucoup travaillé sur les lieux. Ainsi les images prennent un sens dans le lieu où je les colle, les gens comprennent pourquoi je les y ai mises.
Mais il est certain que, lorsqu’on pose des dessins dans les rues, il y a un gros problème d’espace.
L’un des plus importants que j’ai rencontrés fut relatif à l’installation de « la mort de la Vierge » de Caravage. Je constatai l’impossibilité d’utiliser l’ensemble de la toile dans les rues actuelles, et mettre la Vierge seule dans la rue ne me semblait pas possible non plus. Hantant la ville, avec ce que je possédais dans mon magasin mental, j’arrivais à hauteur de deux vieilles femmes que j’avais déjà remarquées souvent, qui vendaient des cigarettes de contrebande dans le creux de la porte d’une chapelle. Et simplement parce que leur table de bois carrée était placée différemment, il m’est apparu qu’elles pouvaient être cette présence charnière entre l’image de la Vierge et la rue.
|

Antonietta, la veilleuse de la mort de la Vierge.
Dessin collé via Biagio dei Librai, Naples, octobre 1995. Pierre noire. Antonietta était de ces personnes qui font que Naples est la seule ville qui semble résister au rouleau compresseur culturel anglo-saxon. Je ne pouvais, en la dessinant, imaginer l’émotion, le trouble, le climat que la découverte de cette image provoquaient. J’ai du dissuader les commerçants de la rue qui proposaient une collecte afin d'apposer une vitre sur le dessin.
|
Les deux vielles femmes ont découvert un matin le dessin qu’elles ont adopté, presque veillé. Il est resté là trois ans sans que personne n’y touche dans une rue où il passe des milliers de personnes chaque jour. Plus tard, lors d’un voyage, j’ai remarqué qu’il n’y avait plus le dessin, plus la vieille Antonietta qui passait ses journées là depuis des décennies. J’ai appris qu’elle était morte. Comme j’avais une photo de mon dessin avec la dame à côté, dans la nuit je l’ai dessinée où elle était tous les jours et j’ai collé le dessin. C’est devenu une image presque sainte. |
La tété allemande m’a envoyé un film où l’on voit les gens dans la rue qui passent et embrassent le dessin de la vieille dame.
En résumé, des gens qui adoptent les dessins et qui les conservent et le entretiennent, c’est un bon repère. Si mon image n’est pas désirée en cinq minutes, le papier peut être enlevé. Si elle reste, c’est qu’elle exprime autre chose que « moi ». Parfois les gens trouvent absurde que je travaille autant le dessin, mais c’est indispensable, sinon il ne supporterait pas la confrontation avec la rue et sa richesse.
Mes collages, c’est à tout point de vue la négation du cadre. Tout est conçu dans le mouvement, le mouvement de celui qui marche dans la rue découvre et ne voit jamais l’image cadrée, mais aussi je dirais le mouvement du temps. L’image n’existe vraiment que dans la relation à ce qui l’enture et essentiellement les traces signifiantes du temps.
Le titre La peau des murs est emprunté à l’ouvrage « Ernest Pignon Ernest » de Marie Odile Briot et Catherine Humblot.
Ce travail a pu être réalisé grâce à l’émission de France Culture "Les chemins de la Connaissance. Au pied du mur" et au livre « Ernest Pignon Ernest, Sudari di carta (Suaires de papier), édité par le musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice.
sommaire Créations n° 94  |
|