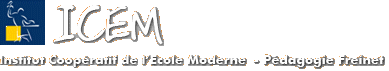1920
TOUCHÉ !
L’ATTAQUE
Le jour J approchait. On avait une baraque, d’assez bons grillages pour dormir. Chaque jour on faisait la « nouba » du jour qui précède l’attaque. Partout fourmillement... Obus qui glissent sur le toit... Sur le haut du coteau où nous sommes adossés, un joli bois où on serait bien avec sa belle... On joue...
Quand on est monté en ligne, le bruit des mitrailleuses nous assourdissait.
A droite, huit Boches se sont rendus levant les bras bien haut. L’un se tenait les reins et marchait courbé en deux ;... un autre avançait péniblement en traînant la jambe.
Un 155 tirait trop court et faisait à tout instant trembler la cagna. Assis sur les marches, je dormais... Que je regrette ce sommeil !
Il était tard... On avait mangé un camembert. On m’apporte une photo d’avion et l’heure officielle. Un peu plus tard le commandant de compagnie me donne l’heure H : 5 h 15. Il était quatre heures.
Il faisait froid. Le brouillard était épais. La tranchée débordait déjà de gens harnachés. Devant le poste du colonel, des sapeurs discutaient... Les fantassins se taisaient...
Enfin, voilà le roulement classique, l’enfer déchaîné dont rien ne peut donner une idée. Ce moment tant redouté, tant attendu, arrivait enfin... On regrettait seulement de n’être pas encore au lendemain.
L’aumônier de la division : à la lueur des éclairs on distingue sa haute stature, sa grande barbe, ses gestes diaboliques.
- Mes enfants, vous allez partir à l’assaut... Pour quelques-uns, le sort sera fatal... Recueillez-vous tous... Nous allons réciter le « Notre Père »... Je vais vous donner l’absolution...
Comme tant d’autres je me suis senti au seuil de l’au-delà. Dans mon recueillement, je n’ai pas pu voir mon dieu ; la rage des hommes était trop forte...
Encore une minute... Attention !... Hop !...
Le brouillard était toujours aussi épais et aussi humide... La boussole brillait dans ma main... Il y avait des hommes et des hommes, tous aussi égarés dans ce désert tonitruant.
J’ai atteint l’objectif... Les prisonniers remontent la côte que l’on vient de descendre, les bras en l’air, semblables à des polichinelles...
- Kamerad alsacien!... Kamerad... pas kapout!...
Grands gars roux imberbes... C’était la Garde Prussienne. Derrière nous, un signaleur a voulu rire un brin. I1 a arrêté au passage un de ces malheureux et lui a appuyé sous le menton le canon de son mousquet. Et la victime a levé encore plus haut les bras, comme pour appeler Dieu à son secours... II devait murmurer quelque supplication... Ses yeux devaient être confondus d’épouvante.
Le Français n’a pas tiré.
Un soldat a appuyé son front sur le rebord de la tranchée qu’il vient de creuser - comme pour dormir. Ses voisins n’ont rien vu, n’ont rien entendu ; aucune trace de sang... II est mort.
TOUCHÉ !
Ma belle canne en serpent que j’avais coupée à Vrigny, je l’ai perdue. Je la cherche désespérément, pressentant l’immense malheur.... Oh ! j’en suis sûr, si je l’avais retrouvée, je serais encore comme vous, et je chanterais, et je rirais... Je ne serais pas un pauvre mutilé.
Je marchais droit devant ma ligne de tirailleurs, regardant, sur la côte en face, monter le 2e bataillon, précédé du feu roulant.
Un coup de fouet indicible en travers des reins : « Pauvre vieux... c’est ta faute... Il ne fallait pas rester devant... Tu n’aurais pas reçu ce coup de baïonnette ». J’ai ri - je croyais qu’un soldat m’avait piqué par inadvertance, et je voulais l’excuser - j’aurais voulu cacher ma douleur... je suis tombé... Qu’elle était bête cette balle !
Par le milieu du dos, le sang gicle... Ma vie part avec... Je vois la mort avancer au galop...
Je n’ai pas voulu m’évanouir et je ne me suis pas évanoui... J’ai voulu me lever : j’ai rassemblé toutes mes forces ; je n’ai pas bougé... Ma poitrine est serrée dans un étau.
Couché sur le brancard, j’ai senti qu’il pleuvait. L’aéro de la division rasait le sol. Mon casque est tombé.
Le médecin de bataillon est tout rouge de sang - un boucher. Dans le trou où j’attends un autre crie... On vient... Oh ! que de blessés !...
Je grogne. Les Allemands qui me portent s’arrêtent. Ils cherchent des épingles anglaises pour me couvrir de deux capotes... Ils me remportent le plus doucement possible.
Des tanks énormes vont à la bataille. Un blessé léger s’en va clopin-clopant vers l’arrière... Que je l’envie !...
Me voilà revenu à mon point de départ, à 1500 mètres du nouveau front. Que suis-je allé faire là-bas ?
HÔPITAL
Une demi-clarté dans la chambre. Des chuchotements, des ombres grises et noires qui passent, silencieuses...
- J’ai soif !... j’ai soif !...
- Rien à boire, ça vous ferait mal. Vous aurez le café à sept heures.
Alors, j’ai revu la belle source de mon village qui dégringole du rocher et qui suit le canal. Je me suis couché à plat ventre ; j’ai trempé mes lèvres avides dans cette eau rédemptrice...
Comme c’est délicieux !...
Jusqu’au matin, j’ai bu l’eau si claire de notre source et elle ne m’a pas désaltéré... Au jour, j’ai eu du café...
Depuis que je n’avais plus vu cette belle lumière !... Ma dernière journée me revient à la mémoire.
- Il y a longtemps que je suis blessé ?
- Mais c’est hier...
- Et quel jour sommes-nous donc ?
- Le 24
Moi qui me croyais déjà en novembre.
J’ai voulu écrire... Ma main droite faisait pitié ; elle ne voulait plus marcher.
Oh ! boire... boire !... Et passer la nuit à compter les heures !... Dans la salle voisine, cris d’un homme qu’on écorche, expression d’une souffrance indicible. Arrive la petite voiture chargée de flacons et de pansements... Des hommes et des femmes tout blancs.
Chacun à son tour souffre son petit martyre... Je tremble.
Le soir vient ; avec lui, l’abattement et la mort. L’aumônier va d’un chevet à l’autre pour préparer la mort.
Et puis, encore la nuit.
En face, un agonisant raconte sa jeunesse et se lamente :
- Ma sœur, tu ne me verras plus - je suis mort...
Au loin, le canon gronde encore. Un aéroplane survole l’hôpital. Ne nous laissera-t-on pas mourir tranquilles ?...
PAX DOMINE !
Un soir, l’aumônier est venu s’asseoir à mon chevet. Il a penché sur moi sa grande barbe blanche et m’a parlé d’une voix douce et caressante. Il s’accuse pour moi de tous les péchés de la création... Que m’importe ?... Il a récité des prières que je ne savais plus. Je n’ai pas ouvert la bouche... je n’ai pas fait un mouvement...
Demain matin, je communie.
Sur la petite table du centre, un crucifix encadré de deux bougies - décor funèbre. Une sœur se met un beau mouchoir sous le menton.
Dans la chambre voisine, tintement sépulcral d’une clochette. L’aumônier apparaît, blanc et or, portant un trésor dans ses mains... Les deux sœurs tombent prosternées.
Une triste Toussaint.
L’agonisant d’en face a remonté la pente. Blessé de l’intestin, il ne doit pas boire.
En montrant la gorge, il crie :
- Infirmier ! A boire !... Je l’ai encore là, le bon Dieu !...
Comme j’aurais voulu rire ce jour-là !
Oh ! mais, qu’est-ce qui frappe ainsi dans ma poitrine ?... Quel tintamarre dans ma tête !... Comme il fait nuit et triste !...
Quelqu’un me parle d’une voix douce et lente. J’ouvre un instant les yeux : une grosse tête encadrée d’une grande barbe se penche sur moi. On me frotte les mains, les yeux, les oreilles, la bouche... Je baise un crucifix énorme et froid...
- Ah ! non ! je ne veux pas mourir !... Ils sont fous de me donner l’extrême-onction !...
Et je me replonge dans mon éternelle inconscience qui est déjà la mort. La sarabande infernale recommence dans la poitrine et dans le crâne. Vous tous, qui craignez la mort parce que vous vous figurez une montagne de souffrances toujours plus atroces jusqu’au moment où vous vous sentirez devant le gouffre, remettez-vous... C’est plus facile de mourir et je ne le redoute plus.
Le plus triste instant à passer est celui où la maladie lutte avec la santé ; où, vous rappelant votre vigueur de naguère, vous avez pleinement conscience de votre état. Vous retenez vos cris et vos plaintes. Les vôtres disent :
- Il ne va pas bien mal.
Puis le mal triomphe; le cerveau s’obscurcit ; vous vivez un cauchemar. Sauf à de rares instants que vous n’avez pas le loisir de prolonger, vous glissez... La chair crie alors... les nerfs s’agitent... Les gens à votre chevet sanglotent : « Comme il souffre ! » et ils souffrent plus que vous.
Un coup de pouce et vous êtes précipité dans l’au-delà.
Pour mes étrennes, l’infirmier m’a pris dans ses bras et m’a porté sur une chaise longue, au coin du feu.
Par la fenêtre, j’ai vu un autre morceau de toit, un autre fragment du château et même, sur le coteau en face, des arbres entiers.
Puis la tête m’a tourné d’avoir vu trop de choses. On m’a recouché. Mais le lit m’a paru plus doux, le même horizon élargi.
Demain, je me lèverai encore.
J’ai voulu qu’on me mette des pantalons, comme ces enfants qui veulent trop tôt être habillés en homme.
Je me suis fait porter jusqu’à la fenêtre : j’ai vu la cour que des infirmières longues et maigres traversent, pressées. J’ai vu le perron par où je suis monté. J’ai vu les arbres du parc.
C’en est encore trop pour ma pauvre tête.
Ce matin le toit en face était tout blanc. Regardant les bûches dans la cheminée on s’est trouvé tout heureux d’être bien au chaud et de ne pas sortir ! Et on avait une pensée émue pour nos camarades restés là-bas. Ignorant l’immensité de notre malheur on ne doutait pas qu’ils eussent préféré notre sort.
Parce qu’un peu de sang nouveau coule dans tes veines, pauvre mourant, tu crois qu’il t’a régénéré; et que si tes jambes ne veulent pas te porter, si ta tête est si obscure et si frêle, c’est que tu es resté trop longtemps immobile, couché sur le dos !... Avec du sang si jeune, avec un tel désir de vivre, on devrait commander au destin !...
Pourquoi ai-je perdu cette confiance ? Pourquoi ma jeunesse n’est-elle pas revenue ?
DÉSILLUSION
Un bataillon est passé devant l’ambulance, musique en tête - jeunes gens imberbes, aux capotes plissées, que seul uniformise un sac monumental. Pourquoi cette musique me donne-t-elle envie de pleurer, moi qui suis si heureux de n’être pas mort ?
Au loin, un martèlement sourd. Les journaux attendent la terrible offensive (I).
L’ordre est venu de nous évacuer.
Comme tout se tait dans le château ! Comme les infirmières sont résignées !... Le soleil est blanc et mou... Dans la vigne vierge, sous la fenêtre, les oiseaux se sont tus... I1 me semble que les arbres sont moins verts, que la cour est plus sale, aujourd’hui...
...On nous fait partir !...
Comme les jours passés, le ciel est clair et haut ce matin. Je me suis habillé comme autrefois ; la vareuse est un peu large.
Déjà les autos ronflent. Serrements de mains ; promesses, les larmes aux yeux. Chacun s’attarde avec sa préférée à qui il écrira et qui prolonge la poignée de main.
On ferme la voiture. Par une fente, un dernier coup d’œil à ma fenêtre, aux mains qui s’agitent, au docteur qui incline la tête et repart...
Et nous voilà seuls, loques humaines, voguant vers d’autres sympathies. J’ai compris alors que c’en était fait de ma douce convalescence. Je pleurais, laissant derrière moi ce château qui, du moins, avait su ne pas troubler cette longue mais délicieuse renaissance, qui avait respecté ce bonheur insouciant de l’enfant - et aussi ses colères.
On se regarde, hébétés, n’osant pas encore parler de ces choses perdues.
Des baraques en planches... un quai long et nu, et la plaine givrée.
On nous trie...
Des épaves - mais sombres aujourd’hui de n’être plus que des numéros, au même titre que ceux qui, là, gesticulent et rient, heureux d’aller si loin pour une égratignure.
Je suis monté dans le train, et personne ne m’a aidé... Personne ne m’a demandé si j’avais froid... si je voulais boire... si je n’étais pas fatigué.
Et plus rien. Ceux qui ne savent pas se taire parlent de cette miss qui était si gentille... de celle-là qui, un jour... le docteur... le parc...
Malheureux compagnons, vous voyiez encore ce matin une auréole de gloire. Non, nous ne sommes pas « glorieux », nous sommes «pitoyables».
Elle ne reviendra plus ma jeunesse perdue. Les feuilles ont poussé trop tôt cette année.
TOUCHÉ !
Souvenirs d’un blessé de guerre, Paris, 1920.
(I) Offensive allemande de printemps 1918.