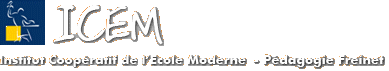Le projet de ce texte est de contribuer à la reconnaissance de l’unité de l’enfant. Il existe un continuum de l’enfant qui va naître, l’enfant du dedans, à celui qui prend le chemin de l’école, l’enfant du dehors. De l’aube de la vie à la maturité, l’enfance est un mouvement continu, irrépressible, dont nous devons apprendre à interpréter les pleins et les déliés, les changements de rythme et de style, les discontinuités sous forme de rupture ou de creux, que les troubles des enfants expriment. Nous débutons par un propos indicatif des références conceptuelles que nous utilisons pour nous repérer de la naissance de la pensée chez le bébé à son accomplissement, bébé devenu grand, chez l’enfant et l’adolescent. Cette étape franchie, le principe que nous adoptons est de nous mettre dans les pas des enfants et des adolescents selon quelques étiquettes que l’usage a fixées aujourd’hui, de l’«hyperactivité» à la « phobie scolaire ». Pour chaque cas nous donnons une lecture, « un certain regard », conscient de prendre parti et que tout éclaircissement, engendre sa propre obscurité. Notre périple commence et s’achève dans « le lieu où nous vivons », là où nous localisons « l’expérience culturelle » (Winnicott[i]). Nous concluons en trois points en faisant retour sur les nœuds invisibles qui brouillent la pensée des enfants.
Pouvoir se déprimer
L’enfant du dehors est à la fois l’enfant de la séparation et de la différenciation. Il est le mouvement de l’enfance, l’extension, « l’extase » qui s’oppose à la « stase » de l’inertie, selon l’expression de Joyce Mc Dougall[ii]. Apprendre, aller à l’école, c’est s’extasier, s’émouvoir, se mouvoir. C’est partir à une rencontre où s’invente un nouveau rapport entre l’enfant qu’il sait être et celui qu’il devient, vers lequel, sous le regard des autres, ses propres pas le poussent.
L’invention, la création, ont pour condition que soit maintenue la fluidité de la pensée. « Desserrer les mâchoires de la langue » écrit Julien Gracq, pour laisser la place libre à son courant. En accepter le « creusement », la dépression qui l’aspire et précipite derrière elle, dans le remous de son sillage, un tourbillon d’idées qui en rompt l’inertie. Bion[iii], dans sa conceptualisation de l’activité de connaissance, ne nous dit pas moins lorsqu’il énonce que l’accès à la connaissance passe par la capacité de renoncer à la « possession » des objets psychiques que sont « les souvenirs et les désirs ». Il distingue ce qu’il appelle le lien K (la connaissance), et la capacité d’abstraction qu’il requiert, des liens L (l’amour) et H (la haine), et la relation de possession des objets qu’ils postulent. En correspondance avec la théorie de Mélanie Klein, l’intégration de l’ambivalence à l’égard de l’objet prescrit le déplacement d’une position parano-schizoïde à une position dépressive (PsàD : d’une pensée totalitaire ou clivée, morcelée, à une pensée ouverte, intégrative) : connaître appelle la capacité de pouvoir se déprimer sans tomber malade. Ainsi il n’est pas d’extase sans dépression, bonheur et tristesse mêlés, ravissement et inquiétude sourde. Partir et quitter, voilà pourquoi la bipolarité est dans notre nature. Parce que sans cesse il faut partir à sa rencontre avec les autres. Voilà pourquoi nous sommes nostalgiques. Parce que partir comble notre attente en la couronnant du succès d’un inconsolable manque.
Dans « La pluie d’été » (Marguerite Duras), Ernesto décide de ne plus aller à l’école « parce que à l’école, on apprend des choses que je ne sais pas. » Ernesto voudrait-il tout ignorer de ce manque qui pousse les enfants à explorer le dehors ? Voudrait-il en maîtriser la pulsion ? Ernesto a des parents, des frères et des sœurs, ses brothers et ses sisters, et une sœur, Jeanne, qu’il aime passionnément. Il est doué, vraiment très doué. Il découvre qu’il sait tout, absolument tout, et même les choses qu’il ne sait pas. Génie, folie, passion, larmes, pluie, Ernesto est dans un « claustrum » (D.Meltzer[iv]). Pour lui l’altérité n’existe pas. Elle est forclose.
Se séparer sans se perdre
Apprendre, ce serait partir hors de soi. « Lire, c’est errer » écrit Pascal Quignard. A condition que cette errance mène vers d’autres lieux et que ces lieux soient habités, qu’ils soient des adresses, des moments d’interlocution pour les enfants et les adolescents qui, sans le savoir, viennent d’y pénétrer. Des lieux dans lesquels ils ne sauraient passer comme des ombres.
Quels sont ces lieux ? Nommons les par leurs noms, Lemière, Guéhenno, Brunet, Saint Jo, Saint Paul, Bicoquet, Duc Rollon, Poppa de Valois, Guillaume de Normandie, Reine Mathilde, Michel Trégore… , Pasteur, Jacques Monod, Puits-Picard, Pigacière, Victor Lesage, Albert Camus, Jean Moulin, Malherbe, Paul Gernez, Viera da Silva… , Le Clé, Ecole Célestin Freinet… , ainsi que le font eux-mêmes les habitants lorsqu’ils parlent des écoles. Comme si par cette familiarité il fallait conjurer les périls de l’anonymat et de l’absence.
Etre perdu, oublié au fond de la classe, sur le chemin de l’école, disparaître : telle serait sous une forme ou sous une autre - perdition, disparition - la grande peur qu’il faut surmonter. Celle qui aborde les enfants quand la nuit vient et que l’heure de se séparer approchant, avec l’obscurité qui englouti ce qui l’instant d’avant était d’une présence certaine, lumineuse comme un visage. La conscience d’exister se trouble d’un insondable sentiment de solitude.
La psychanalyse a reconnu, dans l’irruption des fantômes de la nuit, le langage de l’infantile. L’enfant d’avant, l’enfant en soi, de retour d’un intrigant refoulement revient sur la scène de la conscience. Le passé s’actualise. L’oubli délivre sa mémoire et révèle, à qui peut ou veut entendre, le sens des peurs et des impossibilités d’aujourd’hui qui se dissimule dans les replis de l’inconscient.
A l’enfant de Freud, chargé des désirs du passé et de leurs déguisements (phobies, rituels, obsessions, etc.), à cet enfant censuré, Winnicott a redonné l’exubérance de l’enfance. Il a reconnu chez les enfants le besoin primordial de jouer et de créer ce qu’ils découvrent. Il leur a rendu, peut être même leur a t-il décerné, l’invention de la mère et il a confié aux objets transitionnels le soin de les accompagner jusqu’à l’école et beaucoup plus loin. A condition que « Doudou », puisqu’il s’agit de lui, invisible, silencieux, voyage clandestinement au fond du cartable (en attendant, plus tard, d’être métamorphosé en cartable lui même, sac, sacoche, serviette, en « doudou devenu grand » en quelque sorte). Doudou, ce n’est donc plus soi mais ce n’est pas encore ce qui n’est pas soi. Ce n’est plus le dedans mais ce n’est pas encore le dehors. Doudou, parce qu’il contribue à former la treille du sentiment de continuité, permet le détachement. Il appartient au champ transitionnel qu’il faut aux enfants pouvoir construire pour quitter la première enfance, aller à la rencontre de l’enfant du dehors.
Le langage dans le corps, le corps dans le langage
Pour délier leurs premières identifications et tisser de nouvelles identifications, pour se séparer, passer du dedans au dehors, le rôle des relations précoces et des premiers liens d’attachement est primordial. La possibilité de « lâcher prise » suppose l’expérience suffisamment éprouvée d’un attachement fiable, permanent, malléable, d’une niche perceptivo-sensorielle, affective, cognitive, d’un socle incorruptible sur lequel aient pu se fonder les assises narcissiques de la personnalité[v][vi].
Du bébé à l’adolescent, sous le regard des autres, les transformations qui s’accomplissent font de chaque enfance une altération. Le fil d’Ariane qui unit l’enfant de l’intérieur à l’enfant du dehors, travaillé par les tensions du développement, se tend, s’étire et peut se rompre. Ce sont ces ruptures de lien que nous reconnaissons dans « la psychopathologie de la vie scolaire ». La première de ces ruptures, bien antérieure à l’entrée à l’école, c’est le langage lui-même. Car si le langage introduit la réflexivité, son apparition, en défaisant l’unité d’avant le langage, fait surgir la menace d’éclipser l’ancrage corporel de la pensée et d’en perdre la trace. Ainsi à la naissance de la pensée, ce sera la prise des mots, leur morsure, dans la conscience préexistante à la pensée articulée par le langage, « perceptivo-sensorielle » - Freud[vii] émet l’hypothèse d’une pensée non pensée, originaire, inaccessible à la conscience, constituée des premiers enregistrements des perceptions - « pareillement » mentale que corporelle, qui, avec l’éclosion du langage, transformera le « chuchotement intérieur », la conscience « off » du bébé, en un « dialogue avec un autre ». Le péril procédera ici des obstacles à ce dialogue, quelle qu’en soit leur nature, somatique, psychique, traumatique, micro-traumatique, liée à des évènements ou à des conditions de vie. Ensuite, avec l’entrée à l’école, c’est moins le conflit des identifications, dynamique, générateur qui se joue sur la scène scolaire, que la vacuité entre deux mondes étrangers l’un à l’autre, la distance qui peut se constituer et rendre inaccessible les points de rencontre et de passage de l’un vers l’autre. La rupture proviendra alors du jeu impossible des identifications et des appartenances et d’une conflictualité traumatique de ce fait.
Nous proposons de lire les perturbations scolaires selon cette double entrée, l’une touchant aux fondements les plus précoces de la personnalité et à l’importance des tous premiers liens d’attachement, l’autre à l’altérité de l’école et au mélange de crainte, d’incompréhension et d’attraction qu’elle peut susciter. En considérant toujours que l’un n’exclut pas l’autre et que le tout petit cohabite avec le plus grand à l’intérieur de chaque enfant et de chaque adolescent.
Pour illustrer notre approche, observons certains enfants dont les comportements, emblématiques de notre époque, nous invitent à penser aux échos les plus lointains de la toute petite enfance pour interroger la pertinence de nos discours.
L’hyperactivité, un certain regard sur l’absence du père
Les enfants hyperactifs sont de ceux là. Agités, sans repos, ils sont aspirés hors d’eux, aimantés par tout ce qui pénètre dans leur champ de perception. Ces enfants perturbateurs, au corps démultiplié, terribles bien malgré eux, ne sont ni dedans, ni dehors. Ils n’ont pas de lieu pour se poser. La perception de leur état leur vient de l’extérieur, des autres. Ils n’ont pas conscience de leur agitation. Ballottés dans toutes les directions, tout ce qu’ils saisissent, à peine effleuré, leur échappe comme dans un mauvais rêve. Comme si leurs efforts d’agrippement, désespérément vains, les condamnaient par leur infernale gesticulation, à tenter sans repos d’arrimer leur pensée aux objets externes (leurs perceptions) et internes (leurs idées, leurs sentiments) qui défilent à folle allure parce qu’ils ne trouvent pas à l’intérieur d’eux les enveloppes, les contenants qui puissent la retenir. Ils ne parviennent pas à rassembler leur pensée. Elle s’enfuit. Affolés par le défaut d’ancrage de la pensée dans le corps et du corps dans la pensée, ces enfants sont déboussolés. Autour d’eux chacun s’évertue à vouloir les canaliser avec pour résultat tangible de s’y épuiser. La puissance de leur symptôme est telle que de proche en proche elle contamine l’entourage.
A leur propos, comme dans bien d’autres situations, on invoque le défaut de tiers, l’absence du père, en tirant argument de son peu de présence dans la vie de l’enfant. En voulant le convoquer, le plus souvent on ne fait que vérifier ce que nous savons déjà : il n’est pas, ou si peu, là. En exploitant cette veine interprétative, on ne se rend pas toujours bien compte que l’on confond le père du livret de famille, l’(ex)amant, et le Père de la loi symbolique et que, de cette manière, nous agissons en miroir, dans le symptôme : tels ces enfants en état d’agitation qui cherchent à l’extérieur les appuis qu’ils trouvent pas à l’intérieur d’eux, nous pourrions à notre tour attendre sans fin d’un renfort extérieur le remède à un manque interne auquel on s’identifierait. Le renfort extérieur est certes indispensable, à condition qu’il ne vienne pas entretenir la confusion entre le manque et le besoin en validant l’idée que ceux, c’est à dire nous, qui précisément sont là pour ces enfants, en présence, ne seraient que l’ombre portée de ce manque. Effet pour le moins paradoxal, qui confierait à nos interventions l’étrange tâche de réaliser le manque que les discours dénoncent. Comme les autres enfants ils attendent de nous que nous soyons là, bien vivants. Plus que d’autres, ils nous demandent de puiser de la « présence » à l’intérieur de nous, quelle qu’en soit l’expression, par exemple sous forme de trésors de patience et de calme. De la « créativité », au même titre, par exemple en prévoyant des aménagements de leur scolarité, si nous voulons éviter de disparaître avec eux dans l’hyperactivité.
Le surpoids, un certain regard sur l’enfant sans gravité
Autres enfants de notre temps, les enfants en surpoids : ces enfants aux corps si lourds, beaucoup trop lourds pour des enfants, semblent porter la disproportion qui règle aujourd’hui, dans notre société, le rapport entre besoin et consommation. Comme si le régime du déséquilibre et la dérégulation colonisait désormais les corps et y installait la norme d’une croissance industrielle insatiable. Avec les recommandations diététiques et les multiples prescriptions et mesures de surveillance visant à maîtriser la prise de poids et à adapter leurs activités à leur surcharge pondérale, la frontière qui délimite la vie scolaire de la vie familiale devient de plus en plus poreuse. Entre la famille et l’école, on ne voit plus très bien de quel côté ces enfants penchent et moins encore de quel côté ils sont incités à aller. Curieusement patients, amicaux même, envers ces corps si encombrants, finalement ce dont ils souffrent, en dehors des apparences, ce ne serait pas tant d’un excès de poids que d’une absence de gravité. Entre l’école et la famille, entre la puberté qui pointe et les rondeurs de l’enfance, ils vivent en état d’apesanteur. Ils ont beau se remplir, se lester, ils manquent de densité, de masse. Ils flottent dans une atmosphère d’indécision. La tête à l’école, le corps laissé aux soins maternels, prolifiques et protecteurs. Pas tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, ils se déplacent en lévitation. Dit autrement, l’équation qu’ils s’évertuent à résoudre se formulerait ainsi : comment aller à l’école sans quitter la maison ? Comment se différencier sans se séparer ?
L’adolescent connecté, un certain regard sur l’addiction
L’adolescent connecté est l’objet de toutes les attentions. Les experts affirment voir en lui les maux de notre société : l’hyperconsommation, l’individualisme, la prééminence de l’image et de l’émotion sur la pensée et sur la réflexion, l’immédiateté et la dépendance. L’addiction est le discours dominant. Or les enfants et les adolescents connectés que nous rencontrons et que nous écoutons nous suggèrent une autre lecture, celle de la passion et de l’ascèse : moins la recherche effrénée d’un « produit » de substitution, qu’ils doivent à tout prix se procurer à l’extérieur pour ne pas être « en manque », que l’idée fixe, l’obsession, la « passion » qui polarise leur pensée et leur prescrit un mode de vie exclusif, une sorte d’ascèse, une règle à laquelle il leur faut obéir. L’enfant qui ne se sépare pas de ses écouteurs ou qui ne « décolle » pas de l’écran de son ordinateur ou de son smartphone, même en réseau, est dans une relation en miroir, spéculaire, sans intercession d’un autre, suffisante en ce sens qu’il ne s’adresse qu’à lui même parce que, précisément (c’est bien ce qu’on lui reproche) « il ne sort pas ». Au contraire de « l’addict » qui ferait n’importe quoi pour pouvoir sortir, tant le manque le dévore, tant il se sait insuffisant. De ce point de vue, l’enfant connecté n’est pas un enfant à sevrer. Il a besoin de limites, non pour y être limité mais pour apprendre à les dépasser, pour réussir à poser le pied sur le rivage d’en face sans avoir peur qu’à son approche une canonnière n’ouvre le feu et, faute de savoir comment découvrir l’autre en dehors de lui, cesser de cultiver un autre, imaginaire celui là, à l’intérieur de lui.
L’enfant interdit, un certain regard sur la récréation
Des événements inopinés, bénins dans une cours de récréation, peuvent s’avérer d’extraordinaires révélateurs de l’histoire des enfants. Sans crier gare, ils transforment les enseignants en découvreur. Explorateurs déconcertés, ils « débarquent » alors en terres inconnues et leur étonnement, après qu’ils en aient fait part aux parents, peut arriver jusqu’à nous.
A l’heure de la récréation Jim, neuf ans, joue au ballon avec ces camarades. Le jeu consiste à accomplir, en courant le plus vite possible, un parcours aller retour avec un ballon au pied que l’on frappe contre un mur, à le reprendre au rebond et ainsi de suite jusqu’au bout du mur, là, demi tour et même course en chemin inverse. On se chronomètre. Ecolier insaisissable, préoccupant par les passages en creux et les chutes qui, sans explication, entament sa progression, Jim excelle à ce jeu. Ce jour là un événement impromptu se produit. Jim shoote. Le ballon ne revient pas. Il a disparu dans l’ouverture de la fenêtre d’une salle de classe. Le ballon a traversé la salle déserte, franchi la porte en vis à vis, bondi dans le couloir et percuté un grand vitrage plastifié qui, en état avancé de descellement, a basculé dans les jardins de la propriété contigüe, le Rectorat. On a rapporté que le Recteur y recevait des visiteurs, mais peut être a-t-on exagéré. L’embarras est donc considérable. La directrice demande à Jim des explications. Jim demeure interdit. Il ne répond pas. Pétrifié, il ne parle plus. Cet incident dévoilerait-il une fêlure jusqu’alors inaperçue? Sa mère, qui l’élève seule, nous fournira des clés pour mieux comprendre le troublant silence de Jim. Contentons nous de celle-ci. Elle avait deux amants lorsqu’elle a su qu’elle était enceinte. Lequel était le père du bébé qu’elle portait ? Elle hésitait. Elle désignait l’un plutôt que l’autre, mais sa certitude vacillait. On pouvait l’entendre, son cœur balançait encore. Deux amants qui s’en vont à l’annonce d’un enfant, cela fait un double abandon. Jim, devenu grand, ne lui réclamait pas de se prononcer. Il n’exigeait rien. Il lui montrait qu’il était heureux comme ça. Il ne la délaisserait pas. Jim a décrit la course du ballon et la chute finale dans les jardins du rectorat avec la précision d’un artilleur. Quant à son silence, il ne pouvait rien en dire. Il n’en savait rien. Lors d’un rendez-vous, sans préambule il dit à son pédopsychiatre, en appuyant ses mots, « ma mère vous aime bien ». Comme ce dernier restais demeuré (« silencieux » conviendrait aussi, va savoir), il le lui répéta. Lui désignait-il une place pour sa mère ? Quelque temps plus tard, à l’occasion d’un autre rendez-vous, il trancha la question pour lui même. Il était accompagné par un homme qu’il présenta en trois mots: « C’est mon père. »
La directrice donna à cet incident un extraordinaire devenir. Elle n’interdit pas le jeu de ballon. Elle donna aux enfants un autre ballon, moins dur, plus souple, plus commode à maîtriser, afin que le jeu continuât. Procédant ainsi elle fit beaucoup plus que signifier aux enfants l’assurance d’obtenir un retour aux messages qu’ils adressent : elle accordait à leurs jeux et à leurs désordres la valeur d’un langage. Dans la manière dont Jim lançait le ballon et le faisait revenir jusqu’à lui, on peut reconnaître, comme dans le « jeu de la bobine » observé par Freud[viii] avec son petit fils, une façon de figurer l’absence. Nous pouvons voir aussi dans le va et vient du ballon, du bout du pied au bout du mur, la piqûre d’une aiguille qui, guidée par des doigts agiles, fait passer un fil invisible d’un bord à un autre bord, d’une berge à une autre, pour effectuer une imperceptible suture entre le dedans et le dehors.
L’écriture négative, un certain regard sur la dysgraphie, la dyspraxie, et autres dys
Nous connaissons aussi sous de multiples traits, filles ou garçons, petits ou grands, ces enfants qui n'écrivent pas ou si peu que cela revient au même. Lorsqu'ils s'y risquent, ce qu'ils font parfois, illisibles, indéchiffrables aux yeux des autres comme pour eux mêmes, ils s’exposent à la désolation de leur écriture, sèche, fripée, ratatinée comme une pomme oubliée sur le rebord d'une fenêtre. Leur écriture est impossible. Tous ont leur histoire, avec des manques, traumatiques en plus ou en moins, mais toujours singulière, toujours humaine. Julien a son histoire. Son cas est exemplaire parce que sa particularité sert la généralité de notre propos.
Julien est un adolescent. Sa gentillesse, comme son humour, est sans détour. Il a vécu en --- jusqu’à son adoption à l’âge de sept ans. A son arrivée, c’est un enfant qui a souffert, physiquement et affectivement, de multiples et profondes carences. Pour lui, l’apprentissage de la langue française avec sa mère adoptive va se confondre avec l’expérience toute nouvelle, première dans sa vie, d’une relation d’attachement. Ainsi le langage sera pour Julien à la fois l’expérience et l’instauration de la continuité affective.
Ce n’est certainement pas sans lien avec son histoire si Julien, qui lit parfaitement, parle et s’exprime si bien, rencontre les plus grandes difficultés à l’écrit. Tout ce qu’il sait dire, expliquer, communiquer par le langage parlé, il l’articule avec peine dans le langage écrit : sans doute, parce que l’écrit installe une distance dans laquelle disparaît la présence humaine, « vitale », de l’autre auquel s’adresse ce qu’il veut dire. Au contraire de l’interaction « habitée », par plusieurs, du langage parlé, écrire c’est pouvoir être seul. L’écrit confronte Julien à l’absence. Or pour Julien qui a vécu dans une immense solitude, pour qui l’absence est l’expérience du vide, être seul c’est être « sans personne », sans autre, et par là même désubjectivé. L’écriture est négative. D’une certaine façon Julien est un enfant du dehors, parce que sa vie a débuté ainsi, par son « placement » au dehors. Julien redoute que l’on brise ses retrouvailles avec l’enfant du dedans.
Le langage et ses silences, un certain regard sur le bavardage
Le silence des enfants est un signal d’alarme. « On ne les entend plus. Que se passe-t-il ? Serait-il arrivé quelque chose ? Les aurait-on enlevés ? ». C’est le signe d’un danger imminent. Le mutisme, d‘une autre manière, éveille les plus vives inquiétudes. « Pourquoi ne parle-t-il pas ? Est-ce l’expression d’un refus ? D’un interdit ? D’une impossibilité ? Serait-il malade ? »
La pauvreté du langage réside dans le défaut des mots, leur manque en regard de leur nécessité. Elle constitue un obstacle majeur à la réussite scolaire et sociale. Avec le langage un partage s’opère entre puissance et précarité. Lorsque qu’il n’existe pas, cette inégalité se redouble de l’exclusion qu’engendre l’absence de communication. Tout en nous incitant à découvrir pourquoi certains enfants ne parlent pas et ne communiquent pas, le droit à l’éducation, l’école pour tous, le principe de l’égalité des chances (loi de 2005), nous retournent une question fondamentale : pourquoi n’apprenons nous pas à parler et à communiquer à tous les enfants ? Quels sont nos obstacles ? Quelle est leur nature ?
Si quelques enfants ne parlent pas, d’autres bavardent tout le temps, sans frein ni réserve. Il est aussi difficile de les faire taire que de leur demander, un dimanche après midi au jardin des plantes, de renoncer à un tour de manège. Pensons à ce passage du film « Shreck » lorsque, dans leur fuite éperdue dans les dédales vertigineux de la forteresse, pourchassés par le dragon qui crache des flammes en rugissant de colère, la princesse, délivrée par l’ogre Shreck et son compère l’âne, s’adresse à Shreck et, à propos de l’âne, lui demande étonnée : « Il parle ? », car en effet il parle tout le temps. Shreck alors lui répond, dans une stupéfiante parenthèse au regard des circonstances : « C’est le problème ».
Ces enfants, donc, s’accrochent à leur langage, comme on se cramponne au siège d’un bolide, emballés par l’ivresse des mots et la multitude des questions qu’ils permettent de poser. Ils découvrent l’extraordinaire emprise des questionneurs sur les questionnés, ceux qui subissent l’assaut de leurs « pourquoi ? » et de leurs « tu sais ? ». Jusqu’à ce que sonne l’heure de la revanche du langage écrit sur le langage parlé.
Alors, au triomphe de l’écriture des premiers mots et des premières phrases, succède le dépit, quelquefois la rage d’une dépossession: « Ce n’est pas comme ça ! ». « Ce n’est pas ça que je voulais ! ». « Non, je ne veux plus ! ». Rude leçon, dès la grande section de maternelle, que d’apprendre à ses dépens que dorénavant il faudra composer avec « tout ce mécanisme verbal qui, si nous n’y prenons garde, s’ingénie à penser pour nous tout seul.» (Julien Gracq).
La peur d’apprendre, un certain regard sur la peur
Angoisse de séparation, phobie scolaire, empêchement de penser, peur d’apprendre[ix], sous ces différentes occurrences nous est racontée une histoire de la peur qui saisit les enfants, ici, au moment de se séparer, là, à l’instant d’apprendre. Elle nous alerte sur la violence qu’exercent les transformations internes et externes qui s’imposent à eux, avec ou sans leur consentement et, en tout état de cause, à leur corps défendant.
Le pas pareil et le pareil, le non identique dans l’identité, la possibilité du différent dans le même, la discontinuité dans la continuité : apprendre serait-ce pouvoir se transformer sans disparaître ? Voilà des questions dont nous différerions volontiers les réponses à l’âge de raison. Or les enfants insistent : « Pourquoi ? » Veulent savoir : « Qui a commencé ? » Protestent : « Qui a décidé à notre place ? » « Qui l’a dit ? » « Qui a ordonné que l’école est obligatoire ? »
Avec les enfants la question des origines devient la question de l’autorité. Or, le lieu de l’autorité, sa localisation, appartient à notre culture. C’est donc de cet espace, et non de notre seul champ disciplinaire, même avec le secours de la philosophie et de toutes les sciences réunies (ce n’est pas le moindre de nos soucis), que proviennent les réponses qu’en retour nous leur adressons.
Nous sommes nous interrogés sur les figures que nous incarnons ? Que représentons nous pour les enfants et pour les adolescents ? Quel est notre modèle ?
Sommes nous des ogres ? « Tu as peur qu’on te mange ? » entend-t-on dire à la cantonade. Si nous devions établir un lien entre l’élève qui ne parle pas et celui qui fugue nous y verrions une même urgence, par des moyens différents, de se mettre hors de portée de la prédation du dehors.
Sommes nous, comme dans le film « Shrek », un peu âne, prince et princesse, dragon les plus mauvais jours ? Sommes nous la patience ? Sommes nous toujours du côté des enfants ? Sommes nous désintéressés ? Sommes-nous la séduction ? Sommes-nous l’autorité ?
La discontinuité
Le trouble des enfants nous invite à penser ses conditions d’émergence. Notre société subit de profondes mutations, tandis que La famille poursuit ses métamorphoses. Lorsque L’Education Nationale annonce des réformes, promet de nouveaux moyens, est-ce pour refonder l’école ? Est-ce pour l’acclimater à notre nouvel environnement et à ses changements ?
Tout un chacun s’entend à reconnaître que le monde dans lequel nous vivons n’est plus le même. Si d’un côté il a en partie liquidé la tradition, de l’autre il nous impose d’autres contraintes, telle celle d’être autonome le plus vite possible, le plus longtemps possible, telle encore celle de satisfaire et d’être satisfait sans délai. Force est de constater que la vie des enfants d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Le « pacte » de continuité qui, pour le meilleur comme pour le pire, unissait les normes sociales et les normes biologiques est en apparence rompu, peut-être pas en totalité, mais en de nombreux points il s’est fissuré.
S’interrogeant sur les « conséquences pour le sujet contemporain » de la « mutation sociale et culturelle » que nous observons, Marie Bergeot[x], reprenant la thèse de G. Canguilhem (Le Normal et le Pathologique ), nous apporte ce remarquable commentaire : « C’est précisément en prenant en compte les conditions du milieu dans lequel vit l’individu que Canguilhem vient interroger la continuité entre les normes sociales et les normes biologiques, et par la même, redonner à la normativité une nécessité interne qu’on aurait pu penser évacuée au profit de la libre initiative des individus (…) Cela revient à distinguer une normativité sociale, qui s’impose de l’extérieur, et une normativité biologique, qui est interne à l’organisme, qui procède de la régulation vitale. La vie humaine est donc à la confluence de conditions imposées par un mode de détermination biologique et l’autre social. »
La continuité
Au delà d’instruire et de transmettre, apprendre, enseigner ce serait « placer » un élève - enfant, adolescent - dans une relation qui lui permette de créer ou de restaurer les liens internes et externes qui réalisent une continuité entre l’expérience intérieure - la conscience de soi - et l’accès à l’expérience de l’autre - l’intersubjectivité. La conscience de soi et l’intersubjectivité précèdent la subjectivité. Elles reposent sur sa propre réalité psychique, corporelle, biologique et sur la réalité de l’autre.
Lorsque l’autre n’est pas là ou insuffisamment là, son absence, son « insuffisance », au même titre que sa présence, est une réalité dont l’expérience est à la fois psychique et corporelle, biologique, et non une réalité virtuelle. Sa prévention, son traitement résident dans la pérennité, y compris en son absence, de la réalité de l’autre. La continuité de soi s’établit de ce point de vue dans la continuité de l’autre – mère, père, enseignant, éducateur. Si nous concevons que pour un enfant exister, comme comprendre, signifie être compris, nous pouvons alors entendre qu’apprendre c’est être appris.
La continuité de l’autre, sa permanence, s’accomplit, ou pour mieux le dire, se crée dans le direct de sa relation. Elle se noue à l’épreuve de la réalité de l’autre et, en conséquence, de sa capacité à savoir rester vivant pour laisser le jeu de l’enfant ouvert, même si parfois nous devons le suspendre quand cela fait partie des règles du jeu. Que l’on soit parent, enseignant, éducateur, passer maître dans l’art du jeu, c’est se déplacer dans le jeu très sérieux, « pour de faux, pour de vrai », des enfants. C’est au final se laisser jouer et pour cela acquérir, développer et entretenir ce talent.
Pour que l’interruption ne soit pas une cassure et pour que l’absence ne fasse pas « cruellement défaut », la permanence de l’autre, même absent, même interrompu, est représentée par le collectif de l’école et les groupes qui le composent (groupe des enfants, groupes des enseignants, groupes des parents). Garants de la réalité de son absence, et de la réalité de sa présence, les groupes (le collectif de l’école) par la manière même dont ils le vivent et le racontent, « présentifient » l’autre. Ils « incarnent » sa réalité dans sa présence comme dans son absence. Cela implique des expériences vivantes, multiples, qui se parlent, se racontent, à deux, à trois, en groupe, d’un groupe à l’autre, ensemble dans un lieu qui en institue la possibilité et qui en orchestre le jeu apparemment désordonné, prométhéen quoiqu’on en dise, et ses combinaisons infinies : l’espace culturel de l’école.
Pour conclure
La peur d’apprendre a anticipé sur notre conclusion car elle condense les trois occurrences que notre introduction évoquait : (a) à la naissance de la pensée, avec l’apparition du langage, l’angoisse sans non qui surgirait d’une menace de rupture d’avec soi; (b) avec l’apprentissage du langage, les mots prenant la main sur la pensée, le risque non plus d’une dissection, mais d’un divorce d’avec soi; (c) à l’entrée à l’école, en absence de frontière commune, l’errance entre plusieurs mondes, dans un « no man’s land ». Ajoutons encore que la continuité se réalise dans la possibilité d’un dialogue ininterrompu entre dedans et dehors, pourvu que l’écart qui se creuse, le desserrement à l’intérieur de soi, entre soi et l’autre, ne soit pas vacuité mais mouvement en dedans et en dehors de soi, découverte de l’altérité. Lorsque le psychanalyste réinvente avec chacun de ses patients l’hospitalité de son écoute, le maître d’école, quant à lui, offre à ses élèves l’hospitalité de sa culture. De même que la psychanalyse avec les psychanalystes, l’école tire sa fécondité, aussi bien dans sa dimension créative que dans sa portée génératrice, de son hospitalité. Le savoir des enseignants, comme le savoir des psychanalystes, en est une condition déterminante. Il n’est pas le principe de cette fécondité : son principe se tient dans « l’espace potentiel » (Winnicott) de la relation qui s’instaure entre les élèves et leurs enseignants et dans « la parole pleine » (Lacan[xi]) qui, dans ces conditions d’expérience où le plus vrai, le plus authentique, disons le désir, peut se nouer au savoir, a libre champ pour surgir.
On aurait bien tort, écrit Henri Meschonnic[xii], d’opposer le langage à la vie. « Je définis, pour ma part, le langage comme le rapport entre le corps et le discours. Je dis : nous avons affaire au « corps-langage ». » « Le sens du langage, c’est autre chose que le sens des mots. Il n’y a pas seulement à enseigner des savoirs, mais aussi à être un sujet (…) Comment faire ? « Est sujet celui par qui un autre est sujet. » »
Le langage apporte à la pensée des enfants la palette de ses mots. Une fenêtre s’ouvre sur son passage, à la fois sur l’intérieur et sur l’extérieur. Il leur donne la possibilité de s’intérioriser et de s’extérioriser. Du dedans au dehors, et du dehors au dedans, chaque étage du frêle édifice en construction réserve son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Dans cet ouvrage toujours à recommencer, il faut des maîtres d’œuvre, ce sont les parents, l’enfant est son propriétaire et, l’essentiel, est de vouloir comprendre, autant de fois qu’il est nécessaire, ce qui se joue et de savoir le partager et l’élaborer avec chacun d’eux, dans le lieu où nous vivons.
Fabrice ZANELLO août 2013
[i] Winnicott, D.W. (1971). Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975.
[ii] McDougall, J. Théâtre du Je, Paris, Gallimard, 1982.
[iii] Bion, W. R. (1962). Aux sources de l’expérience, Paris, PUF, 1979 ; (1965) Transformations, Paris, PUF, 1982.
[iv] Meltzer, D. (1992). Le claustrum, Larmor-Plage, Editions du Hublot, 1999.
[v] Dolto, F. L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984.
[vi] Golse, B. et Roussillon, R. La naissance de l’objet, Paris, PUF « le fil rouge », 2010.
[vii] Freud, S. (1950) Lettre N°52, in La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1956.
[viii] Freud, S. (1920). Au-delà du principe de plaisir, in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981.
[ix] Boimare, S. (1999). L’enfant et la peur d’apprendre, Paris, Dunod, 2004.
[x] Bergeot, M. Sujet de la psychanalyse et traumatisme, Mémoire de Philosophie, Paris I, mai 2013.
[xi] Lacan, J. Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, in Ecrits, Paris, Seuil, 1966.
[xii] Meschonnic, H. (2008). Le langage comme éthique, in T. Garcia-Fons, (dir.), Inventer avec l’enfant en CMPP, Toulouse, Edition érès, 2010.