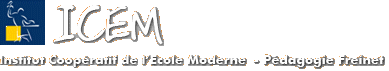Les partisans de la théorie de Lyssenko furent traités d'ignorants, de pseudo-savants, Ces épithètes ont toujours fait partie de l'arsenal des obscurantistes, dont le but est d'étouffer tout ce qui est nouveau et créateur.
Ceux des hommes de science qui sont habitués à penser de façon scolastique, à se confiner dans leur cabinet de travail, en se prosternant devant les principes établis et surannés, se montrent sans valeur dans la pratique.
En ne travaillant que pour la science, en n’expérimentant que pour les expériences, de tels savants cessent, en fin de compte, de comprendre les problèmes d’actualité. D’où, la stérilité de leur activité pratique, le marasme et l'indigence de leur pensée théorique, un retard de plus en plus sensible sur le progrès de la véritable science créatrice.
(Compte rendu sténographié de la session de l’Académie Lénine de sciences agricoles de 1948).
Les attaques menées contre l’Ecole Moderne, à droite, mais surtout à gauche, ont parfois désarçonné quelque peu nos camarades. Ils se sont demandés à certains moments si nos contradicteurs n’avaient pas raison lorsqu’ils nous accusaient, au nom d’une science pédagogique qui n’existe que dans leurs livres, d’emprunter des chemins dont nous ne sommes pas sûrs de l’orientation et de l’aboutissement, et de partir en pointe, à l’aventure, sans savoir nous dégager d’un empirisme sans directives et sans horizons.
Il est exact que nous nous sommes posés nous aussi ces questions primordiales, lorsque, il y a trente ans, au début de nos entreprises, nous n’avions pas encore mesuré l’erreur, et parfois le néant, de tant de sciences officielles. Mais les temps ont marché. Nous avons aujourd’hui une expérience qui occupe déjà toute une vie d’homme et au nom de laquelle nous avons tout de même le droit et le devoir de parler. Et il se trouve — et ce n’est pas un hasard — que cette longue expérience, menée dans le cadre de notre vieille société occidentale, s’inscrit dans le même temps dans le processus de création et de construction d’un peuple qui, sur d’autres bases économiques et sociales, est en train de reconsidérer toute la science académique et qui, à même l’expérience pratique de la vie, cherche et trouve des normes nouvelles d’action sur la nature et le milieu.
Nous aussi, comme Mitchourine et Lyssenko, à même notre travail, nous osons livrer bataille à la fausse science psychologique et pédagogique ; cette science qui, depuis cinquante ans, a suscité tant de livres et d’articles, qui a nourri tant de chaires, usé tant de salive pour des fins qui ne sont pas les nôtres.
On s'étonne maintenant que nous cherchions par nous-mêmes des voies que d’aucuns estiment sacrilèges parce qu’elles ne se réfèrent point aux idées directrices d’une pédagogie dépassée que l’on voudrait faire cadrer quand même avec des conditions historiques qui appellent des formes nouvelles d’activité et de vie. « Ce n’est pas en se référant à des idées directrices générales, ni par des citations, que Lyssenko a répondu à ses contradicteurs. Il leur a répondu par les succès de ses travaux de recherches, par ses expériences compréhensibles, accessibles quant aux conditions de leur réalisation profonde, quant à leurs principes théoriques » (1).
Mais n’avons-nous pas le droit, et même le devoir, de nous faire d'accusés accusateurs ? Car enfin, pourquoi les psychologues ont-ils émis de si doctes hypothèses sur les facultés de l’homme, sur l’intelligence et la raison, sur l’intérêt et la volonté, si nous, les praticiens, ne devions pas en bénéficier ? Que dirions-nous d’une science médicale qui n’enseignerait pas aux médecins à mieux soigner leurs malades ? Nous a-t-on aidés à progresser dans la connaissance de l’enfant et dans l’amélioration du comportement pédagogique des maîtres ?
Hélas ! quand nous scrutons notre passé, nous nous rendons compte que les problèmes qui se posent aux instituteurs sont restés les mêmes qu’il y a cinquante ans, et qu’on n’y a apporté aucun commencement de solution satisfaisante. Les jeunes instituteurs ont certes entendu parler des psychologues modernes, comme nous avions disserté, il y a quarante ans, sur Guillaume et Compayré, et ils ont l’air tout aussi déroutés que nous l’étions quand nous affrontions nos premières classes.
Me dira-t-on que j’exagère ? Il n’y a qu'à examiner la position actuelle des éducateurs en face des nécessités de la discipline, pierre de touche de toute éducation, Elle reste ce qu’elle était il y a quarante ans. Dans toutes les classes non modernisées, les maîtres sont encore les hommes en proie aux enfants, qui s’organisent comme ils peuvent en face de l’ennemi qui s’organise lui aussi comme il peut — et il n’y a pas cent manières de s’organiser contre un ennemi qui, malgré lui, s’en prend à vos raisons de vivre.
Quels enseignements les prétendus hommes de sciences nous ont-ils offerts pour améliorer nos inhumaines et anti pédagogiques conditions de travail ? Car, sauf erreur, elle sert bien à cela la science. J’ai besoin d’une mécanique pour me déplacer plus vite, d’un appareil qui puisse affronter les flots, d’une cuisinière qui cuise le dîner sans danger, d’un moyen pratique et rapide pour faire le ménage; je m’adresse aux hommes de sciences et je leur dis: « Trouvez-moi cela... » Et ils devraient le trouver.
Il est vrai que les hommes de science pédagogique pourraient nous objecter que jamais personne ne leur a posé semblables questions sur le Plan scolaire et qu’ils ont cru, loyalement, que lorsqu’ils avaient écrit un beau livre, bien nourri de pensée abstraite, l’instituteur saurait y prendre son miel. Et les instituteurs ont évidemment tort de n’avoir pas dit plus tôt qu’il y avait maldonne, et que, lorsqu’ils réclamaient une cuisinière ou un aspirateur, on leur offrait plusieurs ouvrages de théorie sur les applications ménagères de l’électricité. N’empêche que le fait est là : il y a eu divorce complet, en fait de psychologie et de pédagogie, entre, la pratique et la théorie. La pratique n’a peut-être pas demandé le secours de la théorie, les instituteurs ayant jugé plus efficient de se transmettre entre eux, vraiment par empirisme, les trouvailles ou les tours de mains qui leur avaient réussi. Et les savants ont continué à parler et à écrire, sans se rendre compte qu’on ne les entendait pas, comme ces vieillards aveugles qui poursuivent leurs discours quand, déjà, leurs interlocuteurs sont partis.
Tout reste à faire. Il n’y a aucune amorce encore de science, les seuls essais pratiques ayant visé dans notre régime, moins à servir l’école qu’à apporter du profit aux éternels exploiteurs de la peine des hommes.
L’amorce de science, c’est nous qui l’avons osée. Nous nous sommes réunis pour dire nos besoins communs, nos vrais besoins, pour déceler aussi les obstacles majeurs aux améliorations qui s’imposent. C’étaient des besoins simples, des besoins de travailleurs : savoir créer, installer, manier un outil, intéresser l’enfant pour l’accrocher à un travail vivant, trouver la solution pratique aux urgentes questions de discipline, parer aux insuffisances des locaux et de l’ameublement, découvrir le chemin mystérieux qui conduit à l’âme de l’enfant, conduire avec plus de sûreté nos élèves sur la voie de l’efficience et du progrès.
C’étaient des questions trop simples, trop terre à terre, que les pseudo hommes de sciences considèrent volontiers comme résolues, qu’ils n’estiment d’ailleurs pas toujours dignes de leur éminente sollicitude. A notre grand regret, nous ne sommes jamais parvenus à établir le moindre contact avec ceux que nous considérions comme nos guides naturels, de quelque tendance qu’ils se réclament. Nous n’avons pas pu parler le même langage et nous le regrettons. Nous nous demandons même si cette science de la pensée abstraite et du livre nous serait de quelque secours, et si la pensée générale et philosophique n’a pas pris cette forme métaphysique pour se situer justement au-dessus du détail pratique pour atteindre à une abstraction qui est langage d’initié. Et nous ne sommes pas des initiés.
Alors, ma foi, nous sommes repartis de la base, de notre expérience individuelle, bientôt répercutée par des milliers d’autres expériences. Par nos propres moyens, nous sommes parvenus à surmonter une partie au moins des difficultés qui n’avaient jamais été pratiquement abordées. Nous apportons aux éducateurs des possibilités effectives de mieux faire leur classe, des outils qui permettent enfin du travail véritable, donc une organisation rationnelle du travail, base de la discipline fonctionnelle que nous réalisons, des techniques pédagogiques qui supposent cette liaison essentielle de l’école au milieu, qui est une des raisons d’être, et la puissance sociale de notre Ecole laïque.
Les pseudo hommes de science sont aujourd’hui obligés de se rendre à l’évidence : nous avons fait faire des progrès à la pédagogie populaire. Mais les voilà qui prennent leurs grimoires et qu’ils comparent ces progrès aux théories qu’ils avaient imaginées. Si, par hasard, il n’y a pas concordance, c’est nous qui avons tort ; nous sommes les empiriques et ce sont eux les scientifiques ! S’ils pouvaient, ils nous feraient un procès pour exercice illégal de la pédagogie !
11 n’y a, hélas ! rien de forcé dans ce tableau navrant du divorce science et pratique. Il nous serait facile de citer des textes. Nous dirons une autre fois comment, pratiquement, sur la base de notre travail, en un vaste laboratoire vivant qui compte aujourd’hui des milliers d’écoles et des centaines de milliers d’enfants, nous construisons méthodiquement la vraie science pédagogique, comme Mitchourine, sur la base de ses vergers et de ses champs d’expériences, jetait les bases d’une science agronomique qui sait, dans un pays où l’effort des savants est au service de l’homme, allier la théorie à la pratique et faire s’entraider, pour une même œuvre, praticiens et intellectuels, chercheurs et techniciens.
L’étude que nous amorçons aujourd’hui ne se présente en aucune façon comme une réponse à la campagne menée contre l’Ecole Moderne par une revue d’avant- garde qui n’a su, à aucun moment, asseoir ses critiques sur de solides bases expérimentales. Les faux savants ont bien critiqué Mitchourine, mais ils avaient tout simplement négligé d’aller visiter ses vergers et de savourer les fruits nouveaux qu’ils produisent.
Ce n’est ni sérieux, ni scientifique. « Une science, dit Lyssenko, qui ne donne à la pratique ni perspective claire, ni force d’orientation, ni certitude d’atteindre des buts pratiques, est indigne du nom de science » (1).
Ce ne sont pas les critiqueurs qui auront raison, mais les techniques que nous mettons debout expérimentalement pour répondre pratiquement aux vrais besoins de l’Ecole du Peuple.
C’est, aux fruits qu’il faudra bien un jour juger l’arbre... et les jardiniers.
C. FREINET.
(1) Op. cité.