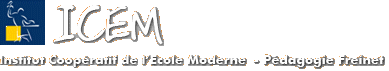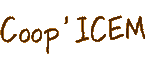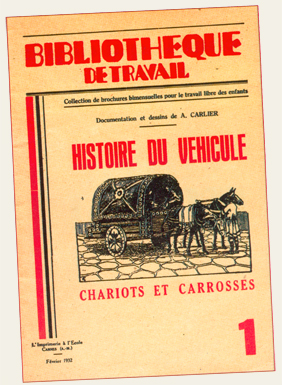Expression libre, correspondance et journal scolaire, vie coopérative de la classe : toutes ces pratiques ont été introduites par un instituteur, Célestin Freinet, au fil de son travail avec ses élèves... Voici son histoire.
|
Comment un instituteur de campagne du sud de la France, est-il devenu l'initiateur de méthodes pédagogiques pratiquées aujourd'hui dans le monde entier? Et pourtant, les difficultés ne manquent pas, aujourd'hui comme avant : les années ont passé, mais les conflits restent, entre cette pédagogie de l'autonomie, de la créativité, et certains politiques toujours peu favorables à la liberté de jugement des gens ordinaires. Voici l'histoire de Célestin Freinet, tout au long de ses combats, mais aussi, au fil du développement d'un réseau coopératif d'enseignants toujours vivace. |
Sommaire |
|
Un instituteur de campagne dans la tourmente de 1914 Au cours de son enfance, il ne connaît rien de la vie moderne de son temps, il n'a jamais vu un journal, une vitrine de magasin, un train, tout juste l'auto du député avant les élections.
Cette profonde empreinte de son milieu se retrouvera dans tous ses livres et influencera fortement sa vision de l'éducation. Mais l'attachement à ses origines ne l'empêche pas de critiquer les inégalités dans l'accès aux connaissances et de revendiquer le progrès technique pour tous Bien qu'il trouve l'école beaucoup moins passionnante que tout ce qui se passe au-dehors, il travaille assez bien pour qu'à 13 ans on l'envoie en pension à Grasse préparer le Brevet. Malheureusement, la guerre de 1914 l'empêche d'accomplir sa dernière année d'études. A1 8 ans, on lui confie sa première classe en remplacement d'un instituteur mobilisé. Six mois plus tard, c'est son propre départ pour l'armée. La guerre meurtrière exige toujours davantage de soldats. |
|
| À la recherche d'une autre éducation
Le jeune Freinet (il a alors 23 ans) n'a aucune envie de reproduire comme instituteur ce qu'il a dû subir dans son enfance. Il juge cette école trop ennuyeuse, trop coupée de la vraie vie. Il lui reproche surtout d'avoir endoctriné* la jeunesse des deux côtés de la frontière allemande, en incitant à la guerre sous prétexte de patriotisme. Ayant échappé de justesse au carnage, il s'écrie comme beaucoup d'amis anciens combattants: « Plus jamais ça ! » et il collabore à la revue Clarté, dirigée par l'écrivain pacifiste Henri Barbusse** . Il participe aussi à la revue syndicale d'extrême gauche L'École émancipée, s'informe sur toutes les expériences d'éducation dans divers pays. Il lit de nombreux livres, visite des écoles en Allemagne, en Russie, participe à un congrès international d'Éducation nouvelle en Suisse. Certaines écoles nouvelles privées sont réservées aux enfants de familles riches. Instituteur de village au Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) depuis janvier 1920, Freinet refuse cette solution et recherche une éducation nouvelle populaire, destinée aux enfants d'ouvriers et de petits paysans. Il sort souvent avec ses élèves voir travailler les gens du village, observer la nature, faire sur le terrain des leçons de vraie géographie. Freinet voudrait faire de la vie des enfants, de leur expression, le centre du travail scolaire. Avant tout, il faudrait mettre en valeur leurs textes, puis leur permettre diverses recherches personnelles. |
* Endoctriner : convaincre de force qu'il n'existe qu'une seule opinion acceptable. ** Barbusse obtint le prix Goncourt en 1916 avec son roman Le Feu qui décrivait la réalité de la vie inhumaine des soldats dans les tranchées, ce qui fit alors scandale
|
|
De l'Imprimerie à la correspondance et au Journal scolaire Freinet recherche un moyen de reproduire lisiblement les textes des enfants.
Freinet communique les travaux de ses élèves à Henri Barbusse et Romain Rolland* qui l'encouragent vivement. Il écrit des articles dans Clarté et dans L'École émancipée et en 1927 un livre : L'Imprimerie à l'école.
Une petite caméra Pathé-Baby permet de filmer les enfants, les paysages et les travaux des champs. Les classes s'échangent ces films louent des bobines de courts documentaires muets qui font pénétrer le cinéma dans le village. En 1927, des instituteurs passionnés de cinéma créent une cinémathèque coopérative.
L'administration des postes refuse d'attribuer le tarif réduit des périodiques aux envois d'imprimés des enfants. |
* Romain Rolland était célèbre pour avoir pris position contre la guerre de 1914-1918. Il est l'auteur du cycle romanesque Jean-Christophe (1903-1912).
|
|
La constitution d'un réseau coopératif d'enseignants La cinémathèque fusionne en 1928 avec la Coopérative de l'imprimerie à l'école pour former la Coopérative de l'enseignement laïc (la CEL). Cette coopérative édite un bulletin pédagogique, L'imprimerie à l'école, où l'on débat de tous les problèmes de l'éducation, en France et dans les autres pays.
Pour permettre aux élèves d'approfondir leurs recherches personnelles sans se limiter aux manuels scolaires, la CEL décide en 1929 de publier des fiches documentaires, puis en 1932 des brochures « pour le travail libre des enfants » dont la collection s'appelle « Bibliothèque de travail », devenue familièrement la BT.
Pour les apprentissages systématiques, en calcul ou en grammaire, Freinet voudrait permettre aux enfants de travailler individuellement à leur rythme, en se corrigeant eux-mêmes.
|
* La Gerbe: Freinet a choisi ce titre par comparaison avec la gerbe qui rassemble des fleurs diverses. Le premier numéro de la brochure BT, paru en février 1932, rédigé et illustré par Alfred Carlier.
|
| Face à un violent conflit qui dépasse la pédagogie
Parce qu'ils y trouvent des réponses pratiques aux difficultés rencontrées dans leur métier, des enseignants plus nombreux rejoignent le mouvement pédagogique animé par Freinet. En 1932, le bulletin L'Imprimerie à l'école prend pour titre L'Éducateur prolétarien*, afin d'affirmer l'orientation populaire de cette nouvelle pédagogie. Au début de l'expérience, certains journaux conservateurs, comme Le Temps, avaient trouvé originale et sympathique cette façon de faire classe. Mais la volonté affirmée de transformer l'école publique en donnant la parole aux enfants irrite violemment les forces d'extrême droite, séduites par les partis totalitaires nationalistes (fascistes italiens et nazis allemands) qui exigent l'obéissance absolue au chef. Localement, le maire de Saint-Paul (où Freinet enseigne depuis 1928) refuse d'entretenir l'école publique fréquentée par une majorité de petits paysans, souvent immigrés italiens ou espagnols. En décembre 1932, prenant prétexte d'un texte d'enfant qui racontait un rêve où le maire était tué, une violente campagne d'affiches et de presse s'acharne sur l'instituteur. A Paris, dans L'Action française**, Charles Maurras, écrivain royaliste, mène le combat pour en faire une « affaire » nationale. La presse de la droite traditionnelle ne veut pas être débordée et critique les instituteurs qui bousculent les traditions. En revanche, la presse de gauche prend parti pour Freinet. L'administration, qui n'avait jamais soutenu les initiatives de Freinet, décide de le mettre en congé de maladie, puis de le déplacer d'office*** dans une autre école. Freinet refuse cette sanction qui serait l'aveu d'une faute professionnelle. Son choix est fait, il quittera l'enseignement public pour fonder sa propre école où, libéré des contraintes, il pourra expérimenter la pédagogie populaire qu'il souhaiterait voir se généraliser dans toutes les écoles publiques. |
* Prolétarien: qui appartient au prolétariat, l'ensemble de ceux qui ne peuvent vivre que de leur salaire sans pouvoir décider de leur travail.
L'école de Saint-Paul de Vence ** L'Action française est un journal d'extrême droite de l'époque.
*** Le déplacement d'office est une décision autoritaire prise par l'administration contre un fonctionnaire, généralement pour faute grave.
|
| Un défi en forme d’école Freinet a racheté à un immigré espagnol malade, retournant dans son pays, un terrain sur la colline du Pioulier, à Vence, face au village de Saint-Paul. En manière de défi, c'est là qu'il construit son école avec l'aide d'amis et de voisins. En octobre 1935, il ouvre cette école doublée d'un internat où, avec l'aide de sa femme Élise, il applique une hygiène naturiste et végétarienne. Alors qu'on peut créer librement des écoles privées religieuses ou commerciales, Freinet subit les tracasseries de l'administration qui ne parvient toutefois pas à l'empêcher d'accueillir une vingtaine d'élèves, garçons et filles. Quelques familles paient pension pour leurs enfants, mais l'école reçoit également des «cas sociaux» dont les frais sont payés par des militants (enseignants, ouvriers) ou des associations. Le comportement parfois indiscipliné de certains de ces enfants sans famille amène Freinet à développer la vie en équipe, le plan de travail personnel et des règles coopératives pour résoudre les conflits. Loin de s'enfermer dans son école, il tente de lancer un «Front de l'enfance» qui serait le volet éducatif du programme politique du Front populaire* de la gauche. ll est déçu du manque de réactions des partis politiques et des syndicats.
Pendant la guerre civile d'Espagne**, l'école Freinet accueille à partir de 1937 des petits réfugiés espagnols, parfois plus nombreux que les élèves français, qui partagent tout avec eux: nourriture et vêtements. Il faut lancer des appels auprès des militants et des enseignants pour acheter le nécessaire. Sur le plan du mouvement pédagogique, les nouvelles instructions officielles*** de 1938 sensibilisent un nombre grandissant d'instituteurs. |
* Front populaire: alliance électorale des radicaux, des socialistes et des communistes qui remporte les élections de 1936.
** Guerre d'Espagne: en 1936, le général Franco s'insurge contre le gouvernement républicain espagnol et, après une guerre meurtrière, impose sa dictature à l'Espagne. *** Ces instructions ministérielles renouvellent un peu les programmes, l'emploi du temps et l'organisation des écoles primaires
|
| L'oppression de la Seconde Guerre mondiale En 1939, pour la deuxième fois, Freinet est confronté à la guerre. Comme mutilé, il n'est pas mobilisable. Mais, malgré son opposition au nazisme, sa sympathie pour le pacifisme l'a rendu suspect aux autorités françaises. Il a dû retirer l'adjectif « prolétarien » du titre de sa revue, devenue L'Éducateur. Cela n'empêche pas des censures systématiques, par exemple à propos d'exercices de calcul ou de numéros de fiches : les nombres sont considérés comme des codes secrets et des passages entiers sont interdits. Le journal des enfants, dont les textes libres sont pourtant bien innocents, est interdit de publication parce qu'on le soupçonne de contenir des messages cachés. En mars 1940, Freinet est arrêté dans son école par la police française et interné. Malgré l'absence de toute véritable accusation, il n'est relâché que dix-huit mois plus tard. On lui interdit alors toute activité pédagogique ou militante. Son école ayant été fermée, il rejoint sa femme et sa fille réfugiées à Vallouise, dans les Hautes-Alpes. C'est là que, pendant l'Occupation, il écrit ses principaux livres: Conseils aux parents, L'École moderne française, L'Éducation du travail, Essai de psychologie sensible. En 1944, on le retrouve au maquis* dans les Hautes-Alpes, puis au comité départemental de Libération à Gap où son premier souci est d'ouvrir un centre d'accueil pour les enfants victimes de la guerre. |
* Maquis: les jeunes hommes qui ont refusé de travailler pour l'Allemagne se sont regroupés dans des lieux reculés et, sous la direction d'officiers résistants,combattent pour la libération de la France. |
| Espoirs et déceptions du combat pédagogique
Dans l'élan de la Libération, Freinet espère que la grande transformation de l'école, qu'il souhaite depuis si longtemps, va enfin voir le jour. Hélas ! la commission Langevin-Wallon* se contente de réunir de hauts responsables, mais aucun enseignant de base comme lui qui connaît bien les problèmes rencontrés dans les classes. Le rapport de ces travaux reste d'ailleurs enfoui comme beaucoup d'autres dans les placards du ministère de l'Education nationale.
En revanche, il estime indispensable pour tous les enseignants de se battre contre la surcharge des effectifs scolaires. En 1955, il lance le mot d'ordre « 25 élèves par classe ». Les syndicats mettront beaucoup de temps à se mobiliser sur ce problème. Le temps a donné raison à Freinet: la surcharge des classes est l'un des obstacles majeurs aux progrès de l'école. |
* Commission d'études pour la réforme de l'enseignement qui travaille de 1944 à 1947.
Évocation du film "L'École buissonnière" |
|
En 1959, Freinet crée une nouvelle revue, Techniques de vie, dont le sous-titre « les fondements philosophiques des techniques Freinet » annonce l'ambition. Il voudrait établir un lien avec des universitaires, des chercheurs, mais le dialogue ne se noue pas vraiment. Hélas ! sa santé l'empêche de terminer. Une première attaque lui interdit de participer au congrès de l'ICEM à Perpignan, à Pâques 66. Après un rétablissement de quelques mois, Freinet s'éteint le 8 octobre. Il avait demandé à être inhumé dans son village natal. Après soixante-dix ans, la boucle est refermée.
|
La vallée et le village de Gars
|