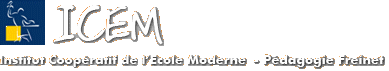BAR-SUR-LOUP
(1920-1928)
Le 1er Janvier 1920, Freinet était nommé instituteur adjoint dans une école à deux classes, à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes).
Il était, plus que tout autre, l'humble débutant dans la carrière enseignante ; sa cantine d'officier de la guerre 14-18 l'accompagnait aux bagages, et l'accompagnait aussi cette lassitude sans espoir qui est le lot des grands blessés de guerre voués au repos et à la mort lente.
D'hôpital en hôpital il avait traîné pendant quatre ans dans une décevante convalescence.
— Pour vous, jeune homme, la chaise-longue au bord des pins !
C'est contre cette irrémédiable prescription qu'il avait voulu s'insurger dans un sursaut d'énergie : fuir l'immobilité, le désespoir, la solitude ! Travailler ! Etre l'artisan du métier qu'il avait choisi : l'instituteur.
A Bar-sur-Loup, il venait se mettre à l'épreuve.
La salle de classe où Freinet entre pour la première fois est la classe traditionnelle des écoles publiques : bancs- pupitres disposés par rangées, estrade pour le maître, porte-manteaux fixés au mur, tableau noir à chevalet... Les fenêtres donnant sur la place rustique du vieux château, près d'une fontaine chantante, à l'ombre d'un grand platane, sont situées si haut qu'elles défient la curiosité des enfants. Le long des murs gris, quelques cartes de France, des tableaux muraux de système métrique, d'exercices de lecture et dans un coin un boulier délavé, seule attraction de ce mobilier poussiéreux et de tradition.
Ce qui impressionne le plus Freinet, c'est la présence effective des enfants, gamins de cinq à huit ans, à la fois disparates et semblables, faisant corps comme un troupeau docile où passent des remous, puis se disloquant, épars dans des individualités mystérieuses. Il a comme une sorte de crainte pudique à les approcher, car jamais jusqu'ici il n'a pris contact avec une classe. Arraché à l'Ecole Normale après la fin de la deuxième année, par l'ordre de mobilisation, il n'a pas eu l'initiation pédagogique de l'Ecole annexe ou des classes de ville que reçoivent à l'ordinaire les élèves-maîtres de troisième année. A défaut d'expérience ou de doctrine pédagogique, il apporte simplement ce respect profond de l'enfant, et aussi ce flair du berger, cet instinct qui suppute et qui jauge les unités et le troupeau et qui est la lente réminiscence de sa vie de petit pâtre provençal.
C'est avec ces seules richesses qu'il devra devenir un éducateur, et c'est avec les manques d'une santé diminuée qu'il devra courir les risques des inévitables échecs.
Son Directeur, heureusement, comprend tout de suite ses soucis et son embarras, et c'est très spontanément, à la bonne franquette, qu'il lui apporte chaque jour l'appui de son amicale expérience et de sa paternelle collaboration. Très brave homme, au demeurant, ce Directeur était le type de l'instituteur-paysan d'autrefois, se partageant avec une égale conscience entre ses champs et son école, soucieux au même degré du rendement des uns et de l'autre. Dès que l'avertissait l'horloge, au clocher du village, il abandonnait sa pioche ou son âne, sortait précipitamment de sa poche son faux-col et sa cravate qu'il ajustait consciencieusement comme les signes essentiels de sa majesté éducative. Grave, il venait donner son coup de sifflet, faisait ranger les élèves des deux classes, et c'était la rentrée, ordonnée, silencieuse, sans caractère militaire poussé à l'excès mais qui donnait néanmoins l'impression de l'indispensable autorité du Maître.
Pour remplir au mieux son métier d'instituteur, cet homme honnête et sans prétention ne se posait d'ailleurs aucun grave problème de technique ou de méthodes. Il avait les méthodes, ou plutôt les procédés courants, qui lui permettaient de mener avec succès la majorité des élèves au certificat d'études, et c'était là pour lui la preuve suffisante de l'efficience de son enseignement. Il connaissait d'ailleurs, et se faisait un devoir de les enseigner à Freinet, tous les trucs, petits et grands, qui réussissent à l'école pour la discipline et le travail, et qui vous donnent par suite avec les parents la tranquillité et la paix. Par ailleurs, il savait aussi avec assez de bonheur, et sans servilité, amadouer l'Inspecteur, satisfaire ses habitudes, flatter un tantinet ses manies, et garder avec lui des rapports marqués de correction et de déférence sans excès de platitude. Aux heures de récréation, dans les allées et venues au milieu du flot bruyant des enfants déchaînés, il se faisait un devoir de parler de son expérience à son nouvel adjoint, pensant ainsi, sans arrière-pensée, faciliter la tâche à ce jeune débutant, malade par surcroît, dont les résistances physiques très limitées menaçaient à chaque instant de trahir la bonne volonté. Et pour l'encourager humainement, avec ce besoin méridional de faire du rire le meilleur argument des démonstrations, il racontait avec verve les innombrables faits-divers qui avaient çà et là marqué sa carrière déjà longue.
— Oh ! Vous savez, il ne faut pas croire que les Inspecteurs se rendent toujours compte du niveau de nos élèves et de nos efforts à nous. Je me rappelle une inspection qui m'avait particulièrement touché. A vrai dire, elle m'aurait bien un peu découragé si par ailleurs elle ne m'avait donné l'occasion d'une bonne partie de rire : j'avais à peu près votre âge, à quelques années près, et j'étais dans votre classe, où, comme vous, je faisais ce que je pouvais... Un jour l'Inspecteur arrive : j'avais une leçon de choses sur le papier. Je me démène comme un diable, fais toucher du papier, du carton, je le froisse, je le fais brûler..., enfin, quoi, je « rupine », et mes élèves boivent mes paroles. Mais la leçon finie, l'Inspecteur remarque deux écoliers dont les yeux vagues disent assez que la leçon est le moindre de leurs soucis :
— Toi, là-bas : est-ce que c'est lourd, le papier ?
— Euh ! Euh ! Euh !... répond en riant l'interrogé, d'un air narquois.
Il était tombé sur Joseph, l'idiot du village.
— Alors, toi, là, qui fais le malin ! Est-ce que ça brûle, le papier ?
— La grosse campano fa boum ! (La grosse cloche fait boum !)
C'était cette fois un benêt, le sonneur de cloches, qui avait la parole...
Et voilà comment l'Inspecteur, mesurant la classe à la bêtise de ces deux simples d'esprits, conclut à mon insuffisance pédagogique...
Mais cela était, bien sûr, une histoire d'inspecteur d'il y a plus de cinquante ans...
UNE CLASSE COMME TANT D'AUTRES...
— Vé ! Le maître, comme il est blanc !
Un grand blessé du poumon s'accommode mal de l'air confiné d'une classe de trente-cinq élèves, de ses odeurs de remugle indéfinissables qui sont le lent poison de nos écoles prolétariennes, des poussières denses et ténues montées des chaussures boueuses, du parquet mal balayé, du vent s'engouffrant dans le couloir de l'école. Parler quelques minutes dans cette atmosphère viciée devenait pour le malade une fatigue extrême ; c'était à bref délai la menace de paralysie thoracique et de syncope. Bon gré, mal gré, il fallait se rendre, aller heurter du doigt la porte d'en face, signal convenu qui signifiait au Directeur que son adjoint était dans l'obligation de suspendre ses cours pour reprendre haleine. Puis c'était l'immobilité de mort sur le divan, et la désespérance quotidienne de l'être jeune qui voulait vivre...
— Ne vous entêtez pas ainsi. disait le bon docteur du bourg. Prenez votre 100 % et retournez dans votre village, tranquille, dans le calme et le repos. Vous savez bien que vous ne tiendrez pas à ce sacré métier...
Il s'entêta. Et parce que toutes les joies de la robuste jeunesse lui étaient interdites, il s'ingénia à trouver en lui des raisons de vivre : au lieu de se disperser en surface, il alla beaucoup plus loin dans la compréhension des choses, et cette immobilité inexorable l'orienta vers un cheminement de la pensée, vers une manière exigeante de s'emparer de la réalité, de la dissocier et de la reconstruire, sous l'angle de ce robuste bon sens paysan qui était jusqu'ici sa seule richesse intellectuelle. Ses dispositions d'esprit tout naturellement l'orientaient vers la pensée marxiste : il lit Marx, Lénine, et dominé par le dynamisme d'une pensée de mouvement, en lui s'éveillera peu à peu une initiative endiablée qui, plus tard, suscitera autour de lui les enthousiasmes et aussi les méfiances qui sont le lot de tous les novateurs.
Cet enfant qui est devant le jeune instituteur, ce n'est pas seulement l'élève qui doit apprendre à lire ; c'est le fils du paysan et de la blanchisseuse, c'est l'enfant des champs et du ruisseau, c'est le sauvageon de la lointaine bastide, l'enfant poète et penseur qui ne se recrée que dans ses solitudes. Et parce que, sous chaque visage, l'éducateur qui s'ignore met une âme et un décor, tout naturellement il arrive à donner son véritable prix à la personnalité enfantine, à en faire l'objet de ses soins intellectuels et de son affection... Là était le chemin du salut, la planche de sauvetage qui devait faire de l'épreuve de Bar-sur-Loup, malgré la maladie et l'ignorance pédagogique du maître, une réussite.
Sur son carnet de bord qui a remplacé le journal de guerre, Freinet note au jour le jour les remarques originales de ses gamins, les mots d'enfants chargés de poésie, les gestes expressifs, les actes spontanés, tout ce qui dans un comportement d'enfant a la valeur instinctive des mécanismes adaptés. A la page d'en face, sont transcrites les observations qui traduisent les ratés, les échecs, les ruptures d'équilibre, toutes les discordances qui se concrétisent dans la nervosité de l'enfant. Et dans cette alternance du positif et du négatif il parvient à se faire une notion assez juste de l'unité des personnalités. Sur un plan plus sensible et littéraire, Freinet éprouve du plaisir à camper Les silhouettes de ses élèves et en feuilletant le cahier jauni où chaque élève avait sa page, il est facile aujourd'hui de se faire une idée imagée et précise de la classe qui lui était confiée.
Il y a là quelques élèves modèles, propres et ordonnés, attentifs et appliqués, qui constituent l'élément d'ordre et d'équilibre de la communauté scolaire. Curieux et avides devant toute nouveauté, déjà ils ont compris avant que se termine toute explication, et sans effort, comme en se jouant, leur esprit enregistre toute connaissance qui passe à leur portée.
La moyenne anonyme et consistante des enfants à mi - chemin de l'intelligence et de l'inertie intellectuelle occupe l'essentiel de l'effectif : visages figés ou instables, chevelure à la diable, vêtements hétéroclites, et par-dessus cette turbulence vestimentaire et verbale, des esprits tour à tour fuyants ou curieux, chercheurs de chicanes et de batailles.
Reste la plus désespérante partie : les déficients caractérisés et les anormaux qui à cinq ou six exemplaires posent dans la classe, quotidiennement, d'insolubles problèmes. Evoquons-les au passage, d'après les portraits qu'en a tracés leur maître, car plus que tous les autres élèves, ils seront l'objet des attentions vigilantes de l'éducateur, et, partant, à l'origine du renouveau pédagogique qui peu à peu s'installera dans la petite école de Bar-sur-Loup.
Joseph, l'ami des bêtes, réfractaire sans recours à ce minimum de culture à laquelle on prétendait l'initier, ne vit qu'avec ses chats, ses chiens, et selon la saison avec les escargots, les hannetons et les cigales dont ses poches sont remplies. Vêtu d'une mauvaise chemise, d'un informe pantalon serré à la taille par une ficelle, pieds nus l'été, chaussé l'hiver d'informes savates ramassées quelque part, ce petit Murillo domine la classe d'un prestige spontané et tout naturel. Quand il regarde de ses yeux de braise, si persuasive est sa vérité qu'il s'impose d'emblée comme un petit Drac lançant ses sortilèges.
Honoré, le lilliputien, arrive lentement le matin, traînant ses lourds souliers mal lacés, tout engoncé dans un pantalon serré à la taille par une ficelle, pieds nus l'été, dont les amples manches dépassent l'extrémité de ses petites mains. Il ne parvient jamais à se dépêtrer de cet amas d'étoffe vaguement retenu autour de son corps gracile, lui donnant l'allure un peu drôlette d'un petit singe de foire. On ne pourra jamais savoir si cette apathie qui le domine et qui chaque fois le fait arriver en retard, qui l'enchaîne à son banc alors que déjà les autres évoluent vers la sortie, est le signe manifeste d'une déficience de son petit organisme souffreteux, ou simplement l'encombrement permanent de son invraisemblable manteau.
Faroppa, au regard hallucinant dans un visage chaviré, arrive le matin de sa lointaine campagne, affolé d'avance par l'idée d'être en retard. La moindre question le plonge dans une agitation telle qu'il lui est impossible d'articuler quelques mots compréhensibles dans un bredouillement sans suite.
Les deux petits rétameurs, noirs de visages et de vêtements, indécrottables sous leur poussière de charbon, font un couple indissoluble. Main dans la main, épaule contre épaule, ils subissent en bloc les disciplines de l'école, si bien que, s'adressant à l'un, on voit l'autre réagir dans les mêmes limites d'une pensée commune. Une seule chose les domine : le désir des grands voyages sur les routes, dans la roulotte, au pas de la mule. Ils ne sont ici que par pure forme de présence, et quand leur esprit s'éveille c'est par la simple association d'idées qui déjà les projette en imagination dans la belle aventure ambulante du rétameur. Et c'est dans ce rêve nécessaire comme une nourriture que naîtra quelques années plus tard l'un des tout premiers numéros de nos « Enfantines » : « Les deux petits rétameurs ».
Mansuy, le solitaire, était certainement le plus pitoyable de tous ces anormaux légers. Dominé par son instabilité inquiète et susceptible, handicapé par une myopie de taupe, il avait la sensation étrange d'être entouré de malveillance et de provocations, et, à propos de tout et de rien, il partait en avant, ongles tendus, fonçant sur l'adversaire. Il arrivait chaque jour portant un petit panier dans lequel ballottaient un méchant croûton de pain, quelques olives, un brin d'oignon, pour le repas de midi.
— Mangia cebo ! (mange oignon !) lui criaient les taquins, qu'as-tu mangé aujourd'hui ?
Lui, fou de rage, se précipitait sur les insulteurs de sa misère, griffes recourbées, dents serrées, prêt à mordre... Mais il arrivait quelquefois, ô miracle ! que tout seul, accroché à son clou, le petit panier se gonflait de richesses... Et, à midi, aux yeux de tous, Mansuy dépliait avec délicatesse et ostentation le chocolat fourré, le biscuit gaufré, ou la part de fromage, sertis dans ce beau papier d'étain qu'il étalait soigneusement en effaçant les plis et rangeait comme une relique dans ses méchants livres ourlés d'oreilles crasseuses.
C'est parce qu'ils étaient ainsi humains, attachants jusque dans leurs faiblesses, que les enfants de Bar-sur- Loup posaient à leur maître scrupuleux, par leur seule présence, la grave question de leur actualité et de leur avenir. A leur contact, à même les conditions poignantes de la pauvreté prolétarienne, se profilèrent les premières responsabilités d'un éducateur du peuple.
Tous les problèmes que posait cette petite classe de village sont les mêmes que se posent dans la majorité des écoles françaises nos jeunes instituteurs d'aujourd'hui et qui conditionnent de façon majeure toute la pédagogie des écoles publiques. Peut-être Freinet aurait-il mieux subi la déplorable emprise de la défectueuse installation scolaire et de la pauvreté, peut-être se serait-il accommodé, pour la dominer, tant bien que mal, des procédés traditionnels vantés par son Directeur, si n'entrait en jeu la grave question d'une santé compromise. Il se trouvait dans l'impérieuse nécessité de chercher d'autres solutions, valables pour son cas, et valables aussi pour ces personnalités dont il apprenait chaque jour à connaître les particularités respectives. Tout naturellement, il essaya, sans ambition, sans parti-pris, d'adapter un enseignement dépouillé de formalisme à ses possibilités physiques mesurées et aux réactions de ses jeunes élèves. Au jour le jour, il improvisa, comparant son comportement au comportement même des enfants.
Il s'aperçut sans peine, par exemple, que les leçons traditionnelles que par impossibilité respiratoire il ne pouvait faire convenablement, fatiguaient tout autant les enfants que lui-même. Quand il rangeait sur son bureau le matériel qu'il avait préparé pour une quelconque leçon de choses, les enfants se tenaient attentifs et curieux, dans l'attente d'une sorte d'exhibition de prestidigitateur. Mais, dès que les explications commençaient, qu'il fallait imposer le silence, et mener de front l'exposé de la leçon et la discipline, l'effort était tel que le maître malade devait capituler, comme capitulait la curiosité mal satisfaite de ses élèves déçus.
Mais que faire dans une classe, si l'on est dans l'impossibilité de faire des leçons ? On ne peut du matin au soir lire dans le syllabaire, copier un modèle et écrire des chiffres sur un cahier. D'ailleurs les enfants sont rebelles à ces activités d'immobilité physique et mentale, et pour finir c'est l'énervement qui s'empare d'eux et l'impatience qui gagne le maître.
Chaque jour, l'expérience conduit Freinet à la même conclusion : l'enseignement donné sous la forme traditionnelle qui exige de l'enfant une attitude passive et amorphe est un échec. Certes, Freinet fait dans cet échec la large part de ses faiblesses d'éducateur. Il sait que si sa voix était forte et bien timbrée, son regard assuré, sa prestance physique imposante, le dynamisme de l'être sain aurait chance de dominer la situation. Mais dominer la situation ce n'est pas résoudre le problème éducatif. Là, tout près de lui, dans la salle d'en face, son directeur fait front à l'indocilité des enfants par des éclats de voix, des coups de règle sur la table, des lignes à écrire, des verbes à copier, et quelquefois par l'expulsion violente de quelque indésirable dans le couloir... Mais, pour autant, l'échec ne devient point succès.
Poser le problème, en sentir les difficultés, pressentir les données qui en font la complication, ce n'est pas forcément trouver la solution idéale. Ce rôle de camarade-éducateur que Freinet a choisi ne se concilie pas toujours avec les exigences des programmes et la rigueur des horaires. Après les moments de détente amicale, inévitablement, il fallait se raidir, dominer le troupeau, aller vers l'obligation scolaire chaque fois décevante pour tous.
Très épuisé physiquement, et devant les difficultés presque insurmontables qui surgissent quotidiennement, Freinet décide de préparer l'inspection primaire. Ce faisant, il occupera son esprit, et mènera une existence moins sédentaire tout en vivant près des enfants qu'il a appris à aimer. Il s'enquiert du programme, et pour la première fois il prend contact avec la pensée de ceux qui ont dominé la pédagogie au cours des siècles.
Jusqu'ici il soupçonnait à peine Rabelais, Montaigne, Pestalozzi, Rousseau, que son départ précipité de l'Ecole normale ne lui avait pas permis d'approcher. Il retrouve dans ces pionniers, les mieux partagés au point de vue bons sens, une solidité, une vigueur, qui contrastent étrangement avec la psychologie intellectualiste, abstraite, des auteurs qui figuraient au programme d'inspection, et il est décidé à avaler comme une purge les traités de Spencer, William James, Wundt, Ribot ; mais c'est avec un réel plaisir qu'il s'attarde en compagnie de Gargantua et Pantagruel, et surtout de ce grand bonhomme de Pestalozzi dont les audaces le dominent.
Ce qui va s'améliorant, ce sont ses rapports avec ses élèves, sur le plan scolaire. Sachant qu'il désertera un jour cette petite classe, il s'attache semble-t-il davantage à eux, les regardant vivre de près, s'ingéniant à être indulgent, attentif aux désirs de chacun, soucieux avant tout de comprendre, d'aider. Il trouve à cette attitude spontanée des joies quotidiennes qui rendent supportable sa vie de malade, et l'orientent de plus en plus vers la compréhension profonde de l'enfant. Il a moins de scrupules aussi à ne pas respecter l'horaire, à ne pas suivre pas à pas le programme, et petit à petit, hors des sentiers battus, il adopte un comportement nouveau en face des problèmes pédagogiques que lui pose la vie pratique de sa classe.
C'est Joseph, l'ami des bêtes, qui entraîne résolument Freinet vers une reconsidération permanente du problème pédagogique. La récréation finie, au coup de sifflet du directeur, les deux classes se sont mis en rangs pour la rentrée, et tandis que la colonne s'ébranle, Joseph, en queue de peloton, s'esquive des rangs, et précipitamment vient s'agenouiller devant les remparts. Son regard avide scrute les vieilles pierres. Déjà le directeur a disparu dans le couloir. Intrigué, Freinet observe Joseph qui, avec des gestes religieux, lève les bras contre le mur, à la hauteur de ses yeux.
— Joseph !
Pas de réponse. Notre servant officiel...
— Joseph !
Alors l'enfant tourne vers le maître son visage préoccupé et d'un geste hâtif qui est à la fois un ordre impératif de silence et d'attente, il signifie :
— Chut ! Allons, je viens, je vais venir ! Rentre, je te suis.
Si profonde est la tension d'esprit du gamin que d'emblée Freinet comprend le langage de cette petite main impatiente, et, sans se retourner, il entre dans la classe.
— M'sieur ! Il manque Joseph !
— M'sieur ! Il s'est échappé. Avant, il s'échappait toujours.
Mais la porte s'est ouverte, et, radieux, Joseph apparaît, reniflant un bon coup comme après une victoire.
— M'sieur, c'est que dans le trou il y a une petite chenille qui a des plumes... petite, petite, comme ça (il donne la mesure sur son doigt), et elle est bleue, m'sieur... « J'y ai » donné à manger...
La leçon de lecture commence, et tandis que la baguette du maître désigne les syllabes sur le tableau mural, Joseph, les yeux tournés vers la fenêtre, continue à veiller sur sa petite chenille qui a des plumes et une si belle couleur bleue...
La chenille de Joseph n'est qu'un fait pris parmi des centaines de faits qui démontrent à Freinet la nécessité de prendre en considération l'intérêt de l'enfant, et d'intégrer cet intérêt dans l'enseignement, pour éviter sans cesse cette désintégration de la pensée enfantine qui est la plaie de l'école traditionnelle. Chaque événement qui dénote ces manques d'une pédagogie sans fondement psychologique est désormais analysé de près par Freinet, et tant bien que mal, par les moyens du bord, il essaye d'éviter ces heurts violents qui opposent l'élève au maître. Lancé sur cette voie de la recherche et de la critique, il aperçoit désormais les tares et la malfaisance des techniques d'autorité, et il adopte, pour une bonne fois, une attitude de doute constructif dont on va voir la lente évolution.
L'emploi du temps prévoyait au début de la classe l'éternelle leçon de morale. Freinet se rendit compte de l'inutilité des prêches que sa gorge malade et sa maladresse oratoire rendaient à peine supportables aux enfants les plus dociles. Il cessa les leçons de morale. Mais le matin, il inspecta plus soigneusement les enfants à leur arrivée ; au cœur de la journée, il remarqua mieux les discordances créées par le comportement irrationnel des nerveux, des instables, des malpropres, des coléreux, des voleurs, des égoïstes, et à l'appui de faits sociaux suscités dans la vie de la classe, il en vint à remplacer la leçon de morale par la simple formule de suggestion dont la vogue alors des expériences de Coué lui avait révélé les possibles vertus. Durant toute une semaine, une phrase suggestive, susceptible d'influencer le comportement des enfants, était inscrite au tableau :
Je suis obéissant et respectueux avec mes parents.
Je suis toujours poli avec mes camarades.
Je prête volontiers mes affaires aux autres.
Je salue tout le monde dans la rue. Etc...
Chaque élève lisait la phrase à haute voix et ceux qui savaient écrire l'inscrivaient sur leur cahier.
Pour le calcul qui suivait la leçon de morale, Freinet essaya bien de tous les procédés concrets qui ne sont pas d'invention récente et qui relèvent plus de l'exercice sensoriel que de l'initiation au sens des nombres. Mais il se rendit compte à quel point ces procédés pourtant à la portée des enfants restaient à l'écart de la vie. Ce n'est pour ainsi dire qu'accidentellement qu'il commença à accrocher vraiment les notions de calcul à l'intérêt vivant de ses élèves, quand il commença les « promenades ».
Avec cette désinvolture propre aux audacieux, Freinet avait en effet pris la décision d'emmener chaque après-midi ses gamins dans la nature. Le premier instant de surprise passé, son directeur s'accommoda de la chose, tout comme s'en accommodaient les parents, avec cette arrière-pensée, toutefois, que c'était là un moyen remarquable de perdre son temps, et, qui plus est, d'orienter les enfants vers des habitudes de paresse.
Il n'en était heureusement rien.
La promenade, c'était le moment de la journée le plus attendu par les enfants. Elle se faisait l'après-midi, quand déjà l'effort de la matinée avait entamé la résistance du maître malade et des élèves les plus instables. Chaque enfant prenait son crayon, son ardoise, et la petite troupe s'en allait dans les environs immédiats de l'école, le long du sentier serpentant sous les oliviers, vers le calme du cimetière, dans la colline où chantait le rossignol, ou là- haut, sur le tertre fleuri qui dominait le village.
Freinet restait attentif à toutes les remarques des enfants plus par curiosité humaine que par souci pédagogique, et en fin de compte il était facile de voir que tout le monde tirait de cette sortie en plein air, sous le beau ciel du midi, une impression d'euphorie qui disposait à la confiance et ouvrait la compréhension.
— M'sieur, disait Lulu, là-bas, je vois ma mère dans mon champ î
— Où ? Où ?
— Là-bas ! Tu vois, là-bas !
— Explique bien, Lulu, disait le maître ; explique, pour que nous la voyions, nous aussi.
— Regardez, là-bas : tu vois la route ? Tu vois le contour du pont ? Eh bien, monte le petit chemin : tu vois le grand chêne ? Et bé ! C’est un peu plus loin de ce côté.
Quelle leçon d'élocution vaudrait cet exercice si naturellement éclos dans l'aventure intime de l'enfant qui regarde dans la direction de sa maison ?
— M'sieur ? On est monté haut, ici !
— On est plus haut que le château ?
Et des comparaisons s'ensuivaient des évaluations de distances, de mesures, des notions de longueurs, et voilà le point de départ d'une excellente leçon de calcul donnée à même la vie.
Cependant ce n'était là encore qu'une intuition obscure qui n'arrivait point à percer dans le champ clair de la compréhension pour susciter un changement total dans la pratique scolaire. Rentré en classe, il fallait, bon gré, mal gré, retrouver les rangées de bancs qui maintenaient les enfants prisonniers, les immobilisaient dans leur corps comme dans leur pensée. Et il fallait retrouver, à la même heure, la leçon de lecture aussi ennuyeuse pour le maître que pour les élèves. Il y avait, accrochés aux murs, une série de tableaux gradués, méthode Boscher, dont il reste certainement encore des fossiles dans nombre de classes actuelles. Les enfants venaient par groupe d'abord, puis individuellement, lire la portion de leçon qui faisait suite à celle de la veille. Bien que la preuve soit faite du manque d'intérêt d'un tel procédé archaïque, force était d'utiliser tant bien que mal le matériel existant, faute d'en connaître d'autre. Le petit groupe de bons élèves se tiraient toujours au mieux de l'épreuve, suivant la baguette sans perte d'attention, entraînant derrière eux, dans la lecture collective, la masse amorphe des hésitants capables tout juste d'accrocher leur voix aux syllabes prononcées, d'en prolonger la sonorité dans des intonations qui ne laissaient aucune illusion sur leur savoir. Heureusement que Lulu et Pierrot étaient là pour porter secours, avec une louable persévérance, aux ignorants invétérés résignés d'avance à l'échec dans les contrôles que le maître leur imposait par acquit de conscience. Nos deux «estamas» s'appuyaient fraternellement l'un sur l'autre dans un mouvement de tangage comme on franchit le passage difficile d'un gué, à contre-courant. Mansuy ouvrait tout grand ses yeux de taupe sans qu'on puisse jamais arriver à savoir laquelle était la plus défaillante, de sa vue ou de son attention. Quant à Joseph, il lisait, mains dans les poches, l'air absent, avec la belle désinvolture de celui qui n'est pas là et qui n'a pas de compte à rendre.
— Joseph ! Allons regarde : papa a ri. - Tata a raté le rôti...
C'était dans les poches de Joseph que se jouait la grande aventure. Sur ses doigts il sentait courir les insectes dont il avait fait provision au cours de la promenade, et la méthode Boscher avait beau étaler ses inutiles tentations sur le carton jauni de ses tableaux, d'avance elle devait s'avouer vaincue par le chatouillis des petites pattes des hannetons ou des bêtes à Bon Dieu.
Clémenti, lui, avait trouvé le moyen de faire passer le temps par de brusques interventions qui faisaient croire de sa part à une apparente attention et risquaient de donner le change :
— La pou le a pi co ré la... M'sieur, qu'est-ce que c'est picoréla ?
Pour finir, c'était le maître qui se trouvait pris au piège par ces satanés tableaux Boscher, et d'avance il devait avouer son incapacité à redonner un sens à des phrases stupides dont les enfants ne percevaient jamais que les syllabes chantantes psalmodiées comme une litanie d'église.
Pour les grands qui déjà savaient lire, l'exercice de lecture n'en demandait pas moins une continuelle tension d'esprit. Les bons élèves ouvraient leur livre à la page qui suivait la dernière leçon, en donnaient le numéro de pagination, aidaient un camarade inexpérimenté, et quand tout le monde était prêt à l'attaque, sur un ordre du maître, l'orchestre s'ébranlait sur des timbres divers dans un unisson plus que relatif, brûlant les haltes des points et virgules, indifférent au sens des phrases comme à celui des mots les plus courants dont on ne reconnaissait plus les visages...
Pour la lecture individuelle, alors que la majorité des élèves devaient suivre mot à mot le lecteur plus ou moins brillant qui venait d'être désigné, le contrôle était vraiment épuisant. A chaque instant il fallait rappeler à l'ordre les indisciplinés qui si facilement se laissaient emporter sur la pente glissante de l'évasion.
— Albert, suis ! Jeannot, regarde ton livre ! Louison, continue !
Un cheval passait dans la rue, agitait ses grelots, et Georges le suivait en pensée. La mère d'Honoré discutait à voix haute à la fontaine, pendant que s'emplissait son seau. Le marchand de vin frappait sur ses tonneaux... La classe était vers le cheval qui s'éloignait, vers l'eau qui glougloutait, vers le marchand de vin rajustant sa futaille. Désemparé et impuissant, s'usant dans une tension nerveuse continuelle, Freinet sentait très bien qu'il fallait coûte que coûte trouver une technique nouvelle d'apprentissage de la lecture, plus près de l'intérêt vital des enfants; et plus que jamais il était sur la voie de la recherche.
Que faire ? Se tourner vers le passé, chercher dans l'ancien ce qui est positif, progressif, et qui pourrait orienter le nouveau, ressaisir la chaîne des grandes idées qu'aux diverses époques de l'Histoire des novateurs ont profilé vers l'avenir.
Il lit et relit, en les annotant, Rabelais, Montaigne, Rousseau, qui lui donnent comme une sorte de vertige en face du décalage monstrueux et permanent entre la théorie idéale et la pratique réelle d'un pauvre instituteur d'école déshéritée. Pestalozzi lui redonne confiance. Lui aussi se colletait avec la réalité et sa vie de lutteur passionné autant que son attachement à l'enfant pauvre étaient un exemple passionnant pour un jeune homme solitaire maintenu sur l'horizon étroit d'une salle de classe ; et pour la première fois Freinet comprenait toute l'ampleur du beau mot d'éducation qui, dépassant la scolastique, affronte le problème pédagogique dans toute sa complexité pédagogique, matérielle, philosophique, sociale et politique.
C'est à ce moment, où son goût déjà pour le métier d'enseigner s'affirme, que Freinet lit les pédagogues modernes de l'Institut J.-J. Rousseau de Genève, inscrits au programme de son examen.
Une personnalité va avoir sur son orientation pédagogique une influence décisive : celle de Ferrière.
Le beau livre de Ferrière, « L'Ecole active », trop peu lu aujourd'hui bien qu'il ne soit pas dépassé, faisait pour ainsi dire le point de ce qu'on commençait à appeler « l'éducation nouvelle », et, outre sa grande richesse pédagogique, ce livre neuf orientait le lecteur vers des ouvrages à consulter pour approfondir les diverses branches d'activités, ouvrant ainsi devant Freinet le néophyte tout un vaste horizon à explorer.
A travers les pages de « L'Ecole active », le petit instituteur, jusqu'ici désemparé, sentait vivre ses propres intuitions ; il entrevoyait des pratiques inédites susceptibles de faciliter sa tâche. Sa solitude amère en était tout à coup illuminée d'espoir. En souvenir de cet appui moral, Freinet ne manquera jamais par la suite, au cours de sa carrière, de rendre hommage au génial initiateur, qui fut, à cette période inquiète de sa vie, à l'écart de toute mystique, un père spirituel, un guide.
En 1923, Freinet fut invité, pendant les vacances, par un de ses correspondants allemands à Altona, près de Hambourg. Il profita de cette occasion pour prendre contact avec l'essentiel de la pédagogie allemande et visiter quelques-unes des célèbres écoles de Hambourg où, à la fin de la guerre de 1914, on avait essayé de réaliser le mythe de l'école anarchiste intégrale sans autorité du maître, sans règle ni sanction. Ces écoles, bien que très confortablement installées, n'apportèrent rien de positif pour aider le jeune maître à résoudre les problèmes que lui posaient sa petite école de village, et, au-delà, l'Ecole Publique.
L'examen du professorat de Lettres vaut à Freinet, à la rentrée d'Octobre, d'être détaché comme professeur à l'Ecole supérieure de Brignoles.
Il se rendit à Brignoles, s'entretint avec le directeur de l'établissement, et reprit le soir même le train pour Bar-sur-Loup. Il retrouva sa classe, ses petits élèves, l'atmosphère accueillante de ce village sympathique qui devint définitivement son village.
Au contact des enfants, dans ses rapports avec eux de franche et simple camaraderie, il avait définitivement compris qu'il lui faudrait chercher dans la vie même des enfants les éléments nouveaux de son travail pédagogique, s'appuyer sur leurs intérêts profonds pour satisfaire ce besoin d'activité dont Ferrière avait dit si magistralement la nouveauté dans son « Ecole active ».
Il alla d'abord chercher dans la vie du village, autour de l'école, les éléments de base de cette nouvelle éducation. Il emmena ses élèves chez le tisserand qui fort obligeamment mit tout son savoir à la disposition de la jeune troupe curieuse. Pour entretenir l'intérêt que cette visite avait suscité, il essaya de réaliser dans la classe un petit métier à tisser, fort rudimentaire qui enchanta les enfants. On tissa même une ceinture pour les deux « estamas » qui n'en perdirent pas moins leurs culottes, mais ce qui fit sentir aux enfants que devant eux s'élargissait l'horizon de l'Ecole. Pour parachever cette victoire, Freinet fit une poésie enfantine sur le tisserand, et la lut aux gamins :
Sur son métier, le tisserand
a ourdi les fils patiemment...
Ce fut un vrai succès, et c'est depuis ce jour-là que les petits élèves comprirent enfin à quoi servaient les poèmes, et décidèrent d'en apprendre. Il y eut ainsi toute une ronde des métiers mise en poèmes au retour de chaque visite aux artisans du village. On alla chez le menuisier, chez le forgeron, chez le boulanger, chez le potier, chez le parfumeur, et très souvent, dans l'après-midi, à l'heure où maître et élèves se laissaient gagner par la torpeur et l'ennui, Freinet partait avec ses élèves par les sentiers qui rayonnent autour du vieux village, et, à même la nature et les .aspects changeants des horizons, il faisait la plus vivante des leçons de géographie, de calcul ou de botanique.
L'Ecole s'était ouverte sur la Vie.
On ne réalise pas bien aujourd'hui où les enquêtes scolaires sont devenues réalité courante, tout ce qu'apportaient de ferment révolutionnaire les innovations du petit instituteur de Bar-sur-Loup. L'Inspecteur primaire, mis au courant, laissa faire tout d'abord, sans approuver ouvertement, et au moment où il commençait à s'inquiéter quelque peu des pratiques systématiques de son subordonné, les instructions ministérielles de 1923, si libérales, si délibérément axées sur l'Ecole active, vinrent donner raison à l'audacieux instituteur de la petite école de Bar- sur-Loup.
Au retour des promenades, Freinet écrivait au tableau un petit compte-rendu très simple de la sortie. Les enfants le lisaient, le copiaient sur leur cahier, l'illustraient, et il était visible que ces travaux les passionnaient, et que, en déduction, l'écriture, la lecture, en bénéficiaient, comme la discipline et l'atmosphère de la classe.
Quel accueil était réservé à ces pratiques scolaires au-delà de la classe ? Le plus étonné était sans doute le directeur qui voyait se généraliser et s'amplifier des pratiques qui ne cadraient plus du tout avec les habitudes de sa classe à lui ! Il conseilla la prudence à son adjoint, par crainte de réactions possibles dans le village, mais les parents d'élèves acceptèrent très bien ces innovations, car très souvent ils interrogeaient le jeune instituteur à ce sujet, se rassurant assez facilement aux explications du maître.
Il faut dire aussi que Freinet s'est intégré peu à peu dans l'atmosphère du village. Il a noué des relations avec les parents d'élèves, et au cours des enquêtes de sa classe, il a pris contact avec les artisans divers, les producteurs, et c'est avec un intérêt profond qu'il étudie pour lui-même les déterminants économiques qui conditionnent la vie sociale provençale. Il fait, en collaboration avec un ami, une étude approfondie de l'industrie florale de la région de Grasse, et qui paraît dans « Clarté », la jeune revue d'avant-garde de Barbusse. Il écrit pour lui-même une étude suivie sur les persistances des techniques moyenâgeuses en régime capitaliste sur ce coin de Provence. Et à l'appui de ces contradictions, de ces décalages économiques, l'anachronisme de sa petite école lui apparaît lumineusement. Dès cet instant, ses activités sont doubles : inventer dans sa classe des formes modernes d'enseignement, et dans le milieu local susciter à l'appui des données économiques les aspects nouveaux de la coopération.
Il trouva un noyau de personnes assez dévouées pour s'employer avec lui à la création d'une grande coopérative de consommation et de vente de produits locaux dont il fut l'animateur et le trésorier. La coopérative avait son siège sur la grande place du village, et Freinet partageait ainsi son temps entre sa classe et cette œuvre commune qui prenait peu à peu une étonnante extension. Cette réussite lui valut la sympathie des petites gens, et la considération de toute la population de ce petit bourg provençal, qui gardera son souvenir et lui prouvera sa reconnaissance quand l'incompréhension et la malveillance se ligueront contre lui.
Le grand souci de Freinet restait évidemment sa classe. Certes, les méthodes actives qui l'avaient conduit à l'usage quotidien des sorties dans la nature et dans le village portaient leurs fruits. Mais il se créait ainsi une sorte de décalage progressif entre les leçons surgies de la vie et celles, toutes formelles, qui se donnaient en classe et qu'imposaient inéluctablement les programmes. Le décalage se sentait mieux encore pour la lecture, entre l'intérêt des enfants pour les textes qu'ils avaient vécus et créés, et leur indifférence à l'égard des tableaux Boscher et de leur livre de lecture. Le texte au tableau parlait du lézard que Georges venait intrépidement d'attraper sous sa casquette, et qui était là, maintenant, dans le bocal posé sur la table. Le tableau Boscher parlait de phrases incompréhensibles, et, à la page du jour, le livre offrait l'énigme d'une quelconque histoire qui, même écrite par un grand maître n'était pas de sitôt comprise par les demi-illettrés qui la lisaient en ânonnant.
Non, le problème de la lecture n'était pas résolu ; un cycle était pressenti par le maître, mais sa courbe ne se profilait point encore dans le champ des expériences quotidiennes.
En fin d'année scolaire (1924), l'un des premiers Congrès de la Ligue Internationale pour l'Education Nouvelle se tient à Montreux. Freinet s'arrange pour réunir l'argent nécessaire au voyage et à un court séjour en Suisse, (et c'était là, comme aujourd'hui, un gros problème financier) ; il se rend à Montreux, heureux d'avance d'y entendre Ferrière, Claparède et Bovet. Il est passionnément intéressé par tout ce qu'il voit et entend. Il pénètre mieux ce principe d'éducation nouvelle soucieux de donner à l'enfant un rôle actif dans sa propre éducation. Mais à chacune des affirmations et des perspectives que les pédagogues de Genève imposent à son esprit, il est d'avance découragé. Il se rend compte qu'il y a une éducation nouvelle relativement facile, applicable pour les écoles possédant le matériel éducatif, l'installation scolaire, permettant l'activité de l'enfant et l'individualisation de l'enseignement. Mais pour l'école de Bar-sur-Loup le problème est tout autre. L'image de sa petite classe dénudée et poussiéreuse s'impose à lui et lui serre le cœur.
C'est au Congrès de Montreux que Freinet rencontre Cousinet venu rendre compte de ses premières tentatives de travail par équipes. Déjà, à Bar-sur-Loup, Freinet avait eu l'idée de donner à quelques élèves de petits travaux manuels collectifs, et bien que l'initiative Cousinet lui paraisse un peu trop systématisée, il pense s'en servir, et surtout l'utiliser comme argument valable pour apaiser les craintes excessives de son directeur.
Un autre avantage de sa venue en Suisse est le contact vivifiant de la forte personnalité de Coué, ce vulgarisateur de la suggestion pratique employée comme cure physique et morale. Si persuasif, si simple est le praticien, que dès cet instant Freinet adopte une attitude nouvelle en face de la maladie ; il tente d'affirmer sa santé de façon plus positive, ce qui l'aida à remonter la pente, à tenir mieux, à se livrer sans arrière-pensée à cette passion de travail qui fut le refuge d'une jeunesse prématurément marquée.
Sa tristesse et sa solitude dans ce Congrès où de grands éducateurs affirment déjà tant de victoires en face de ses hésitations ont au moins l'avantage de le rejeter farouchement vers ce matérialisme scolaire qui reste son plus noble souci, et de l'orienter définitivement vers la recherche de techniques éducatives qui est le programme essentiel de notre actuelle C.E.L. Il prend conscience plus encore de la dépendance étroite de l'école et du milieu, et combien la société conditionne l'école et l'enseignement.
Il n'y a pas de pédagogie sans que soient remplies les conditions économiques favorables permettant l'expérience et la recherche. Il n'y a pas d'éducation idéale, il n'y a que des éducations de classe.
Auteur :