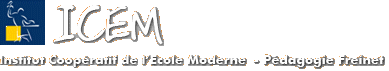SAINT-PAUL
(1928-1929)
Difficultés scolaires
Quand nous étions venus visiter Saint-Paul quelque temps avant que Freinet fasse sa demande de changement pour ce poste, nous avions été séduits de suite par l'originalité de ce village d'apparence médiévale, ceinturé de remparts, dominant du haut de son coteau les pentes couvertes de vignes, les champs de roses, les orangers, les oliviers d'argent, et, aux confins de l'horizon, les lointains adoucis vers la mer. L'intimité des vieilles pierres, les ruelles vétustés, les fontaines antiques, écartent par leur simple présence la tapageuse nouveauté des constructions modernes, des devantures criardes, et s'entêtent à demeurer le fidèle décor aux vieilles paysannes provençales à vaste jupon et à chapeau de paille, évoluant silencieusement et graves sur la tresse dure de l'espadrille.
Le bourgeois n'a pu pénétrer dans l'enceinte de la petite ville, violenter sa simplicité pour y installer l'agitation bruyante de ses hôtels interlopes ou l'égoïsme casanier de sa vieillesse blasée [1]. Epaule contre épaule, les vieilles maisons ont fait la chaîne devant l'envahisseur indélicat, qu'il soit brasseur d'affaires ou nouveau riche désœuvré. Elles les ont rejetés hors des murailles refermées sur elles comme un écrin, crocheté par l'antique porte. C'est pourquoi, autour de Saint-Paul, s'éparpillent les hôtels luxueux, les villas modernes, les pavillons particuliers et que, par bravade et insolence, le Saint-Paul des riches est quotidiennement comme une insulte au Saint-Paul des pauvres.
Nous étions, nous, dans le Saint-Paul des pauvres.
L'école était une vieille bâtisse encastrée dans le pâté de maisons tassé comme un mortier autour de la haute église. Une toute petite courette qu'une treille vigilante tenait l'été sous l'ombre généreuse de son feuillage, une salle donnant sur la ruelle par deux de ses fenêtres, un préau minuscule, c'était là désormais le domaine de l'Imprimerie à l'Ecole.
Notre modeste mobilier était à peine déchargé que déjà Freinet était dans la classe. Mélancolique, il méditait devant sa désolante pauvreté : de vieilles tables branlantes, un plancher disjoint, où même des lattes manquaient, un vieux bureau sur une estrade, une bibliothèque charançonnée, des carreaux brisés, — tel est l'appoint immédiat que la Municipalité de Saint-Paul offre aux méthodes nouvelles... Il y a pis : sous le préau, une humidité douteuse filtre sous une porte, dégageant une odeur assez caractérisée pour qu'on ne puisse douter de ses origines... Même en fin de vacances, les W.-C. n'ont pas été vidés...
— Ce n'est pas tellement emballant, dit Freinet, mais je vais de suite voir le Maire.
Il faut aller très loin chercher M. le Maire, dont la villa boit à plaisir le soleil et l'air pur, dans le Saint-Paul des riches.
— La classe délabrée ? dit M. le Maire. Mais, mon pauvre monsieur, c'est ainsi que sont toutes les écoles, dans nos humbles villages ! Blanchir ? Je le veux bien. Remplacer les lattes manquantes du plancher ? Ça, ce sera plus difficile ! Les cabinets ? C'est toute une histoire ! La fosse est trop petite et le haut n'en est pas étanche. Que voulez-vous qu'on fasse ? Si vous croyez que c'est commode ! Des étagères ? Vous voulez des étagères ? Mais c'est une folie - Nous sommes pauvres, très pauvres ! Nous n'avons pas de crédits ! Une table pour l'imprimerie ? Vous dites : une table ? Oh ! Alors, ça, vraiment, ça me dépasse !... Voyez, mon cher monsieur, je ne suis pas instituteur, mais je vais vous dire mon opinion : ici, voyez- vous, vous n'aurez guère que des fils de pauvres bougres, fils de métayers pour la plupart, et qui n'ont pas besoin d'avoir des lettres, ni d'en imprimer. Lire, écrire, compter, ce sera déjà une rude tâche pour vous. Entre nous, votre prédécesseur les a bien négligés, et ce qu'il vous faudra surtout, c'est de la poigne ! Ne vous embarrassez pas de tant de complications ! Vous n'en aurez pas pour longtemps pour comprendre ce que sont les parfaits galopins. Tenez-les ferme, je vous le répète, voilà le plus grand service que vous pouvez leur rendre !
Les parfaits galopins en effet ne sont pas en-deçà du jugement de M. le Maire. Il faut, pour commencer, pas mal de ruse et d'entêtement pour les entraîner à participer à l'installation première de la salle de classe qu'un maçon a mal blanchie, et qu'une femme de ménage a fort mal nettoyée. Tout de suite, ce sont les chicanes, les bousculades, les gestes de menace, et cette atmosphère discordante où le jugement sensé n'arrive jamais à avoir sa place. Je m'inquiète pour la gorge fragile de Freinet qui aura tant à se fatiguer pour rétablir l'ordre et supporter ce nuage de poussière qui monte sans cesse d'un plancher bosselé qu'on n'arrive jamais à balayer convenablement.
Mais, heureusement, l'âme de l'enfant n'est jamais totalement désespérante, et comme dans toute classe on distingue vite les éléments dociles, curieux en profondeur, tels que Lulu, Eugène Ruiz, Audoly, André ; les turbulents mitigés de bonne volonté comme Jeannot, Thomas, Pellegrin, Bechetti ; et les invétérés chambardeurs dont Lagorio est le remarquable prototype. Cette tache d'encre, là, contre le mur, au-dessus de la chaire du maître, et que le badigeonnage de chaux n'a point entièrement effacée ? C'est l'œuvre de Lagorio, un jour qu'il avait juré de faire un exploit, et que, par bravade, son encrier avait voltigé par dessus la tête du maître. Les bancs entaillés, les carreaux cassés, la vieille chaise branlante ? Preuves irréfutables de bagarres permanentes qui justifiaient assez l'excessive prudence d'un vieil instituteur fermant à double tour la classe et le portail pendant les interclasses.
Mais, de suite, Freinet veut effacer les traces suggestives de ce récent passé, — si récent qu'il empiète encore trop avantageusement sur le présent, et risque de le dominer. Pour amadouer Lagorio, j'ai, en quelque coups de crayon, croqué sa frimousse bohémienne, et c'est à lui que je demande de m'aider à fixer au mur, juste à l'endroit de la tache indélébile, le fusain qui chatouille si agréablement son amour-propre. Tant bien que mal, on répare la chaise, on consolide les tables, et tous les enfants se passionnent pour ce travail de bricolage qui diffère tellement des habituels exercices scolaires. La plus grande joie leur vient de la confection d'une table pour l'imprimerie. On a fait raboter quatre solides pieds de chêne au menuisier du village, et, à l'aide de longs clous, on les fixe au socle de l'estrade, à grands coups de marteau retentissants. La belle table ! On y peut aisément s'asseoir ou, pour épater la galerie, y faire l'arbre droit et marcher sur les mains...
— Mais non, voyons, nous ne prendrions pas autant de peine pour vous faire faire les saltimbanques. L'arbre droit, vous le ferez dehors ; la table, c'est pour l'imprimerie.
— L'imprimerie ?...
La classe entière en reste suffoquée. On se presse autour du maître qui déballe précautionneusement « sa marchandise »...
— Vé... Vé... des lettres... Oh ! m !..., y'a le o î y'a le i...
— Pour qui c'est, m'sieur ?
— C'est pour toute la classe. C'est à chacun de vous ; c'est à Jeannot, à Castelli, à Pellegrin, à Lagorio, et c'est aussi à moi qui travaille avec vous.
L'apparition d'un matériel scolaire nouveau et placé résolument sous la responsabilité des enfants les déconcerte un instant, puis flatte leur fierté, et suscite chez eux peu à peu une certaine prudence à en user, et, partant, un respect qui lentement s'installe en chacun d'eux. On ne constate pas, comme je le redoutais tant d'abord, la disparition des caractères d'imprimerie dans les poches des voleurs invétérés, ou leur envol par la fenêtre, en pluie rageuse, quand la composition s'avère trop difficile. Non ; au contraire, au cours du balayage de la classe, on se baisse pour ramasser les lettres tombées, et l'en entend, de la bouche même de Lagorio :
— Quel est cet abruti qui a laissé tomber un M majuscule ? Ça, alors !
Le premier texte imprimé dit assez l'inexpérience des enfants à s'exprimer, à faire participer l'impression de leur personnalité intime.
NOTRE VILLAGE
Le village de Saint-Paul se trouve entre Cagnes et Vence. II est à trois kilomètres de la mer à vol d'oiseau et à huit kilomètres par la route. Le tramway passe à Saint-Paul. Un autocar fait le service Saint-Paul - Nice deux fois par jour. Il met une heure pour aller à Nice.
Tous.
Mais la correspondance interscolaire, tout de suite amorcée, donna une motivation au texte libre et situa l'imprimerie au cœur même de la vie de la classe qui peu à peu se déploya dans une certaine ligne d'ordre qui parfois frôlait l'harmonie. Ce n'était pourtant pas là encore l'idéal.
Il fallut, il faut l'avouer, des semaines et des semaines pour arriver à créer, jour après jour, avec une vigilance de tous les instants, l'atmosphère de détente et de confiance indispensable à la bonne marche d'une école centrée sur la vie même de l'enfant. Les heures de classe, bien que souvent pénibles à cause de cette habitude constante de dispersion des esprits, devinrent assez vite fort encourageantes, et certains jours même, quand un intérêt majeur hypnotisait toutes les attentions, on put s'abandonner à un sentiment de complète réussite.
Malheureusement, les heures d'interclasse viennent étrangement compliquer la situation. Pour remettre les enfants en confiance, Freinet avait laissé l'école et le portail ouverts. Les petits métayers éloignés du village et qui apportaient leur repas pouvaient ainsi s'installer commodément sous le recoin abrité qui servait de préau, pour manger leur maigre dîner sur une longue table improvisée. Les élèves du village pouvaient de même entrer librement avant l'heure et venir en classe terminer un travail ou parachever un détail quelconque qui avait retenu leur intérêt. En principe, chacun s'engageait à ce minimum de retenue et de discipline qui empêchait « les histoires ». Mais la promesse était au-dessus des instincts violents de ces gamins turbulents toujours prêts à proférer l'injure, à s'emporter, à se déchaîner dans des colères légendaires. Quand nous rentrions, vers une heure, de notre promenade quotidienne, il y avait continuellement des coups donnés, des batailles se terminant en plaies et bosses, dents cassées et même oreilles décollées... Fermer les portes, rejeter les enfants à la rue, n'était pas une solution, Sermonner ne servirait à rien. On ne solutionne pas par des mots des différends dans lesquels l'enfant engage toute l'ardeur de ses instincts combatifs. Tout de suite, comme l'on pouvait avec les moyens du bord, on tâchait de solutionner rapidement les faits violents, et, derechef, d'enchaîner les enfants à un intérêt collectif, un travail en commun dont la réussite créerait inévitablement cette solidarité indispensable à la vie communautaire.
Plus étaient grandes les victoires remportées par un enseignement humain, faisant à l'individu la part généreuse tout en l'incorporant à la communauté, plus se solutionnaient facilement les heurts survenus entre métayers et citadins, Français et Italiens, riches et pauvres, — car c'était en fait des oppositions sociales violentes que naissaient les conflits. Il fallait vraiment toute l'intuition du maître et une méticuleuse observation des menus faits survenus dans la vie de l'école, pour arriver à constituer les équipes de travail dans lesquelles, prudemment, on associait les individualités rivales. Ce faisant, la victoire resta à l'école, qui devint progressivement le foyer vivant, le centre de vie indissoluble que les événements devaient si tragiquement mettre à l'épreuve.
D'une manière générale, ces débuts à Saint-Paul furent particulièrement pénibles. Des lenteurs inadmissibles étaient apportées au blanchiment de notre appartement, et faute de pouvoir déballer le matériel coopératif nous avions un mal énorme à faire démarrer les expéditions que les nombreuses commandes reçues chaque jour rendaient urgentes. La C.E.L. ce fut, pendant des semaines, des caisses ouvertes le long des escaliers, une à chaque marche, posées dans un équilibre plus ou moins relatif. Je puisais dans l'une ou dans l'autre, emportant des articles divers sur la table de la cuisine où je faisais moi-même les expéditions. Les adresses de « l'Educateur », de « la Gerbe », des « Enfantines », la mise sous bandes des revues, grignotaient petit à petit tout mon temps. Freinet, lui, avait comme à l'ordinaire le crâne bourré de projets. Sa puissance étonnante de travail lui permettait d'allonger les journées selon les nécessités du moment. Levé à quatre heures du matin (ce qui resta toujours l'habitude de sa vie), couché à onze heures du soir, il faisait face sans jamais faillir à tout ce que sa volonté endiablée avait mis en chantier la veille. Il souffrait à peine de la précarité de ces temps de transition, s'adaptait au désordre, radieux toujours de sa fin de journée, prêt à l'attaque pour le lendemain. Sa santé ? Il n'y pensait même pas. Il montait parfois l'escalier comme un vieillard, s'appuyant de tout son poids à la rampe, mais quand il s'asseyait devant son bureau, c'était le grand démarrage, les bouchées doubles ou quadruples qui abattaient la besogne dans un élan forcené... Il finit par s'installer ,au fond d'un couloir, dans une pièce indépendante, le bureau pour lui idéal, où les étagères pliaient sous le poids des paperasses, où les classeurs multiples se livraient bataille sur la large planche qui courait le long des murs, et il s'en donnait à cœur joie de faire cliqueter l' « Underwood » sur son mauvais bureau calé tant bien que mal et sur lequel s'éparpillaient les lettres et circulaires qui constituaient avec les paquets que je confectionnais moi-même un courrier déjà bien volumineux.
Restait à trouver chaque jour l'argent nécessaire à l'expédition. En ce début d'année scolaire la caisse de la Coopé était vide. L'argent que nous aurions pu économiser pendant les vacances avait été englouti par notre déménagement. Contrairement à notre espoir de me voir enfin nommée à l'école de filles, la vieille institutrice malade ne prit sa retraite, ce qui ne nous empêcha pas de trouver en elle une agréable et dévouée amie, et qui le resta dans les moments les plus difficiles de notre vie à Saint-Paul. Quoi qu'il en fût, malgré les complications de ces débuts, la première année de Saint-Paul fut une année magnifique pour les destinées de la Coopérative.
Le Congrès de Paris, à l'atmosphère si fraternelle et si enthousiaste, avait redonné un élan nouveau à nos adhérents qui y avaient participé. Rentrés chez eux, ils eurent à cœur d'apporter une collaboration plus fidèle, plus généreuse, à l'œuvre commune. Ils suivirent, semble-t-il, avec plus de profondeur, et avec une attention plus aiguisée, la vie même de leur classe, et par ailleurs ils s'ingéniaient à perfectionner les techniques dans leur rendement et dans leur esprit, comme en témoignent tout au long de l'année les bulletins de l'Imprimerie à l'Ecole. Et Freinet avait raison, au bout de quelques mois de cette intense collaboration, de prévoir un enrichissement progressif de la revue, où chacun aurait son mot à dire :
C'est surtout parce que cette expérience de l'imprimerie à l'école ne pouvait être l'œuvre d'un seul, parce qu'elle ne peut s'affirmer que par l'entr'aide et la coopération, que ce bulletin sera l'âme de nos techniques, l'élément essentiel de leur amélioration et de leur succès.
En cette fin d'année 1928 paraît le livre « Plus de manuels ». Freinet y précisait sa technique de travail sans manuels scolaires et par l'adaptation de l'enseignement à la nature de l'enfant. Toutes les précisions que donnait « Plus de Manuels » ont été reprises et développées dans les livres ultérieurs de Freinet.
Auteur :